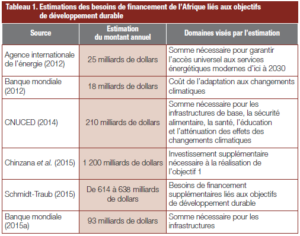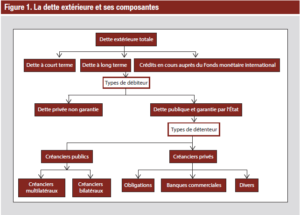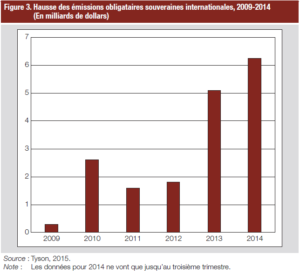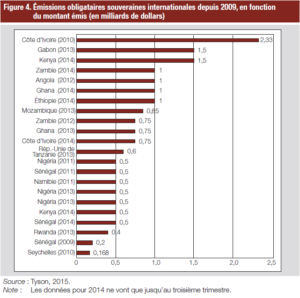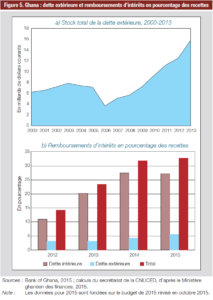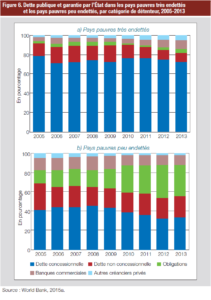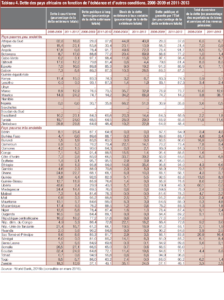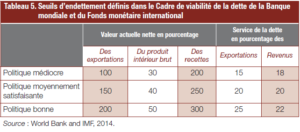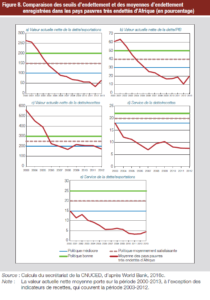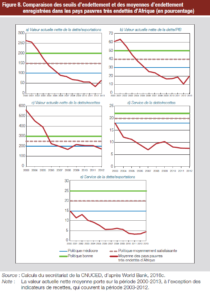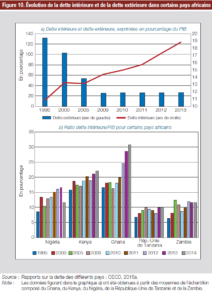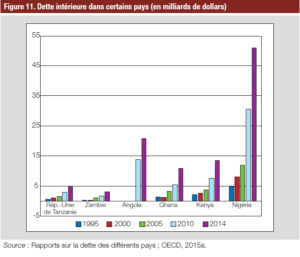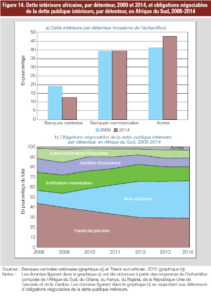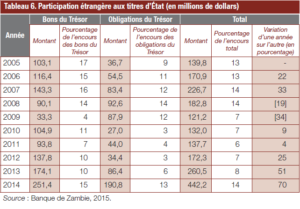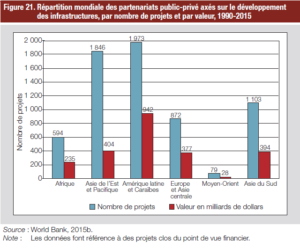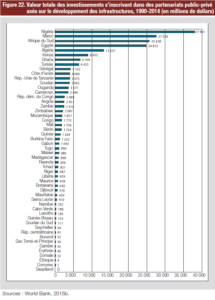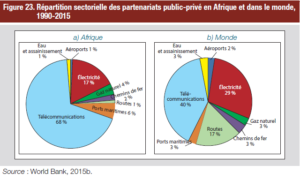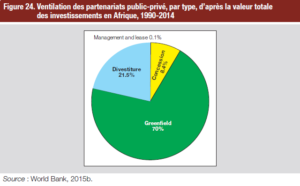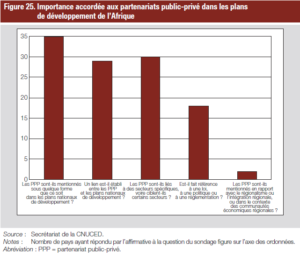RAPPORT 2016
LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DYNAMIQUE DE LA DETTE ET FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE
Introduction
Les grandes aspirations de l’Afrique en matière de développement s’inscrivent dans le contexte plus large d’un programme de développement économique à l’échelle de la planète et du continent. Pour y répondre, des ressources financières considérables sont nécessaires alors même que les modalités de financement du développement sont en train de changer au niveau mondial, le modèle centré sur l’aide publique au développement et le financement des besoins restants par la dette extérieure laissant la place à un cadre dans lequel l’accent est davantage mis sur la mobilisation des ressources intérieures.
Le Rapport 2016 sur le développement économique en Afrique aborde un certain nombre de problématiques fondamentales propres à la dette intérieure et extérieure de l’Afrique et donne des conseils sur le fragile équilibre à trouver entre les différentes modalités de financement du développement et la viabilité de la dette globale. Il analyse l’endettement international de l’Afrique ainsi que le poids grandissant de la dette intérieure dans le financement du développement de certains pays africains et examine les sources de financement complémentaires ainsi que leurs incidences sur la dette.
Après l’allégement de la dette consenti au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale pendant les vingt dernières années, la dette extérieure de plusieurs pays africains a rapidement augmenté au cours des dernières années, ce qui commence à inquiéter les décideurs, les analystes et les institutions financières multilatérales. Les ratios d’endettement extérieur enregistrés en Afrique semblent gérables, mais leur hausse rapide dans plusieurs pays est préoccupante et appelle des mesures pour éviter une répétition de la crise de la dette de la fin des années 1980 et des années 1990. En 2011-2013, le stock annuel moyen de la dette extérieure en Afrique était de 443 milliards de dollars (soit 22 % du revenu national brut (RNB)). Le stock de la dette extérieure avait augmenté rapidement, de 10,2 % environ par an en 2011-2013, contre 7,8 % par an pendant la période 2006- 2009. L’explosion de la dette de plusieurs pays africains peut s’expliquer par le meilleur accès aux marchés financiers internationaux dont ces pays bénéficient en raison de la croissance économique vigoureuse que l’Afrique a connue au cours des dix dernières années. À cet égard, les investisseurs recherchent de meilleurs rendements et des taux de retour sur investissement plus élevés1 car les investissements en Afrique sont considérés comme risqués (alors que les investissements dans les pays avancés affichent un faible rendement). La montée en puissance d’autres pays en développement, en particulier le groupe constitué du Brésil, de la Fédération de Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud, communément appelé « groupe BRICS », a également ouvert de nouvelles sources de financement extérieur dont les pays africains peuvent profiter en raison de l’absence fréquente de conditionnalité. Grâce à un tel environnement extérieur favorable, depuis le milieu des années 2000, certains pays africains ont lancé des émissions d’obligations souveraines qui ont été bien accueillies. Cependant, l’environnement favorable qui a contribué à la baisse des ratios d’endettement a évolué. Par exemple, les risques associés à l’exportation de produits de base sont plus élevés et les coûts d’emprunt pour les exportateurs de ces produits ont fortement augmenté.
Compte tenu de son ampleur et de son rythme de progression, la dette extérieure des pays africains a également des incidences sur la viabilité. Certains gouvernements se tournent actuellement vers des prêteurs privés, alors qu’auparavant ils empruntaient essentiellement à des prêteurs publics à des conditions de faveur. Certains pays africains ont bénéficié de prêts consortiaux, tandis que d’autres ont émis des euro-obligations. De plus, la dette extérieure du secteur privé en Afrique est également en train d’augmenter. Par exemple, des émissions importantes d’obligations de sociétés ont été lancées au Nigéria et en Afrique du Sud. Étant donné que ces obligations sont libellées en devises, les pays deviennent vulnérables aux fluctuations monétaires. En outre, la dette du secteur privé peut se transformer en dette publique si des plans de sauvetage sont nécessaires pour empêcher que le système financier ne s’effondre lorsque des emprunteurs privés ne peuvent pas rembourser leurs dettes. De plus, emprunter à des prêteurs privés (aux conditions du marché) n’est pas sans risques, car une renégociation est généralement plus difficile lorsqu’un pays n’est pas en mesure d’assurer le service de sa dette, et les conditions de renégociation sont très onéreuses. Bien que cela ne concerne pas uniquement les prêteurs privés, ce type d’emprunt expose également les pays africains à des contentieux avec des fonds vautours et à l’arbitrage en matière d’investissements. Il est par conséquent nécessaire que les gouvernements africains suivent de près l’évolution des caractéristiques de la dette et prennent des mesures préventives pour éviter un éventuel surendettement.
La dette intérieure et les marchés obligataires ont également connu une évolution notable. Jusqu’à une période récente, les ouvrages concernant l’emprunt souverain et la dynamique de la dette ne s’intéressaient guère au rôle que la dette intérieure pourrait jouer dans le financement du développement en Afrique et mettaient l’accent presque exclusivement sur la dette extérieure. Depuis quelques années, cependant, plusieurs pays de la région font de plus en plus appel à des sources nationales lorsqu’ils ont besoin d’augmenter l’emprunt net et adoptent des politiques visant à développer les marchés obligataires nationaux avec le soutien actif d’institutions financières internationales et d’autres organisations internationales. À l’avenir, l’emprunt intérieur jouera probablement un rôle de plus en plus important, la croissance soutenue enregistrée par un grand nombre de pays africains stimulant l’épargne nationale et augmentant les possibilités de financer le développement par des ressources intérieures. Il faudra également que les pays trouvent des moyens d’utiliser de façon productive les liquidités additionnelles des institutions financières nationales, ce qui n’était pas toujours le cas auparavant.
En raison du rôle toujours plus important de la dette intérieure, les pays feront face à des risques nouveaux, à mesure que le nombre de créanciers et d’instruments de dette augmentera. Compte tenu de son ampleur et de sa progression rapide, il sera important de prendre en considération la dette intérieure dans les évaluations de la viabilité de la dette publique. En tant que facteur de gonflement de la dette intérieure, l’augmentation des emprunts du secteur public sur les marchés nationaux pourrait avoir pour effet d’évincer l’investissement privé, car les marchés financiers sont peu développés et l’épargne nationale est faible dans la région (bien que l’épargne institutionnelle ait été plus élevée). Les emprunts sur le marché national sont également source de préoccupation : ils sont souvent perçus comme étant incompatibles avec la possibilité d’assurer et de préserver la viabilité de la dette publique. La libéralisation financière ainsi que les réformes dont elle s’est accompagnée depuis le milieu des années 1980 ont conduit à une hausse des taux d’intérêt réels nationaux. En conséquence, d’aucuns craignent que l’emprunt intérieur n’entraîne un certain degré d’instabilité macroéconomique dans les pays africains et que la charge élevée d’intérêts n’absorbe une part importante des recettes publiques, au détriment des dépenses qui réduisent la pauvreté et de celles qui stimulent la croissance (Abbas and Christensen, 2007). Les répercussions sur les femmes et les enfants, qui sont souvent les plus touchés par les fortes réductions des dépenses sociales, seraient importantes.
Étant donné que, pendant les années 1990, la plupart des pays africains avaient assez facilement accès au financement extérieur sous la forme de prêts concessionnels et de dons, les gouvernements ont eu tendance à éviter l’emprunt intérieur, dont le coût semblait élevé. Malgré la persistance depuis de nombreuses années d’importants déficits budgétaires et la nécessité croissante de procéder à des investissements structurels et favorables au développement, les marchés obligataires africains sont pour beaucoup restés sous-développés, en raison principalement de problèmes de crédibilité. Récemment, certains pays ont fait des efforts considérables pour développer leurs marchés obligataires nationaux, dont ils dépendent de plus en plus pour financer non seulement le développement, mais aussi les déficits budgétaires. Ce phénomène a pris de plus en plus d’importance pour cinq raisons.
Premièrement, en 2015, l’adoption de deux résolutions importantes de l’Organisation des Nations Unies, approuvées par les dirigeants mondiaux, a marqué une étape décisive dans l’établissement du programme international de développement pour les années à venir. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 définit les objectifs de développement durable que les pays comptent réaliser au cours des quinze prochaines années, et le Programme d’action d’Addis-Abeba (A/RES/69/313), issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement, tenue en juillet 2015 à Addis-Abeba, définit le programme et les moyens de mise en œuvre en matière de financement du développement. Ces résolutions contiennent des objectifs et des engagements interdépendants qui visent à assurer un financement durable du développement et qui ont une incidence sur le développement de l’Afrique. Elles traduisent le passage d’un modèle de financement du développement au niveau mondial centré principalement sur l’APD à un nouveau cadre mondial qui met davantage l’accent sur les sources nationales de financement, tout en préservant le rôle fondamental du financement public dans la réalisation des objectifs de développement durable. Les gouvernements africains auront beaucoup de mal à répondre aux besoins de financement qui en découlent ; selon diverses sources, le montant des investissements nécessaires pour financer la réalisation de ces objectifs en Afrique pourrait être compris entre 600 et 1 200 milliards de dollars par an (Chinzana et al., 2015 ; Schmidt-Traub, 2015 ; UNCTAD, 2014). Les ressources budgétaires publiques de l’Afrique ne sont pas suffisantes pour y faire face et les partenaires de développement devront participer au financement de ces besoins.
Deuxièmement, on ne peut plus partir du principe que l’aide extérieure, sous forme de dette concessionnelle ou de dons, continuera, dans un avenir proche, à jouer un rôle essentiel dans le financement de la réduction de la pauvreté, la réalisation des objectifs de développement durable et la mise en œuvre de programmes qui stimulent la croissance. En raison de la récurrence des crises financières mondiales et du renforcement de l’austérité budgétaire, les fonds provenant des donateurs traditionnels pourraient encore diminuer ; il est donc d’autant plus nécessaire que les marchés obligataires nationaux soient suffisamment liquides. Les enjeux en matière de développement ont également évolué : la communauté des donateurs accorde une attention croissante (et consacre par conséquent de plus en plus de ressources) à des questions telles que la lutte contre les changements climatiques et la prévention des catastrophes, qui, dix ans auparavant, n’occupaient pas une place centrale dans le programme de développement (United Nations Economic Commission for Africa, 2015).
Troisièmement, certains pays africains ont récemment été reclassés dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire (Banque mondiale, 2016a). À l’avenir, les banques multilatérales de développement ne devraient donc plus leur accorder de financement concessionnel, les partenaires de développement consacrant davantage de ressources budgétaires aux pays plus pauvres et plus vulnérables. En d’autres termes, le coût de financement des nouveaux pays à revenu intermédiaire, qui doivent davantage recourir à des sources publiques ou privées de financement non concessionnel ou moins concessionnel, devient plus élevé.
Quatrièmement, étant donné que de nombreux pays africains sont tributaires des produits de base, la viabilité de la dette extérieure est également sensible aux cycles d’expansion-récession des marchés internationaux de produits et au resserrement budgétaire qui découle de la diminution des recettes. L’effondrement actuel des prix des produits de base en est la preuve. La fin manifeste de la phase ascendante du supercycle des produits de base s’est traduite par une baisse des recettes tirées des exportations de ces produits. En somme, les pays africains doivent être moins tributaires des marchés des produits de base, qui sont instables.
Cinquièmement, les perspectives économiques mondiales restent sombres, étant donné que l’austérité budgétaire contribue au ralentissement de la croissance dans la zone euro, et que la Chine est en train de passer à une stratégie privilégiant une croissance plus faible, mais plus durable, ainsi qu’un rééquilibrage de l’activité économique en faveur de la consommation et des services et au détriment de l’investissement et de l’industrie manufacturière. Au niveau mondial, l’activité manufacturière et les échanges de produits manufacturés restent également faibles, ce qui traduit non seulement l’évolution de la situation en Chine, mais aussi, plus généralement, le ralentissement de la demande et de l’investissement, ce qui pourrait avoir des effets néfastes sur les perspectives de développement de l’Afrique. L’instabilité économique que la Chine a connue récemment entraînera très probablement un affaiblissement de la demande de produits de base africains, une baisse du volume des prêts et peut-être une augmentation des taux d’intérêt.
Dans ce contexte, l’Afrique doit procéder à une analyse critique de sa capacité à surmonter les obstacles importants à son développement, compte tenu de ses besoins en matière de financement du développement. Elle doit donc redoubler d’efforts pour mobiliser des sources novatrices de financement, notamment celles provenant du secteur privé, par exemple au moyen de partenariats public-privé, tout en remédiant à la hausse du niveau d’endettement. L’Afrique et ses partenaires devront également revoir les cadres de viabilité de la dette. La viabilité de la dette revêt une importance cruciale pour l’Afrique dans la mise en œuvre du Programme d’action d’Addis-Abeba, la réalisation des objectifs de développement durable et la transformation durable du continent.
A. THÉMATIQUE ET PRINCIPALES CONCLUSIONS DU RAPPORT
Voici quelques-unes des principales questions auxquelles le rapport tente de répondre :
- À la suite de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement et du Sommet des Nations Unies consacré à l’adoption du programme de développement pour l’après-2015, comment les pays africains peuvent-ils concilier les multiples objectifs consistant d’une part à financer les dépenses de développement et d’autre part à éviter une crise de la dette ?
- Quelles sont les principales tendances en matière de dette extérieure et quels sont les principaux facteurs déterminants de ces tendances ? Comment l’architecture financière mondiale peut-elle aider les pays à gérer leurs dettes de manière durable ?
- Quelles sont les tendances actuelles en matière de dette publique intérieure en Afrique ? Quels sont aujourd’hui les principaux facteurs de risque et les principales opportunités et comment les risques peuvent-ils être gérés ?
- Quelles modalités de financement complémentaires peuvent aider l’Afrique à répondre de manière durable à ses besoins essentiels en matière de financement du développement ?
Les cinq principales conclusions du rapport sont résumées ci-après.
Premièrement, compte tenu de la complexité des problèmes de développement rencontrés par l’Afrique, de l’ampleur de ses besoins en matière de financement du développement et de l’importance des contraintes pesant sur ses capacités, les pays africains doivent mobiliser toutes les sources potentielles de financement. La dette intérieure et extérieure ainsi que les sources complémentaires ne sauraient être exclues des modalités de financement du développement. Par conséquent, la dette destinée à réaliser des investissements au service des objectifs de développement durable devrait être appréhendée de manière plus souple. Cependant, la vulnérabilité de l’Afrique à des conditions extérieures qui évoluent rapidement, notamment à l’instabilité des marchés des produits de base et des marchés financiers internationaux, fait de la dette un instrument de financement plus problématique que nécessaire.
Deuxièmement, la dette extérieure de l’Afrique est en hausse, du fait principalement de la baisse des recettes d’exportation, de l’augmentation du déficit courant et du ralentissement de la croissance économique. La composition, les modalités et les conditions de la dette sont en train de changer, sous l’effet de la hausse des taux d’intérêt et de l’évolution de la part des prêts concessionnels dans la dette totale. La structure et la composition de la dette ont par conséquent une incidence sur sa viabilité.
Troisièmement, la dette intérieure augmente progressivement et la dette négociable y occupe une place toujours plus importante. Les marchés nationaux de capitaux se développent, à mesure que l’intérêt des investisseurs internationaux grandit. Un recours accru aux ressources intérieures peut donner aux pays une plus grande marge d’action dans la mise en œuvre de leurs priorités de développement, le financement au titre de l’APD étant souvent assorti d’une conditionnalité par politique imposée. Cependant, en raison du rôle toujours plus important de la dette intérieure, les pays pourraient faire face à des risques nouveaux, à mesure que le nombre de créanciers et de titres d’emprunt augmente.
Quatrièmement, il existe un large éventail de modalités complémentaires de financement du développement qui, si elles sont effectivement mises à profit, peuvent aider l’Afrique à répondre à ses besoins de financement sans influer nécessairement sur la viabilité de la dette. Il s’agit notamment des envois de fonds, des partenariats public-privé et de la réduction des flux financiers illicites.
Cinquièmement, il est nécessaire de resserrer la coopération internationale et régionale pour renforcer les capacités des institutions à répondre aux besoins de l’Afrique en matière de financement du développement et à remédier aux problèmes de gestion de la dette. L’intégration régionale pourrait jouer un rôle essentiel dans la coordination et la simplification des principaux éléments réglementaires et institutionnels provenant d’initiatives plus générales sur le financement du développement lancées dans le contexte de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et du Programme de développement durable à l’horizon 2030.
B. ORGANISATION DU RAPPORT
Le présent rapport se compose de quatre chapitres et d’une conclusion.
Le chapitre 1 étudie les besoins de financement des pays africains, compte tenu de leurs plans de développement nationaux et régionaux et de leurs engagements au niveau mondial. Il examine l’évolution des modalités de financement du développement en Afrique, notamment en ce qui concerne les objectifs de développement durable, le Programme d’action d’Addis-Abeba et l’Agenda 2063, ainsi que leurs incidences sur la viabilité de la dette des pays africains.
Le chapitre 2 examine quelques-unes des principales tendances et formes de la dette extérieure de l’Afrique ainsi que sa composition, aborde la question de la viabilité de la dette et examine de façon plus détaillée les cadres actuels de viabilité de la dette.
Le chapitre 3 étudie l’importance croissante de la dette intérieure en Afrique, en analysant ses tendances, ses formes et sa composition. Il présente cinq études de cas détaillées sur la dette intérieure au Ghana, au Kenya, au Nigéria, en République-Unie de Tanzanie et en Zambie.
Le chapitre 4 analyse les modalités complémentaires de financement du développement en Afrique et met l’accent sur trois modalités qui ont un impact limité sur la viabilité de la dette ou l’améliorent. Il examine ainsi le rôle et le potentiel des partenariats public-privé en matière de financement des infrastructures ainsi que la manière dont les envois de fonds peuvent contribuer au financement du développement et dont les flux financiers illicites peuvent être réduits.
La conclusion (chap. 5) contient des recommandations pratiques qui mettent l’accent sur la manière dont les pays africains peuvent éviter le risque de surendettement découlant principalement du financement intérieur et d’autres initiatives comme les partenariats public-privé. Les recommandations pratiques portent également sur la manière dont les gouvernements africains, les partenaires extérieurs et la communauté internationale peuvent contribuer à assurer la viabilité de la dette publique de l’Afrique.
CHAPITRE 1
RÉPONDRE AUX BESOINS DES PAYS AFRICAINS EN MATIÈRE DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
A. INTRODUCTION
Le présent chapitre traite en premier lieu des besoins de financement croissants des pays africains et de l’évolution des modalités de financement du développement en Afrique. Il met ensuite en lumière les besoins de financement de l’Afrique dans le cadre de la mise en œuvre des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063, et se termine par un examen de la portée et des limites de l’aide publique au développement en tant que source de financement du développement.
B. AMPLEUR DES BESOINS DE FINANCEMENT
En 2015, plusieurs faits nouveaux qui auront d’importantes répercussions sur l’ampleur des besoins de financement et la viabilité de la dette de l’Afrique sont intervenus sur le plan international. En septembre 2015, la communauté internationale a adopté les objectifs de développement durable. Ainsi, les États Membres du continent africain se sont engagés à mettre en œuvre dans les quinze prochaines années des programmes de développement nationaux et régionaux, qui visent à contribuer à la réalisation des 17 objectifs et des 169 cibles énoncés. En comparaison avec les huit objectifs du Millénaire pour le développement et les 21 cibles qui y étaient associées, les objectifs de développement durable s’inscrivent dans un programme international de développement bien plus ambitieux qui nécessitera d’importantes ressources financières. La plupart des études citées dans la présente section mettent en avant la difficulté à estimer les besoins de financement de l’Afrique liés aux objectifs de développement durable. Ces études se fondent sur des méthodes et des hypothèses différentes. Compte tenu de leur complexité, des domaines visés et des différentes méthodes employées, il est difficile d’établir une comparaison directe entre les diverses estimations présentées dans le tableau 1.
Une analyse récente des études sectorielles réalisée par Schmidt-Traub (2015) montre que les dépenses supplémentaires que les pays à faible revenu et les pays à revenu intermédiaire inférieur2 devront engager pour atteindre les objectifs de développement durable pourraient s’élever à 1 200 milliards de dollars par an (de 342 à 355 milliards de dollars pour les pays à faible revenu et de 903 à 938 milliards de dollars pour les pays à revenu intermédiaire inférieur), ce qui correspond à 11 % du produit intérieur brut (PIB) pour la période 2015-2030 si l’on se base sur les taux de change du marché. Schmidt-Traub (2015) n’établit pas d’estimation par région. Néanmoins, si les estimations établies pour tous les pays à faible revenu sont prises en compte dans le calcul des coûts supplémentaires associés à la réalisation des objectifs de développement durable dans les pays africains à faible revenu, on obtient un total compris entre 269 et 279 milliards de dollars par an (la part du PIB des pays africains à faible revenu représente 78,5 % du PIB de l’ensemble des pays à faible revenu). De même, si l’on calcule les besoins de financement supplémentaires liés aux objectifs de développement durable dans les pays à revenu intermédiaire inférieur d’Afrique à partir des estimations établies pour l’ensemble des pays à revenu intermédiaire inférieur, on obtient un total compris entre 345 et 359 milliards de dollars par an. Ainsi, au total, le coût supplémentaire du financement des objectifs de développement durable en Afrique pourrait être compris entre 614 et 638 milliards de dollars par an.
Chinzana et al. (2015) axent leurs travaux sur l’objectif 1 (éliminer la pauvreté) et donnent une estimation du montant de l’investissement supplémentaire dont l’Afrique aura besoin pour atteindre cet objectif, en supposant que l’épargne, l’APD et l’investissement étranger direct se maintiendront à leurs niveaux actuels et compte tenu du fait que l’Afrique devra accroître son PIB de 16,6 % par an pendant la période 2015-2030 pour réaliser ledit objectif d’ici à 2030. À partir du PIB nominal de l’Afrique enregistré en 2015, ils estiment le ratio annuel investissement-PIB à 87,5 % (soit 1 700 milliards de dollars) et le ratio annuel déficit de financement-PIB à 65,6 % (1 200 milliards de dollars). Toutefois, les résultats varient fortement selon les sous-régions et les pays, et en fonction du degré de développement.
Les premières prévisions de la CNUCED montrent qu’à l’échelle mondiale, le total des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable pourrait être compris entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars par an pendant les quinze années prévues (UNCTAD, 2014). Les investissements nécessaires dans les secteurs clefs liés aux objectifs de développement durable des pays en développement pourraient atteindre un total compris entre 3 300 et 4 500 milliards de dollars par an pour les infrastructures de base (routes, voies ferrées et ports ; centrales électriques ; services d’approvisionnement en eau et d’assainissement), la sécurité alimentaire (agriculture et développement rural), l’atténuation des changements climatiques et l’adaptation aux effets de ces changements, la santé et l’éducation. Avec les actuels investissements (publics et privés) dans les secteurs liés aux objectifs de développement durable, qui s’élèvent à 1 400 milliards de dollars par an, les pays en développement afficheront un déficit de financement pouvant atteindre 2 500 milliards de dollars. Si l’on se base sur la part actuelle du PIB nominal de l’Afrique dans le PIB des pays en développement (environ 8,4 %, selon les données d’UNCTADStat pour 2013), le déficit de financement annuel pourrait s’établir à 210 milliards de dollars dans les pays africains. Il s’agit probablement d’une estimation prudente pour les pays africains ; leur part du PIB étant faible et leur déficit d’infrastructure supérieur à celui de la plupart des autres pays en développement, la part des ressources qui leur sont destinées devrait être bien plus élevée.
La Banque mondiale (2012) estime que les investissements nécessaires dans les infrastructures s’élèvent à eux seuls à 93 milliards par an en Afrique. En moyenne, la part du secteur privé dans les investissements actuellement destinés aux infrastructures est nettement plus faible dans les pays en développement que dans les pays développés, et les ressources privées pourraient ne pas répondre aux besoins en la matière si elles ne sont pas considérablement accrues (African Union et al., 2010).
En 2015, la Banque africaine de développement a créé le Fonds Afrique 50, destiné à augmenter les investissements réalisés dans les projets infrastructurels nationaux et régionaux relatifs aux secteurs de l’énergie, des transports, des technologies de l’information et de la communication et de l’approvisionnement en eau. Le Fonds vise notamment à mobiliser, aux fins du développement des infrastructures, plus de 100 milliards de dollars provenant des marchés boursiers, des réserves des banques centrales africaines et de la diaspora africaine, et octroiera des prêts au secteur privé afin d’accroître la participation de celui-ci au développement de l’économie. Ces prêts contribueront au développement des infrastructures africaines puisqu’ils bénéficieront à des projets d’investissement infrastructurel à forte rentabilité qui permettront de libérer le potentiel économique de l’Afrique.
Les données provenant du Programme de développement des infrastructures en Afrique et du Diagnostic des infrastructures nationales en Afrique montrent que les pays africains restent à la traîne des autres régions en développement si l’on compare des indicateurs infrastructurels tels que la densité du réseau routier et du réseau ferré, la densité téléphonique, la capacité de production d’énergie et le taux de couverture des services. Les pays à revenu intermédiaire inférieur et les pays disposant d’abondantes ressources naturelles pourraient répondre à leurs besoins en matière d’infrastructure en y allouant une part comprise entre 10 % et 12 % de leur PIB, ce qui est réalisable, mais les pays à faible revenu devront y consacrer 25 % à 36 % de leur PIB (World Bank, 2015b).
Les besoins liés aux autres objectifs de développement durable viennent s’ajouter aux investissements d’infrastructure, déjà importants. Selon les estimations établies avant la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, qui s’est tenue à Rio de Janeiro (Brésil) en juin 2012, l’Afrique aurait besoin de près de 200 milliards de dollars par an pour mettre en œuvre ses engagements en matière de développement durable sur les plans social, économique et environnemental (United Nations Economic Commission for Africa, 2015).
C. RÔLE DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES DANS LE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT
En 2013, les dirigeants africains se sont engagés à mettre en œuvre la vision définie dans l’Agenda 2063 (encadré 1) aux fins du développement du continent. À ce titre, ils ont adopté, en janvier 2015, un premier plan d’action sur dix ans. L’Agenda 2063 énonce sept aspirations pour l’Afrique et souligne qu’il est nécessaire que le continent devienne autonome et finance son propre développement tout en édifiant des institutions et des États responsables à tous les niveaux (African Union, 2015). Conformément à l’un des principaux objectifs, les pays africains doivent s’employer à financer leur développement en mobilisant des ressources intérieures (épargne et impôts), ainsi qu’à recourir plus souvent et dans une plus large mesure aux marchés de capitaux (marchés d’actions et marchés obligataires), tout en ne dépassant pas les limites d’un endettement viable.
Encadré 1. Agenda 2063 : L’Afrique que nous voulons
|
Conformément au Programme d’action d’Addis-Abeba, il appartient dans une large mesure aux pays en développement de financer la réalisation des objectifs de développement durable sur leur territoire, puisqu’il est prévu que « dans tous les pays, les politiques publiques et la mobilisation et l’utilisation efficace des ressources intérieures, selon le principe de l’appropriation nationale, sont un aspect essentiel de notre poursuite commune du développement durable, et donc des objectifs de développement durable », (par. 20)3. Le Programme souligne aussi que pour répondre aux besoins de financement à plus long terme, les pays en développement doivent s’employer à développer les marchés financiers nationaux, en particulier les marchés des obligations à long terme et des assurances (par. 44), et que l’emprunt est un outil important de financement des investissements indispensables à la réalisation du développement durable, y compris des objectifs de développement durable, mais que ces emprunts doivent être gérés avec prudence et que bon nombre de pays demeurent vulnérables face aux crises de la dette (par. 93). Enfin, le Programme prévoit qu’il « incombe aux pays emprunteurs de maintenir leur endettement à un niveau soutenable » et que « les prêteurs ont également la responsabilité de prêter de manière à ne pas compromettre la viabilité de la dette du pays concerné » (par. 97). L’Afrique est à la croisée des chemins dans ce domaine, car elle devra emprunter auprès de sources intérieures et extérieures alors même que les chocs extérieurs affaiblissent sa capacité d’endettement et son aptitude à assurer le service de la dette. La récente chute des prix des produits de base a eu des répercussions négatives sur les pays exportateurs et pourrait compromettre la viabilité de leur dette.
L’Agenda 2063 et le Programme d’action d’Addis-Abeba reconnaissent tous deux que pour financer le développement de l’Afrique, il est nécessaire d’accroître les capacités de mobilisation des ressources intérieures, qui sont principalement constituées par les recettes fiscales et l’épargne privée (des ménages et des entreprises). Toutefois, il ne s’agit pas uniquement de mobiliser les ressources intérieures, mais également de mettre en place des mesures d’incitation afin de retenir l’épargne intérieure dans le pays et de bien l’affecter aux activités de production. Si les recettes fiscales ont récemment augmenté, passant de 123,1 milliards de dollars en 2002 à 508,3 milliards de dollars en 2013, la majeure partie de cette augmentation est le fait des pays qui tirent une rente de leurs abondantes ressources naturelles. En revanche, les taux d’épargne privée sont restés relativement faibles en Afrique, en particulier en Afrique subsaharienne, comparés à ceux observés dans les pays d’Asie de l’Est et du Pacifique (African Capacity-Building Foundation, 2015). Dans l’optique de la mobilisation des ressources intérieures, il est également essentiel de trouver un moyen de retenir l’épargne intérieure dans le pays et dans la région pour financer l’investissement intérieur, plutôt que de la laisser sortir. D’où la nécessité de réduire les flux financiers illicites4. Il faut donc encourager le développement des marchés financiers africains et, parallèlement, accroître les possibilités d’investissement intérieur, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Par exemple, dans certains pays africains à revenu intermédiaire inférieur, la création de marchés boursiers à l’échelle nationale et régionale peut permettre de mobiliser l’épargne intérieure pour financer l’expansion des investissements et des opérations commerciales des entreprises commerciales publiques et privées5. Il est également possible d’obtenir les mêmes résultats en émettant des obligations nationales et régionales garanties par les États afin de financer le développement des infrastructures et du commerce. Pour que les ressources intérieures telles que l’épargne restent sur le continent africain, les établissements d’épargne ont besoin d’instruments nationaux dans lesquels investir leur épargne, et doivent rapprocher les profils de rémunération des risques de ces instruments nationaux de ceux des marchés financiers régionaux et internationaux. Il pourrait notamment s’agir de dépôts auprès d’institutions financières africaines telles que des banques commerciales et des banques de développement, de fonds de pension et de participations, ainsi que d’instruments de dette nationaux à rendement élevé.
En 2008, la Banque africaine de développement a lancé l’initiative des marchés financiers africains en vue de stimuler le recours aux marchés obligataires en monnaie locale en Afrique. Par l’intermédiaire de son Fonds obligataire domestique africain, elle s’emploie à faciliter la création de marchés obligataires viables en Afrique. De la même manière, la Banque de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe pour le commerce et le développement, institution créée par traité en 1985, a, entre autres missions, celle d’encourager le développement et la diversification des marchés financiers et des marchés de capitaux au sein des États membres. L’Agence de planification et de coordination du Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) souligne la nécessité de développer les marchés obligataires africains (par exemple, en encourageant l’émission d’obligations pour le financement à long terme du développement des infrastructures) dans le cadre des efforts de mobilisation des ressources intérieures consentis par les pays africains (United Nations Economic Commission for Africa and New Partnership for Africa’s Development, 2014). Les débats les plus récents concernant le déficit d’infrastructure de l’Afrique ne tiennent pas compte du rôle du secteur financier national dans le financement des infrastructures, en partie parce qu’il est difficile d’obtenir des données exactes sur les dépenses publiques consacrées aux projets infrastructurels, et parce que la plupart des gouvernements ne disposent pas d’une stratégie unique ou uniforme de financement des infrastructures nationales (Gutman et al., 2015).
L’un des messages clés du présent rapport est que les pays africains devraient exploiter les possibilités offertes par les marchés financiers et obligataires nationaux, qui constituent une nouvelle source de financement du développement, afin de réaliser leurs ambitieux objectifs de développement. Comme l’a noté l’Agence de planification et de coordination du NEPAD dans son plan stratégique pour 2014-2017, il est possible d’améliorer la mobilisation des ressources intérieures à tous les niveaux. Toutefois, la mobilisation des ressources intérieures ne constitue pas une panacée pour l’Afrique. Les pays africains ont besoin d’une panoplie de modalités de financement du développement, notamment par la dette. Ils ne peuvent pas mobiliser les ressources intérieures pour financer leurs besoins de développement sans avoir élaboré et mis en œuvre des politiques visant à diversifier, à intégrer et à développer le secteur financier, d’où la nécessité d’émettre et de diffuser des instruments de dette nationaux (UNCTAD, 2009 ; Mavrotas, 2008).
Compte tenu de la complexité des problèmes de développement rencontrés par l’Afrique, de l’ampleur de ses besoins en matière de financement du développement et de l’acuité des contraintes pesant sur les capacités, la mobilisation des ressources intérieures ne saurait à elle seule répondre à tous les besoins de financement de l’Afrique. Outre les ressources fiscales et l’épargne intérieure, il est indispensable et inéluctable que les pays africains exploitent de nouvelles sources de financement. Habituellement, l’APD joue un rôle essentiel dans le financement du développement en Afrique. Mais la part de l’APD destinée à l’Afrique dans le total des flux extérieurs a diminué (passant de 39,4 % en 2000 à 27,6 % en 2013), et les pays donateurs membres du Comité d’aide au développement ont réduit leur aide en valeur réelle, en particulier dans les pays les moins avancés, lesquels sont majoritairement africains (UNCTAD, 2015a). Seuls cinq des 28 pays donateurs se conforment à la recommandation consistant à allouer 0,7 % de leur PNB à l’APD. Cette aide, souvent imprévisible et irrégulière, entraîne des frais pour les pays africains (Canavire-Bacarreza et al., 2015). En outre, l’Afrique ne peut pas bâtir son avenir en comptant sur l’APD, qui dépend davantage des conditions imposées par les donateurs que de son propre programme de développement.
C’est pourquoi l’Agenda 2063 prévoit la réduction de la dépendance à l’égard de cette aide. Toutefois, un petit nombre de pays les moins avancés d’Afrique risquent fort de ne pouvoir remplacer l’APD. Les pays émergents comme le Brésil, la Chine et l’Inde ont augmenté les ressources financières qu’ils allouent aux pays en développement, finançant ainsi des activités publiques et des projets du secteur privé (Pigato and Tang, 2015). L’Afrique a besoin de fonds importants pour combler le déficit d’infrastructure, renforcer ses capacités de production et réaliser les objectifs de développement durable.
CHAPITRE 2
DYNAMIQUE DE LA DETTE EXTERIEURE ET VIABILITE DE LA DETTE EN AFRIQUE
Le présent chapitre traite de la dette extérieure et des problèmes actuels liés à sa viabilité en Afrique. Des définitions de la dette extérieure sont données dans la première partie. Quelques constantes de la dette extérieure sont illustrées dans la deuxième partie, puis les principaux facteurs de son gonflement y sont analysés. Les principaux déterminants de la viabilité de la dette sont exposés dans la troisième partie et les cadres de viabilité instaurés y sont analysés. Les principales constatations sont résumées dans la dernière partie.
A. DÉFINITION ET CARACTÉRISTIQUES DE LA DETTE EXTÉRIEURE
La dette extérieure totale est définie par le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale comme la dette détenue par les non-résidents (fig. 1). Elle est la somme de la dette à long terme publique, garantie par l’État et privée non garantie, de la dette à court terme et des crédits en cours auprès du FMI. La dette à court terme englobe toutes les dettes dont l’échéance initiale est d’un an au moins et les intérêts sur les arriérés de la dette à long terme (World Bank, 2015a). La dette publique et garantie par l’État, contrairement à la dette privée non garantie, comprend les engagements extérieurs à long terme des débiteurs publics, notamment des gouvernements, des subdivisions politiques (ou d’un organisme y étant rattaché) et des organismes publics autonomes, ainsi que les engagements extérieurs des débiteurs privés dont le remboursement est garanti par une entité publique (World Bank, 2015a). En revanche, la dette intérieure publique englobe les engagements des mêmes entités publiques auprès des prêteurs qui résident dans le pays. Même s’il est vrai que la dette privée peut se transformer en dette publique lorsque les débiteurs privés sont dans l’incapacité d’assurer le service de leurs dettes, le présent rapport porte essentiellement sur la dette publique (intérieure/extérieure) et sur la dette publique et garantie par l’État, et non pas sur la dette extérieure des entreprises (non garantie)6.
Source : World Bank, 2015a.
La définition de la dette extérieure – et donc celle de la dette intérieure – est controversée. La définition adoptée dans le présent rapport se fonde sur le lieu de résidence du créancier, conformément à la pratique généralement suivie par les organisations internationales telles que la CNUCED, le FMI et la Banque mondiale. La dette extérieure est ainsi définie comme la dette détenue par les non-résidents ou, lorsque celle-ci est émise dans un pays étranger et placée sous la juridiction d’un tribunal étranger, elle l’est en fonction du lieu d’émission et du droit qui régit le contrat.
La distinction entre dette intérieure et dette extérieure est de plus en plus floue
Comme l’a constaté la CNUCED (2015b), la distinction entre dette intérieure et dette extérieure est de plus en plus floue car depuis le début des années 1990, la part des prêts en devises détenus par des non-résidents dans les instruments de dette diminue au profit des obligations qui peuvent être libellées en devises mais qui sont détenues par des résidents. Par exemple, la présence des investisseurs étrangers sur les marchés nationaux d’obligations, d’actions et de biens immobiliers s’accroît rapidement dans les pays en développement, ce qui rend plus difficile toute distinction entre la dette intérieure et la dette extérieure (Akyüz, 2014). Une part considérable de la dette peut être considérée comme extérieure selon certains critères et intérieure selon d’autres (UNCTAD, 2015b). D’après Panizza (2008), la dichotomie traditionnelle entre dette intérieure et dette extérieure n’a pas de sens dans un monde de plus en plus caractérisé par l’intégration financière et l’ouverture du compte de capital. Premièrement, les pays ont de plus en plus de mal à connaître le lieu de résidence des détenteurs ultimes de leurs dettes obligataires. Deuxièmement, même si la composition de la dette est importante, les sources réelles de vulnérabilité résident dans l’inadéquation des monnaies et l’inadéquation des échéances. La division entre dette intérieure et dette extérieure n’est intéressante que si elle aide à détecter ce type de vulnérabilité. Même si le fait de privilégier la dette intérieure a des incidences positives importantes sur la gestion de la dette, les décideurs devraient se garder de tout excès (Panizza, 2008). Les pays devraient prendre soin de bien concilier les deux types de vulnérabilité (inadéquation des monnaies et inadéquation des échéances) lorsqu’il leur faut arbitrer entre dette intérieure et dette extérieure.
En Afrique, au fur et à mesure que l’intégration régionale s’intensifiera et que les flux de capitaux entre les pays s’accéléreront, la distinction entre dette intérieure et dette extérieure deviendra de plus en plus floue. En effet, les investisseurs institutionnels et privés africains seront de plus en plus nombreux à investir dans des obligations émises dans d’autres pays de la région et libellées en monnaie locale. Cette tendance accrue à la détention croisée de dettes intérieures en Afrique peut avoir des effets contagieux sur un continent qui est exposé à des chocs mondiaux et régionaux communs. Par exemple, l’incapacité d’un pays de rembourser sa dette ou d’en assurer le service suite à un choc extérieur peut avoir des incidences sur les revenus des créanciers d’autres pays.
B. CONSTANTES DE LA DETTE EXTÉRIEURE
Ampleur de la dette extérieure
Augmentation de la dette extérieure
En 2011-2013, le stock moyen annuel de la dette extérieure de l’Afrique s’élevait à 443 milliards de dollars (22 % du RNB) contre 303 milliards de dollars (24,2 % du RNB) en 2006-2009. Toutefois, cette tendance générale en valeur absolue ne reflète pas la hausse rapide de la dette extérieure qui a été observée dans plusieurs pays africains au cours des dernières années7. Le tableau 2 illustre le stock de la dette extérieure, la dette extérieure en pourcentage du RNB, la dette extérieure en pourcentage des exportations de biens et services et des revenus primaires de l’ensemble des 54 pays africains. En décembre 2015, 30 pays africains remplissaient les conditions requises pour bénéficier d’un allégement de leurs dettes au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. Trois autres pays (Érythrée, Somalie et Soudan) étaient susceptibles de remplir les conditions requises (encadré 2).
Encadré 2. Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et Initiative d’allégement de la dette multilatérale
|
En 2011-2013, le ratio dette extérieure/RNB était inférieur à 40 % dans la plupart des pays africains. En comparaison, pendant la même période, la moyenne de ce ratio s’établissait à 14,5 % en Asie de l’Est et dans le Pacifique, à 22,6 % en Asie du Sud et à 23,7 % en Amérique latine et dans les Caraïbes. Pendant la même période, le stock de la dette extérieure s’élevait à 132 milliards de dollars (19,5 % du RNB) dans les pays pauvres très endettés, contre 311 milliards de dollars (31,3 % du RNB) dans les autres pays pauvres. Les Seychelles, pays pauvre peu endetté, fait figure d’exception en Afrique car son ratio dette extérieure/RNB dépasse 200 %. Pendant la même période, le stock de la dette extérieure en pourcentage des exportations de biens et services et des revenus primaires s’est situé entre 7,2 % en Algérie, pays pauvre peu endetté, et 596,8 % à Sao Tomé-etPrincipe, pays pauvre très endetté.
Stock de la dette extérieure
En moyenne, le stock de la dette extérieure des pays africains a augmenté rapidement, soit de 10,2 % par an en 2011-2013, contre 7,8 % par an en 2006-2009. Le taux moyen de croissance annuelle de la dette extérieure de l’Afrique a dépassé 10 % dans huit pays pauvres très endettés et dans 13 autres pays pauvres. En 2011-2013, le stock de la dette extérieure a progressé plus rapidement au Mozambique (en moyenne de 30 % par an), au Cameroun (26 % par an) et au Gabon, au Nigéria, au Rwanda et aux Seychelles (24 % par an). Cette évolution est due dans une certaine mesure à des facteurs d’attraction et de répulsion tels que la dégringolade récente des prix des produits de base8 et la baisse des recettes qui en a résulté (attraction), et la crise financière mondiale. D’où une plus grande prise de risque (répulsion), ce qui a contribué à accroître l’intérêt des investisseurs pour les marchés émergents. Les investisseurs à la recherche de rendements plus élevés en Afrique – en raison d’une croissance faible dans les pays avancés et du caractère considéré comme risqué des investissements en Afrique – ont offert de nouvelles sources de financement extérieur, souvent sans conditions, dont les pays africains ont profité. Actuellement, nombre d’entre eux entrent dans une période de resserrement des conditions d’emprunt dans un contexte mondial où les perspectives de croissance des marchés émergents et l’instabilité financière sont préoccupantes (IMF, 2015a). En général, l’endettement extérieur est revenu à un niveau relativement bas dans la plupart des pays africains, en partie grâce à une forte croissance économique, à de faibles taux d’intérêt et à l’allégement global de la dette consenti à quelque 30 pays africains au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative de la dette multilatérale. En 2015, les deux initiatives avaient permis de réduire sensiblement le fardeau de la dette des pays admis à en bénéficier.
Viabilité de la dette à long terme et ratios d’endettement
Malgré la baisse du fardeau de la dette résultant des mesures d’allégement, la viabilité de la dette à long terme demeure problématique pour de nombreux pays pauvres très endettés, le ratio d’endettement de quelques-uns d’entre eux ayant augmenté rapidement au cours des dernières années (tableau 2). Pour ce qui est de la dette extérieure en pourcentage du RNB, plusieurs pays africains9 ont connu une hausse de ce ratio, si l’on compare la moyenne de la période 2006-2009 à la moyenne de la période 2011-2013, notamment 12 pays pauvres très endettés (Burkina Faso, Rwanda, Mali, Ouganda, Malawi, Sénégal, Ghana, République-Unie de Tanzanie, Bénin, Éthiopie, Niger et Mauritanie, classés par ordre croissant de hausse de ce ratio) et 7 pays pauvres peu endettés (Botswana, Cabo Verde, Kenya, Maurice, Maroc, Seychelles et Afrique du Sud). Il reste que comparer la moyenne de ces deux périodes peut être source de confusion car la plupart des pays pauvres très endettés d’Afrique ont bénéficié d’un allégement de la dette au titre de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale en 2006 et 2007. Si l’on veut connaître l’endettement après les mesures d’allégement, il est important de comparer aussi la moyenne de la période 2008-2010 à celle de la période 2011-2013, ce qui permet de constater que le ratio d’endettement a augmenté (par ordre décroissant en valeur absolue) en Sierra Leone et au Cameroun. En outre, on considère actuellement que deux pays sont surendettés, à savoir le Soudan et le Zimbabwe, et que sept autres sont classés dans la catégorie de ceux qui courent un risque élevé, à savoir le Burundi, Djibouti, le Ghana, la Mauritanie, la République centrafricaine, Sao Tomé-et-Principe et le Tchad (tableau 3). Dans huit pays (Bénin, Ghana, Malawi, Mozambique, Niger, Ouganda, Sao Tomé-etPrincipe et Sénégal), un tiers de la diminution du ratio du stock de la dette liée à l’allégement de la dette au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale a été annulé au cours des quatre années environ qui ont suivi le point d’achèvement (Lewis, 2013 ; World Bank and Management Facility, 2013). S’ils continuent à emprunter au même rythme, d’ici une dizaine d’années, ces pays risquent de retrouver le ratio dette/PIB qu’ils avaient avant les mesures d’allégement de la dette, même si la croissance économique s’améliore.
Modification de la composition de la dette : les emprunts concessionnels
Diminution de la part de la dette concessionnelle dans la dette extérieure totale
La hausse rapide des emprunts extérieurs des pays africains est caractérisée par une bien moindre concessionnalité et une évolution de la composition de la dette. En effet, la part de la dette concessionnelle (définie comme les prêts dans lesquels les dons représentent initialement 25 % ou plus du montant total) dans la dette extérieure totale de la plupart des pays africains diminue ; cela a été le cas dans plus de la moitié des 33 pays pauvres très endettés d’Afrique entre 2006-2009 et 2011-2013 (fig. 2b) et dans la plupart des pays pauvres peu endettés d’Afrique, à l’exception de quelques-uns (Djibouti, Gabon, Nigéria, Swaziland et Tunisie) qui ont enregistré une hausse entre les deux périodes citées. Cette tendance générale est due au fait que de nombreux pays africains sont devenus des pays à revenu intermédiaire, d’où une modification de la structure des sources extérieures de financement10.
La part de la dette concessionnelle dans la dette extérieure totale était inférieure à 50 % en moyenne en 2011-2013 dans seulement sept pays pauvres très endettés d’Afrique (fig. 2b), à savoir la Côte d’Ivoire (27 %), la Zambie (39 %), le Soudan (40 %), le Libéria (40 %), la République centrafricaine (43 %), le Ghana (45 %) et la République démocratique du Congo (48 %). Par contre, elle était inférieure à 50 % dans 11 des 16 pays pauvres peu endettés pour lesquels des données étaient disponibles en décembre 2015 (fig. 2a)11. Globalement, la part pondérée de la dette concessionnelle dans la dette extérieure totale de l’Afrique est tombée de 42,4 % en 2006-2009 à 36,8 % en 2011-2013.
Augmentation de la part de la dette non concessionnelle
L’augmentation des emprunts non concessionnels (fig. 6a) s’explique en partie par l’assouplissement des directives relatives aux limites d’endettement inscrites dans les programmes financés par le FMI, ce qui permet aux pays à faible revenu de s’endetter davantage pour soutenir les investissements dans les infrastructures essentielles au niveau macroéconomique dont le rendement est élevé (Prizzon and Mustapha, 2014). La diminution, dans la plupart des pays africains, de la dette concessionnelle au profit de la dette non concessionnelle, contractée notamment auprès de créanciers bilatéraux et commerciaux ainsi que sur les marchés obligataires internationaux, est préoccupante pour les pays à faible revenu car il est généralement plus difficile de rééchelonner la dette publique ou d’emprunter davantage auprès des banques commerciales qu’auprès de prêteurs multilatéraux.
Il n’en demeure pas moins que de nombreux pays africains s’efforcent de tirer parti des possibilités de financement de l’investissement public et souscrivent de plus en plus des emprunts non concessionnels (Prizzon and Mustapha, 2014). Depuis 2007, plusieurs pays pauvres très endettés ont émis des obligations souveraines libellées en dollars sur les marchés internationaux de capitaux. Selon les estimations de Te Velde (2014), les obligations émises en Afrique subsaharienne en 2013 (5,1 milliards de dollars) équivalaient à 20 % de l’aide bilatérale et à 12 % de l’investissement étranger direct dans la région.
Avant 2009, peu de pays africains émettaient des obligations souveraines ; en 2010-2012, leurs émissions ont augmenté modérément, se situant entre 1,5 milliard et 2,5 milliards de dollars par an. En 2014, elles atteignaient 6,25 milliards de dollars (fig. 3). Le stock total des obligations souveraines internationales est passé de un milliard en 2008 à plus 18 milliards de dollars en 2014 (IMF, 2014a). Quatorze pays au moins ont émis des obligations souveraines internationales (fig. 4). La tranche moyenne de ces émissions s’élevait à 1 milliard de dollars, l’échéance moyenne était de 10 ans et le rendement moyen se situait entre 5 et 10 % (Tyson, 2015). Les prêts consentis par la Banque internationale pour la reconstruction et le développement ont une échéance beaucoup plus longue (jusqu’à 20 ans) et leurs taux d’intérêt sont nettement plus faibles (taux interbancaire offert à Londres à six mois, plus une marge de 2 % fixe, variable ou minimum, en fonction du type d’instrument). Si le nombre de pays africains émettant des obligations souveraines a augmenté depuis 2010, surtout parmi les anciens pays pauvres très endettés (comme la Côte d’Ivoire, l’Éthiopie, le Ghana, la République-Unie de Tanzanie, le Sénégal et la Zambie), l’Ouganda fait figure d’exception12.
Les Ministres des finances des pays africains ont décidé d’émettre des obligations sur les marchés financiers internationaux pour plusieurs raisons. Premièrement, même si leur coût est plus élevé que celui de la plupart des autres sources de financement, surtout des prêts non concessionnels accordés par les banques multilatérales de développement, ces émissions sont généralement assorties de conditions plus favorables que les émissions d’obligations nationales en monnaie locale (IMF et al., 2013) ; les obligations internationales sont souvent assorties de peu de conditions. Deuxièmement, les émissions obligataires souveraines internationales peuvent servir de référence pour établir le prix des obligations émises par les entreprises sur les marchés internationaux, allongeant la courbe des rendements dans le temps13, et peuvent contribuer à accroître la présence du secteur privé et des entreprises publiques (Prizzon and Mustapha, 2014). Troisièmement, les obligations souveraines internationales, dont le montant moyen – soit 1 milliard de dollars – est beaucoup plus élevé que celui de toute autre source extérieure de financement des gouvernements, aident à financer les infrastructures. Quatrièmement, plus récemment, elles ont servi à compenser la baisse des revenus provenant des produits de base et à maintenir le niveau de consommation.
Le service des obligations souveraines internationales est néanmoins problématique et risqué dans l’optique d’une gestion prudente de la dette, notamment en raison de l’existence de risques de taux d’intérêt et de risques de change ainsi que de la complexité des processus de restructuration de la dette. Par exemple, il y a peu encore, les obligations souveraines internationales sursouscrites en Afrique tiraient parti de la persistance de taux d’intérêt faibles sur les marchés financiers internationaux, ce qui rendait ces instruments plus attrayants aux yeux des investisseurs. En cas de hausse des taux d’intérêt internationaux, le rééchelonnement de la dette14 pourrait ne pas être aussi facile qu’auparavant et les investisseurs pourraient s’intéresser davantage à d’autres instruments et marchés (Sy, 2013). Par exemple, en 2013, le Ghana a lancé une émission obligataire en devise, assortie d’un coupon de 7,8 %. Les taux d’intérêt sur la dette intérieure sont beaucoup plus élevés car ils se situent en moyenne entre 19 et 23 % (encadré 3). Toutefois, si l’on tient compte de la dévaluation du taux de change (14 % par an environ depuis 2007), l’écart nominal entre les deux taux (dette intérieure et obligations libellées en devises) est beaucoup plus faible (te Velde, 2014). De même, la dette liée aux obligations souveraines internationales sera peut-être plus difficile à restructurer que les prêts bancaires. En effet, ces émissions étant ouvertes à des investisseurs et à des banques d’affaires, les créanciers sont beaucoup plus nombreux à devoir se concerter en cas de défaut de paiement, rendant probablement nécessaire l’introduction de clauses d’action collective.
Encadré 3. Émissions obligataires souveraines internationales au Ghana
Après les Seychelles et l’Afrique du Sud, le Ghana a été le troisième pays africain à se tourner vers les marchés internationaux pour financer son déficit. En 2007, il a émis pour 750 millions de dollars d’euro-obligations assorties d’un taux d’intérêt de 8,5 %. En juillet 2013, il a lancé une nouvelle émission d’euro-obligations de 1 milliard de dollars assortie d’un taux d’intérêt de 8,125 % (et d’une échéance de 12 ans). En octobre 2014, l’agence de notation Standard and Poor’s (2014) a abaissé de B à B- la cote de crédit du pays pour la dette souveraine à long terme en monnaie locale et en devises. En octobre 2015, le Ghana a émis à nouveau pour 1 milliard de dollars d’euroobligations assorties d’un taux d’intérêt de 10,75 % (et d’une échéance de 15 ans), qui a été sursouscrite à 100 % après que la Banque mondiale eut garanti partiellement les obligations à hauteur de 400 millions de dollars.
Si on les compare aux emprunts concessionnels extérieurs qui sont habituellement contractés par le Ghana à des taux beaucoup plus faibles, on constate que ces euro-obligations bouleversent la manière dont le pays finance son déficit. Par exemple, si la première émission d’obligations représentait 14,7 % de l’encours total de la dette extérieure en 2007, les 8,5 % d’intérêts servis sur les obligations comptaient pour 39,1 % dans le total des remboursements d’intérêts de la dette extérieure en 2008. La figure 5a illustre la forte augmentation des financements extérieurs. Les emprunts intérieurs ont aussi progressé au même rythme en 2011-2015. En 2015, le ratio dette/PIB atteignait 71 %.
La dépréciation de la monnaie est particulièrement problématique pour la dette extérieure (concessionnelle et non concessionnelle) ; dans le cas du Ghana, elle a été forte. Lorsque le pays a lancé sa première émission obligataire en 2007, un cedi était pratiquement égal à un dollar (suite à la création du nouveau cedi en 2007). En octobre 2015, 1 cedi valait 0,026 dollar seulement. En d’autres termes, le coût des euro-obligations, d’un montant initial de 750 millions de dollars en 2007, s’élevait en 2015 à 3 milliards de dollars environ pour les finances publiques.
Même si les euro-obligations sont assorties de taux d’intérêt beaucoup plus élevés que les traditionnels emprunts concessionnels extérieurs, elles sont plus avantageuses que la dette intérieure car leurs taux d’intérêt sont beaucoup moins élevés. Selon Standard and Poor’s (2014), en octobre 2014, les taux d’intérêt moyens pondérés sur la dette publique libellée en cedis s’élevait à 24 % par an sur les bons du Trésor à 91 jours et à 23 % sur les bons du Trésor à 182 jours. La figure 5b illustre le montant élevé des remboursements d’intérêts de la dette intérieure.
En février 2015, le Ghana a conclu un accord avec le FMI en vue d’obtenir un prêt de 1 milliard de dollars destiné à soutenir une économie qui s’essoufflait sous l’effet de la baisse du prix des exportations de produits de base (or et cacao), de la hausse des déficits commerciaux et budgétaires et de l’augmentation rapide de la dette (Tafirenyika, 2015).
Composition de la dette publique et garantie par l’État
La part des créanciers privés dans la dette publique et garantie par l’État est en hausse aussi bien dans les pays pauvres très endettés que dans les autres pays pauvres. Les créanciers de la dette publique et garantie par l’État se répartissent entre créanciers publics (prêts multilatéraux octroyés par des organisations internationales et prêts bilatéraux accordés par des gouvernements) et créanciers privés (émissions publiques ou placements privés d’obligations, prêts commerciaux de banques privées et d’autres établissements financiers privés et autres créanciers privés), comme le montre la figure 1.
Les figures 6a et b illustrent la répartition de la dette publique et garantie par l’État par catégorie de créancier en 2005-2013. La dette publique et garantie par l’État qui est détenue par les créanciers privés n’a pas seulement augmenté en valeur absolue dans les pays pauvres très endettés (9 milliards de dollars en 2005 contre 20 milliards de dollars en 2013) et dans les autres pays pauvres (43 milliards de dollars en 2005 contre 91 milliards de dollars en 2013), elle s’est aussi diversifiée. La part des créanciers privés dans la dette publique et garantie par l’État est en hausse depuis 2005 : elle est passée de 8 à 18 % du stock total de la dette extérieure des pays pauvres très endettés en Afrique et de 31 à 44 % de celui des autres pays pauvres. Dans l’ensemble de l’Afrique, la part pondérée des créanciers privés dans la dette publique et garantie par l’État a progressé, atteignant 24,9 % en 2011-2013 contre 17,6 % en 2006-2009. En outre, les obligations ont gagné en importance dans les pays pauvres peu endettés d’Afrique : elles représentaient 44 % de la dette détenue par les créanciers privés en 2005 contre 73 % en 2013. C’est toutefois l’Afrique du Sud qui est principalement à l’origine de cette évolution. Si l’on exclut ce pays, la part des obligations dans la dette privée s’est établie à 48 % en 2013, contre 30 % en 2005. Dans les pays pauvres très endettés d’Afrique, la part des créanciers privés, qui était de 24 % en 2005, a atteint un sommet, à 42 % en 2007 ; puis a enregistré un creux à 16 % en 2011 avant de remonter à 25 % en 2013.
Si l’on s’intéresse à la situation de chaque pays, en 2011-2013, la part des créanciers privés dans la dette publique et garantie par l’État a dépassé 30 % en Afrique du Sud (95 %, soit la part la plus élevée, surtout sous la forme d’obligations), suivie du Gabon (63 %, surtout sous la forme d’obligations), de l’Angola (48 %, surtout sous la forme de créances auprès de banques commerciales), du Congo (39 %, surtout sous la forme d’obligations et de créances auprès de banques commerciales) et du Ghana (32 %, surtout sous la forme de créances auprès de banques commerciales). Aucun créancier privé ne détenait de dettes publiques et garanties par l’État dans sept pays, qui sont tous des pays pauvres très endettés, à savoir le Bénin, les Comores, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Niger et l’Ouganda.
Échéance et taux d’intérêt
Dégradation des conditions des nouveaux emprunts des pays pauvres très endettés
En 2011-2013, la part de la dette à court terme (échéance à un an ou moins) dans la dette extérieure totale est restée faible dans la plupart des pays africains, allant de 0 % au Lesotho et au Nigéria (pays pauvres peu endettés) ainsi qu’au Burkina Faso et au Sénégal (pays pauvres très endettés) à plus de 25 % au Bénin, en Somalie et au Zimbabwe. Toutefois, la part de la dette publique à long terme dans la dette extérieure totale est tombée dans 31 pays (dont 11 étaient des pays pauvres peu endettés) entre 2006-2009 et 2011-2013. D’où le poids croissant de la dette privée à long terme en tant que source de financement des pays africains. C’est à Maurice que la chute a été la plus brutale (de 75 % à 14 %), suivie de l’Algérie et du Swaziland, parmi les pays pauvres peu endettés. Dans les pays pauvres très endettés, une forte diminution (de plus de 20 %) a été constatée au Bénin, au Burundi, en République centrafricaine et au Togo. Depuis 2005, les pays pauvres très endettés d’Afrique ont, en moyenne, vu se raccourcir l’échéance et le délai de grâce des nouveaux emprunts extérieurs contractés au titre de la dette publique et garantie par l’État15.
Le taux d’intérêt moyen sur les nouveaux emprunts extérieurs (dette publique et garantie par l’État seulement) des pays pauvres très endettés d’Afrique a également augmenté – alors qu’il est resté inférieur à la moyenne dans les pays pauvres peu endettés et dans les pays à faible revenu (fig. 7c) – car la part des emprunts concessionnels y diminue. En outre, depuis 2007, plusieurs pays pauvres très endettés se sont tournés vers les marchés internationaux de la dette et ont emprunté à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que ceux des prêts consentis par l’Association internationale de développement. Dans le même temps, les pays pauvres très endettés bénéficieront de taux d’intérêt moins élevés que les pays pauvres peu endettés car ils continueront de contracter davantage d’emprunts concessionnels que ces derniers. Toutefois, comme l’illustrent les figures 7a et b, l’échéance et le délai de grâce n’ont guère été modifiés dans les pays pauvres peu endettés : ils ont augmenté en 2008-2010 avant de diminuer au cours des trois années suivantes. Par contre, le taux d’intérêt est tombé de 3,25 % en 2005-2007 à 1,87 % en 2011-2013 (fig. 7c). Cela était prévisible car les taux d’intérêt réels mondiaux ont sensiblement baissé depuis les années 1980.
Hausse de la part du stock de la dette extérieure à taux variable dans le stock total de la dette extérieure (y compris la dette privée non garantie) dans certains pays peu endettés d’Afrique
Entre 2006-2009 et 2011-2013, la part du stock de la dette extérieure à taux variable dans le stock total de la dette extérieure a augmenté de 10 points de pourcentage au moins dans certains pays pauvres peu endettés, à savoir : l’Angola, le Botswana, le Gabon, l’Égypte, Maurice et le Zimbabwe (tableau 4). Parmi les pays pauvres très endettés, seule l’Éthiopie se trouvait dans ce cas.
Composition de la dette en devises
Un autre indicateur présentant un intérêt pour savoir si les pays africains sont exposés à des risques potentiels liés à la dette est la composition de la dette publique et garantie par l’État en devises. Les pays africains ont des dettes en dollars, en euros, en francs suisses, en livres sterling, en yens et en droits de tirage spéciaux, ainsi que dans de nombreuses autres monnaies. Plus le stock de la dette libellée dans une devise donnée est élevé, plus le pays africain concerné est vulnérable au risque de taux de change et à des chocs macroéconomiques et politiques potentiels provenant du pays de la devise concernée.
En 2011-2013, seuls le Swaziland et le Zimbabwe détenaient plus de 20 % de leur dette extérieure totale dans plusieurs devises autres que le dollar, l’euro, le franc suisse, la livre sterling, le yen et les droits de tirage spéciaux. La dette de quelques pays (de pays pauvres très endettés tels que le Botswana, Djibouti et l’Afrique du Sud et de pays pauvres très endettés tels que le Bénin, le Burkina Faso, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Mali, la Mauritanie et le Togo) était libellée, à hauteur de 40 % au moins du total, dans une série d’autres monnaies. Parmi les pays qui ont nettement accru la sensibilité de leur dette à une seule devise entre 2006-2009 et 2011-2013 (hausse de près de 20 % de la part de la dette extérieure totale de la devise considérée) figurent Cabo Verde et Sao Tomé-et-Principe (importance accrue de la dette en euros) et le Congo, le Libéria et la Zambie (importance accrue de la dette en dollars).
Le ratio réserves totales/stock total de la dette extérieure peut servir d’indicateur de l’aptitude d’un pays à faire face soit à une évolution défavorable des marchés de la dette comme une hausse brutale des remboursements d’intérêts consécutive à une dépréciation de la monnaie locale par rapport aux devises, soit à un choc mondial tel que la chute des prix des produits de base, qui, l’une ou l’autre, se répercutent sur le service de la dette assuré par les recettes à l’exportation. Parmi les pays qui affichent un ratio inférieur à 30 % figurent des pays pauvres peu endettés comme Maurice (28 %) et le Zimbabwe (7 %) et des pays pauvres très endettés comme la République démocratique du Congo (26 %), l’Érythrée (11 %), la Guinée (9 %), le Malawi (20 %), la Mauritanie (23 %), Sao Tomé-et-Principe (26 %) et le Soudan (1 %). Dans le cadre de leur politique de gestion de la dette, les pays africains devaient continuer de s’efforcer en priorité de conserver des réserves suffisantes pour faire face à une évolution défavorable et inattendue de la dette et des marchés d’exportation.
La persistance d’un déficit des comptes courants pourrait rendre plus probable le surendettement
Une analyse détaillée du ratio dette extérieure/PIB de 17 pays pauvres très endettés et de 13 pays pauvres peu endettés pour lesquels des données étaient disponibles (c’est-à-dire entre 2005-2006, lorsque les initiatives d’allégement de la dette ont été lancées, et 2012-2013, période la plus récente) permet de constater que ce ratio a diminué de 14,9 points de pourcentage en moyenne en 2005-2006 et a augmenté de 1,7 point de pourcentage en 2012-2013 dans l’ensemble des 30 pays concernés. Cette hausse récente peut être décomposée de la manière suivante : environ 7,3 points de pourcentage correspondant au déficit des comptes courants sans intérêts et 0,5 point de pourcentage aux remboursements d’intérêts, que viennent compenser une croissance du PIB de 1,8 % et un élément résiduel de 4,3 % (qui prend en compte les effets de tous les autres facteurs tels que l’allégement de la dette et peut s’avérer soit négatif soit positif). On obtient les mêmes résultats si l’on analyse uniquement les 17 pays pauvres très endettés. Le ratio dette extérieure/PIB a diminué de 25,6 points de pourcentage en 2005-2006, mais a progressé légèrement de 0,7 point de pourcentage en 2012-2013, essentiellement en raison du déficit des comptes courants sans intérêts (11,4 %).
Le déficit des comptes courants a contribué à la dynamique récente de la dette extérieure en Afrique, les problèmes de balance des paiements étant liés au gonflement rapide de dette extérieure dans certains cas (Battaile et al., 2015). D’où la nécessité de suivre de près la sensibilité de la dette des pays africains aux récents chocs macrobudgétaires tels que la chute du prix de certains produits de base, surtout du pétrole, le ralentissement économique en Chine et la reprise timide en Europe. Selon Battaile et al. (2015), en Afrique subsaharienne, l’allégement de la dette (jusqu’en 2009) et les investissements étrangers directs ont été les principaux moteurs de la réduction de la dette dans les années 2000 alors que, dans le même temps, les déséquilibres des comptes courants contribuaient dans une large mesure à l’accroître tout au long de cette période. Si les entrées d’investissements étrangers directs peuvent contribuer à réduire la dépendance à l’égard de la dette, la hausse des paiements nets de revenus liée à ces entrées peut aussi alimenter le déficit de la balance des paiements courants et donc rendre plus nécessaire le financement de la dette. Le gonflement récent de la dette constaté dans plusieurs pays africains semble être principalement lié au déficit des comptes courants sans intérêts, aussi bien dans les pays pauvres très endettés que dans les autres pays pauvres. Comme il a été précédemment fait observer, il existe néanmoins d’autres facteurs potentiels de l’accroissement de la dette en Afrique, comme la fin du supercycle des produits de base et, au cours des dernières décennies, l’intégration plus rapide aux marchés financiers internationaux, en particulier après la crise financière mondiale.
En résumé, le gonflement récent de la dette dans plusieurs pays africains semble être principalement lié au déficit des comptes courants sans intérêts, aussi bien dans les pays pauvres très endettés que dans les autres pays pauvres. En général, résorber le déficit des comptes courants des pays en développement dont les exportations ne sont pas diversifiées peut prendre du temps, d’où la nécessité d’une transformation structurelle des exportations, voire des importations. Il est aussi plus compliqué de mener à bien ce processus que d’augmenter le taux de croissance pendant quelques années (Vaggi and Prizzon, 2014).
C. ASSURER ET MAINTENIR LA VIABILITÉ DE LA DETTE
Comme l’a indiqué la CNUCED (2015b), la structure et la composition de la dette jouent un rôle important dans la viabilité. Selon Flassbeck et Panizza (2008), différents types de dettes donnent lieu à différentes vulnérabilités et l’examen de la viabilité de la dette devrait non seulement porter sur la dette publique extérieure mais englober aussi la dette privée. Jusqu’au début des années 1990, l’accent était habituellement mis sur la dette extérieure car la dette de la plupart des pays en développement était publique et la dette publique était essentiellement extérieure. Néanmoins, au cours des dernières années, une part croissante de la dette de ces pays a été émise soit par des emprunteurs privés soit sous forme de dette intérieure soit les deux, comme cela a été constaté pour les pays africains dans la section B. Idéalement, les différentes dimensions de la dette devraient être prises en compte et le niveau de risque devrait être évalué pour chacune d’elle. Les trois principales dimensions sont les suivantes : échéance et monnaie, type de prêteur et type d’emprunteur.
S’agissant de la première dimension, la dette à court terme et la dette en devises présentent généralement plus de risques que la dette intérieure à long terme pour les emprunteurs. Si la présence d’investisseurs étrangers peut jouer un rôle important, en particulier sur les marchés boursiers, ce sont les marchés obligataires qui sont les plus susceptibles d’être touchés (Akyüz, 2014). Pour ce qui est de la deuxième dimension, les prêts des créanciers publics font courir moins de risques que ceux des créanciers privés car ce sont des sources de financement plus stables et moins exposées à une contagion financière. En ce qui concerne la troisième dimension, la dette publique présente plus de risques que la dette privée en raison de ses incidences budgétaires, même si cette dernière peut aussi poser des problèmes budgétaires sous forme de passifs éventuels (Flassbeck and Panizza, 2008). En procédant à une analyse empirique des facteurs susceptibles d’accroître les probabilités de survenue d’une crise de la dette, Flassbeck et Panizza (2008) constatent que les probabilités sont plus fortes si la dette publique extérieure est contractée auprès de créanciers privés en devises alors qu’elles sont plus faibles si la dette publique est intérieure et encore plus faibles si la dette extérieure est détenue par des créanciers publics16. Les résultats ne sont, pas concluants dans le cas de la dette privée. Idéalement, l’analyse de la viabilité de la dette devrait prendre en compte le niveau de risque des différentes composantes de la dette.
Revoir les cadres de viabilité de la dette
En 2005, le FMI et la Banque mondiale ont lancé conjointement le Cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu17, qui vise à aider ces pays à assurer la viabilité de leur dette lorsque de nouveaux emprunts concessionnels sont contractés auprès de créanciers publics (World Bank and IMF, 2014). Les trois principaux objectifs du Cadre sont les suivants : guider les décisions d’emprunt des pays à faible revenu de façon à adapter leurs besoins de financement à leur capacité de remboursement actuelle et future, en tenant compte de la situation de chaque pays ; donner des conseils concernant les décisions des créanciers en matière de prêts et de dons afin de veiller à ce que des ressources soient allouées aux pays à faible revenu selon des modalités compatibles avec la réalisation progressive de leurs objectifs de développement et la viabilité à long terme de la dette ; aider à déceler des crises potentielles de manière précoce afin de pouvoir prendre des mesures préventives. Le Cadre fait l’objet d’une révision qui pourrait s’avérer importante (World Bank and IMF, 2015). Il permet de procéder régulièrement à des analyses de la viabilité de la dette qui consistent en :
- Une analyse de l’endettement projeté d’un pays au cours des vingt prochaines années et de sa vulnérabilité à des chocs extérieurs et à des changements de politique (élaboration de scénarios de référence et de survenue de chocs) ;
- Une évaluation du risque de surendettement pendant cette période, en fonction de seuils d’endettement indicatifs qui dépendent de la qualité de la politique et des institutions nationales (tableau 5) ;
- La formulation de recommandations sur une stratégie d’emprunt (et de prêt) qui limite le risque de surendettement.
Le Cadre analyse aussi bien la dette extérieure que la dette du secteur public. Les taux d’intérêt et le délai de remboursement des prêts aux pays à faible revenu variant beaucoup, il s’intéresse à la valeur actuelle nette des dettes afin de permettre des comparaisons dans le temps et entre les pays, bien que celles-ci risquent d’être faussées par le recours à des taux d’actualisation à court terme propres à chaque devise. Afin d’évaluer la viabilité de la dette, les indicateurs d’endettement sont comparés à des seuils indicatifs sur une période de projection de plus de vingt ans. Si l’indicateur d’endettement dépasse le seuil indicatif, il y a un risque que le pays concerné connaisse une forme de surendettement (tableau 3). Le Cadre permet de classer les pays dans l’une des trois catégories de risque (faible, modéré et élevé) en fonction de l’indice d’évaluation de la politique et des institutions nationales18 et des différents seuils indicatifs d’endettement définis pour chaque catégorie (tableau 5).
Les seuils correspondant aux pays dont la politique est jugée bonne conformément au Cadre sont les plus élevés, ce qui laisse suggérer que dans ces pays, un gonflement de la dette est moins risqué. Malgré diverses améliorations apportées aux cadres et analyses de viabilité depuis les années 1990, beaucoup considèrent que le Cadre est trop mécanique et rétrospectif et bien trop restrictif car il ne différencie pas assez les dépenses publiques d’équipement des dépenses publiques récurrentes (UNCTAD, 2004). Dans de nombreux pays africains, il est toujours difficile de concilier l’accroissement de la dette extérieure destiné à financer les stratégies nationales de développement et les objectifs de développement durable et le maintien de la viabilité de la dette. Par exemple, on pourrait améliorer le Cadre en autorisant les pays africains qui en ont besoin à accroître dans une certaine mesure le financement par la dette afin de se rapprocher desdits objectifs sans tomber dans le surendettement.
Certains pays africains à faible revenu craignent que le Cadre les enferme dans un scénario d’endettement et de croissance faibles. En particulier, dans la plupart des pays à faible revenu, il est intrinsèquement problématique de concilier le financement par la dette dans le cadre des stratégies nationales de développement visant à atteindre les objectifs de développement durable et le maintien de la viabilité de la dette. La préoccupation que suscite ce scénario d’endettement et de croissance faibles a été mise en lumière par le nouveau consensus qui se dégage depuis le milieu des années 2000 entre les donateurs, qui estiment que les pays ayant bénéficié d’un allégement au titre de l’Initiative d’allègement de la dette multilatérale ne devraient pas cumuler de nouvelles dettes dans un avenir proche même si leur niveau d’endettement est inférieur aux seuils du nouveau cadre. Toutefois, les restrictions sur les financements concessionnels ont été, pour de nombreux pays africains à faible revenu, un facteur important d’accroissement des emprunts intérieurs et, comme il a déjà été indiqué, certains pays africains à faible revenu ont aussi commencé à contracter des emprunts concessionnels sur les marchés internationaux de capitaux.
La figure 8 compare les seuils d’endettement et le taux d’endettement de la moyenne des pays pauvres très endettés d’Afrique en 2000-2013 afin d’illustrer le caractère restrictif des seuils d’endettement. Étant donné qu’il y a une grande disparité entre les taux d’endettement des pays pauvres très endettés, les moyennes ne sont pas représentatives même si elles donnent quand même des indications. Les figures 8c et e présentent des informations sur les indicateurs du service de la dette. Pendant la période considérée, on observe qu’aucune des moyennes n’a jamais dépassé les seuils d’endettement, pas même dans les pays dont la politique était qualifiée de médiocre. Par contre, les figures 8a, b et c montrent que les indicateurs moyens de la valeur actuelle nette de la dette étaient, dans la plupart des cas, inférieurs aux seuils des pays dont la politique était jugée moyennement satisfaisante ou bonne. Enfin, comme l’illustrent les figures 8d et e, aucune des moyennes ne s’est approchée du seuil des pays dont la politique était considérée comme médiocre selon les critères du Cadre. Il pourrait s’ensuivre que les seuils sont devenus moins contraignants au début des années 2010, c’est-à-dire que les pays pauvres très endettés ont été en mesure d’emprunter davantage car leurs taux d’endettement étaient inférieurs aux seuils. La hausse des indicateurs d’endettement et le fait que beaucoup de ces pays ont été depuis peu versés dans la catégorie des pays à taux d’endettement élevé suggèrent que nombre d’entre eux ont emprunté de manière plus active au cours des dernières années. Toutefois, les difficultés liées à la dette ne sont pas uniquement dues à l’excès d’emprunts ; la modification des taux de change ou des termes de l’échange et la survenue de chocs exogènes sont autant de facteurs qui peuvent entraîner une hausse soudaine des ratios d’endettement.
Il pourrait s’avérer nécessaire de revoir les cadres actuels de viabilité de la dette à la lumière des besoins croissants de financement du développement des pays africains et des pays en développement en général, surtout depuis l’adoption des objectifs de développement durable. Il est clair que le dilemme est de savoir comment atteindre ces objectifs tout en préservant la viabilité de la dette et si cela est possible. Il y a plus de dix ans, dans un rapport sur ce sujet, le Secrétaire général a proposé de redéfinir la viabilité de la dette comme le niveau d’endettement qui permettrait à un pays de réaliser les objectifs du Millénaire pour le développement tout en constatant en 2015 que son ratio d’endettement n’avait pas augmenté (United Nations, 2005). Aujourd’hui aussi, il faut faire en sorte que le Cadre de viabilité de la dette soit cohérent avec les objectifs de développement durable qui viennent d’être adoptés. Il faut également préciser quelle est la finalité du Cadre par rapport auxdits objectifs (par exemple, en incluant des scénarios sur les objectifs, en fonction des fonds nécessaires et des sources de financement probables). Il est possible d’améliorer le Cadre afin d’autoriser une hausse modérée du financement par la dette qui permettrait aux pays africains de se rapprocher de ces objectifs sans tomber dans le surendettement, en :
- Adaptant les investissements aux objectifs susmentionnés : le Cadre revisité devrait comporter de meilleurs systèmes de suivi de l’utilisation qui est faite de la dette, en veillant à ce que les pays empruntent pour financer des investissements productifs, plutôt que la consommation, et atteindre ces objectifs ;
- Accordant une plus grande importance au plafonnement du service de la dette : Si, dans la viabilité de la dette des pays à faible revenu, l’accent était mis sur les remboursements au titre du service de la dette par rapport aux recettes publiques et si les remboursements de ces pays étaient plafonnés, en réduisant proportionnellement les remboursements à tous les créanciers, y compris les créanciers commerciaux, la situation de ces pays s’améliorerait sensiblement. Il faudrait inscrire la limite fixée au service de la dette dans une clause d’action collective contraignante19. Étant donné que l’on ne sait jamais si un problème de dette est dû à un manque passager de liquidités ou à un surendettement plus permanent, le service de la dette pourrait être plafonné à titre temporaire sans réduire le stock total de la dette. En cas de surendettement à plus long terme avéré, une réduction du stock de la dette serait nécessaire.
Une réforme du Cadre pour les pays à faible revenu se justifie, surtout afin de financer la réalisation des objectifs de développement durable et la mise en œuvre de stratégies nationales et régionales de développement en Afrique. À côté des problèmes et contraintes déjà mentionnés, il existe d’autres enjeux plus fondamentaux concernant l’indice d’évaluation de la politique et des institutions nationales (Gunter, à paraître) et la logique de modélisation sous-jacente du Cadre (Guzman and Heymann, 2015). Il est possible d’améliorer le cadre de la manière qui suit :
- Il est nécessaire de renforcer l’évaluation de la dette publique totale. Actuellement, seule la dette publique extérieure est officiellement notée, pas la dette publique totale, ce qui pose un problème particulier compte tenu de l’hétérogénéité des pays à faible revenu en Afrique et de l’importance croissante de la dette intérieure (chap. 3). Il faut aussi mieux prendre en compte les risques liés à l’accès aux marchés tels que les risques de refinancement, qui ne sont que partiellement intégrés dans les indicateurs du service de la dette, et les risques liés à la dette publique ;
- Le Cadre devrait mieux appréhender les risques liés aux passifs éventuels (Guzman and Heymann, 2015)20. Le principal problème a trait à l’absence de données disponibles et au manque de fiabilité, ainsi qu’au peu de recul dont on dispose au sujet des risques liés aux partenariats public-privé (chap. 4). Le Cadre doit aussi mieux prendre en compte les risques liés aux catastrophes naturelles, auxquelles les pays à faible revenu sont souvent les plus vulnérables ;
- Il sera peut-être nécessaire de réajuster, en fonction des projections macroéconomiques de croissance et de la dynamique de la dette dans les pays à faible revenu, les modèles du Cadre qui pourraient surestimer de manière systématique les capacités de remboursement de la dette (Guzman and Heymann, 2015). Les seuils de la dette extérieure axés sur l’indice d’évaluation de la politique et des institutions nationales ont été critiqués au motif qu’ils s’efforçaient de mesurer un trop grand nombre de variables qui n’avaient rien à voir avec la capacité de remboursement de la dette des pays (Ferrarini, 2008). De plus, les données propres à chaque pays ne sont pas prises en compte dans le calcul des seuils, de légères différences dans les résultats de l’indice d’évaluation de la politique et des institutions nationales peuvent aboutir à des écarts importants entre les seuils (Gunter, à paraître).
Mécanismes d’allégement et de restructuration de la dette multilatérale
Le remboursement de la dette dépend de la croissance et du développement du pays débiteur, ce qui implique que la viabilité de la dette devrait être importante non seulement pour le débiteur, mais aussi pour ses créanciers. Si les cadres de viabilité de la dette s’efforcent de prévenir le gonflement de la dette, les mécanismes d’allégement et de restructuration permettent de faire face, après coup, au surendettement. Le FMI envisage actuellement d’améliorer sa politique de prêt aux pays dont le surendettement provient de la dette souveraine, afin que les coûts de règlement des crises soient réduits au minimum pour les débiteurs et les créanciers et, en dernier ressort, pour le système financier international. La proposition la plus récente en cours d’examen associe les deux éléments clefs ci-après : la possibilité de reprofiler la dette, afin d’assouplir les conditions des prêts du FMI lorsque la dette du pays emprunteur est jugée viable mais pas avec une forte probabilité ; et la suppression de la dérogation systémique adoptée en 201021 afin d’autoriser un accès exceptionnel à ses ressources en cas de doute sur la fiabilité de la dette (IMF, 2014b). Aucune décision n’a été prise à ce jour sur les réformes proposées. En outre, conscient de la vulnérabilité des pays pauvres très endettés aux catastrophes naturelles et autres, le FMI a mis en place, en février 2015, un fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes qui accorde des dons permettant d’alléger la dette des pays les plus pauvres et les plus vulnérables touchés par des catastrophes d’origine naturelle ou de santé publique, notamment des épidémies. Il s’agit de mettre à disposition des ressources qui répondent aux besoins exceptionnels de balance des paiements créés par de telles catastrophes, au lieu de les affecter au service de la dette22. Trois pays touchés par l’épidémie de virus Ebola (Guinée, Libéria et Sierra Leone) ont reçu près de 100 millions de dollars d’aide de ce fonds fiduciaire en février-mars 2015.
Dans sa résolution annuelle sur la dette extérieure, l’Assemblée générale a maintes fois souligné qu’il importait de promouvoir des pratiques responsables en matière de prêts et d’emprunts souverains. Afin de commencer à combler cette lacune dans l’architecture internationale, la CNUCED a lancé, en 2009, une initiative visant à dégager un consensus sur un ensemble de principes acceptés au niveau international destiné à promouvoir des emprunts et des prêts souverains responsables car des pratiques de prêt transparentes, équitables, prévisibles, coordonnées et légitimes aideraient à promouvoir une solution juste et durable à la restructuration de la dette. Les principes relatifs à la promotion de prêts et d’emprunts souverains responsables (UNCTAD, 2012a) sont pris en compte dans le Programme d’action d’Addis-Abeba et dans la résolution 69/319 de l’Assemblée générale sur les principes fondamentaux des opérations de restructuration de la dette souveraine adoptée en septembre 2015.
D. RÉSOUDRE LES PROBLÈMES LIÉS AU GONFLEMENT DE LA DETTE EXTÉRIEURE AFIN DE RENDRE LA DETTE VIABLE
En 2011-2013, le stock de la dette extérieure de l’Afrique s’est élevé en moyenne à 443 milliards de dollars (21 % du RNB) contre 303 milliards de dollars (22,6 % du RNB) en 2006-2009. Les ratios dette extérieure/RNB sont bas puisqu’ils sont inférieurs à 40 % dans la plupart des pays africains. Toutefois, cette tendance générale occulte une remontée rapide de la dette extérieure dans plusieurs pays africains au cours des dernières années. Même si le fardeau de la dette a diminué grâce aux mesures d’allégement, la viabilité de la dette à long terme demeure un objectif difficile à atteindre pour de nombreux pays pauvres très endettés, dont quelques-uns ont vu leurs ratios d’endettement augmenter rapidement au cours des dernières années.
Comme il a été déjà constaté, l’augmentation rapide des emprunts extérieurs des pays de la région est caractérisée par une bien moindre concessionnalité et par une évolution de la composition de la dette. La part de la dette concessionnelle dans la dette extérieure totale des pays africains diminue. Compte tenu du poids croissant des sources de financement non concessionnelles, les pays africains devraient renforcer leurs capacités de gérer la viabilité de leur dette, de restreindre la fongibilité et d’accroître la responsabilité et la transparence dans l’utilisation qui est faite des fonds. Il ressort des évaluations de la gestion de la dette de 58 pays à faible revenu effectuées en 2008-2014 par la Banque mondiale que la majorité de ces pays ne remplissaient pas les conditions minimales à remplir pour que leurs pratiques soient considérées comme saines dans 7 des 15 indicateurs et que les capacités de gestion de la dette des pays à faible revenu étaient généralement insuffisantes, en particulier dans les pays pauvres très endettés (World Bank and IMF, 2015). À mesure qu’ils se financent davantage à des conditions commerciales et s’intègrent dans les marchés internationaux de capitaux, et que, dans le même temps, les réserves de liquidités diminuent, les pays africains doivent redoubler d’efforts pour accroître leurs capacités de gestion de la dette. À cet égard, les efforts entrepris par le Nigéria méritent d’être signalés. Avant de renégocier l’allégement de sa dette en 2005, ce pays a mis en place un bureau chargé du budget et un bureau de gestion de la dette, de même qu’une agence de notation de la dette intérieure (Adams, 2015). D’autres pays africains peuvent créer des capacités institutionnelles du même type en matière de notation, de suivi et de gestion de la dette, publique ou privée. Étant donné qu’une grande partie de la dette extérieure est utilisée par le Gouvernement pour financer a priori des projets de développement, une attention devrait aussi être accordée au renforcement des compétences et des capacités de planification, de gestion et d’évaluation des projets et à la réalisation d’analyses coûts/bénéfices visant à déterminer la rentabilité des investissements publics réalisés grâce à ces fonds. Tous ces efforts ont aidé le Nigéria à gérer sa dette de manière plus viable. Le Système de gestion et d’analyse de la dette de la CNUCED est un exemple d’assistance technique destinée à renforcer les capacités publiques de gestion de la dette dans les pays africains (encadré 4).
Les pays devraient non seulement conférer un pouvoir de contrôle aux commissions des affaires publiques et du budget des parlements et aux bureaux nationaux de vérification des comptes, mais aussi garantir la transparence et la responsabilité. Les parlementaires, les législateurs et les commissaires aux comptes publics devraient également exercer une surveillance stricte et exiger que les conditions de la dette et les dépenses prévues soient transparentes (Adams, 2015).
Encadré 4. Résoudre les problèmes de capacités en matière de gestion et d’analyse de la dette
Le Système de gestion et d’analyse de la dette de la CNUCED aide 23 pays africains à gérer leur dette. Par exemple, l’Ouganda gère mieux sa dette avec l’aide du Système, notamment grâce à un logiciel spécialisé de gestion et d’analyse de la dette mis au point pour répondre aux besoins opérationnels, statistiques et analytiques des gestionnaires de la dette des pays en développement. Des améliorations notables ont été apportées à la qualité de la base de données sur la dette en Ouganda, comme l’illustrent les meilleurs résultats obtenus en 2015 dans le cadre des dépenses publiques et de la responsabilité financière, contribuant ainsi à améliorer la transparence et la responsabilité, l’information sur la dette et les analyses de la viabilité de la dette. En 2015, le Gouvernement a publié son premier bulletin statistique sur la dette, qui constitue l’un des principaux aboutissements de l’assistance technique apportée et de la mise en place du dispositif d’enregistrement de la dette tiré du Système. L’Ouganda a procédé de manière indépendante à une analyse annuelle de la viabilité de la dette et a élaboré, également en 2015, une nouvelle stratégie de gestion de la dette à moyen terme, toutes deux publiées par le Ministère des finances.
Les finalités de la dette, qu’elle soit intérieure ou extérieure, sont importantes pour la croissance et pour la viabilité de la dette
Il est important de savoir si la dette est détenue par des résidents nationaux ou étrangers. La dette intérieure et la dette extérieure ont différentes incidences macroéconomiques, comme il a été souligné dans ce chapitre. Toutefois, les finalités (consommation et investissement productif) de la dette, qu’elle soit intérieure ou extérieure, influent aussi sur la viabilité de celle-ci. Par exemple, si la dette sert à financer les dépenses récurrentes, des passifs considérables peuvent s’accumuler et l’État peut avoir beaucoup de mal à assurer la viabilité de la dette, comme au Mozambique (Financial Times, 2016) et au Ghana (encadré 3). Si la dette finance des investissements qui contribuent à un renforcement des capacités productives et à une hausse future du PIB, elle permet aux pays de dégager les ressources nécessaires au remboursement et au service de leur dette. Il est encore plus important que la dette finance les investissements destinés à diversifier l’économie pour que les pays puissent faire face à des chocs extérieurs imprévisibles et acquérir la capacité de rembourser leur dette. Dans les crises de la dette qu’ont connu l’Afrique et l’Amérique latine dans les années 1980, l’endettement est devenu intolérable à la suite d’un choc extérieur (la chute des prix des produits de base pour l’Afrique et la politique de taux d’intérêt élevés de M. Volcker aux États-Unis d’Amérique, motivée par la hausse des prix du pétrole, pour l’Amérique latine) qui s’est produit après l’accumulation de dettes destinées à financer la consommation.
Chapitre 3
DYNAMIQUE DE LA DETTE INTÉRIEURE EN AFRIQUE
A. INTRODUCTION
Depuis une dizaine d’années, les pays africains comptent de plus en plus sur les marchés de la dette intérieure pour accroître leurs emprunts nets, dans la plupart des cas, par nécessité de compenser la diminution de la part de l’aide publique au développement dans les apports extérieurs totaux. Atteindre et maintenir les niveaux élevés d’investissement qui sont indispensables au développement du continent africain nécessitera de mobiliser des ressources à la fois extérieures et intérieures.
Il devrait en résulter un programme de développement que les pays pourront mieux maîtriser, des stratégies plus efficaces et des investissements orientés vers les secteurs où ils seront les plus productifs. Dans le même temps, si la dette intérieure joue un rôle de plus en plus important, les pays seront confrontés à de nouveaux risques à mesure que les créanciers et les instruments se feront plus nombreux, et la dette intérieure deviendra un critère déterminant pour évaluer la viabilité de la dette publique, compte tenu de son poids et de sa hausse rapide23. Le présent chapitre abordera les questions d’ordre général énoncées ci-après.
- Quelles sont les tendances actuelles et la dynamique de la dette publique intérieure en Afrique ?
- Quels sont actuellement les principaux facteurs de risque d’endettement intérieur et comment peuvent-ils être gérés au mieux ?
- Quelles sont les causes sous-jacentes de l’augmentation de la dette intérieure ?
Le présent chapitre met en lumière le rôle potentiel de la dette publique intérieure dans le financement du développement de l’Afrique, les caractéristiques de la dette publique intérieure des pays africains et son évolution, l’opposition entre dette intérieure négociable et dette intérieure non négociable, la typologie de la dette publique intérieure par échéance et par détenteur et les charges d’intérêt. Il traite aussi du gonflement de la dette publique et des facteurs d’endettement intérieur. Les données actuellement disponibles sur la dette africaine restant insuffisantes pour comparer un grand nombre de pays sur une longue période, la présente analyse porte seulement sur cinq pays (le Ghana, le Kenya, le Nigéria, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie), dont la dette intérieure fait l’objet d’une étude détaillée.
Définition de la dette publique intérieure
En accord avec l’édition de 2013 de la publication « Statistiques de la dette du secteur public : Guide pour les statisticiens et les utilisateurs » et avec le référentiel utilisé par les pays africains pour enregistrer et notifier leurs données statistiques, la dette intérieure est définie dans le présent rapport selon le critère de résidence (chap. 2), ce qui contribue de manière efficace et pertinente à l’étude des transferts de ressources entre résidents et non-résidents (Panizza, 2008). Dans la pratique, cette définition est toutefois difficilement applicable aux instruments de dette négociables, car elle suppose de vérifier régulièrement l’identité des créanciers finaux. Aux fins du présent rapport, le statut de résident est déterminé à la date d’émission sur le marché primaire. En ce qui concerne les instruments et les institutions visées, l’analyse est limitée aux engagements financiers intérieurs par émission de titres des administrations centrales de cinq pays (Ghana, Kenya, Nigéria, République Unie de Tanzanie et Zambie). Les données relatives à la dette publique intérieure sont extraites de différents rapports nationaux (par exemple, rapports annuels des banques centrales), de bases de données des services nationaux chargés de la dette et de rapports de pays du FMI.
B. AUGMENTATION DE LA DETTE INTÉRIEURE
Les marchés de la dette intérieure pourraient jouer un rôle plus important dans le financement du développement de certains pays africains.
Premièrement, comme il ressort de la figure 9a, l’Afrique, dont le PIB progresse en moyenne de plus de 4 % par an depuis 2000, fait partie des régions du monde à la croissance la plus rapide. Depuis 2007, seule l’Asie en développement l’a supplantée. Toutefois, en raison de la baisse des prix des produits de base, conjuguée au recul de la demande mondiale, ce rythme de croissance pourrait être difficile à maintenir (World Bank and IMF, 2015). La croissance économique africaine s’est accompagnée d’un taux d’inflation faible et stable, qui est resté à un chiffre dans la plupart des pays. En outre, le nombre de pays à revenu intermédiaire, c’est-à-dire dont le revenu annuel par habitant est supérieur à 1 000 dollars, a augmenté sur le continent.
Deuxièmement, certains pays africains ont pris des mesures pour développer leurs marchés de la dette intérieure et ont bénéficié à cet égard du soutien actif d’institutions financières internationales telles que la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, le FMI et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le FMI et la Banque mondiale ont lancé une initiative conjointe qui doit aider les pays à se doter de marchés obligataires en instaurant des stratégies efficaces de gestion de la dette à moyen terme qui participent à l’objectif de viabilité (Adelegan and Radzewicz-Bak, 2009). En 2010, la Banque africaine de développement a créé un fond obligataire africain afin de contribuer à la mise en place de marchés de la dette intérieure robustes. Ce fonds accueille les investissements sous la forme d’obligations souveraines et d’obligations infranationales garanties par les États, libellées en monnaie locale. En 2012, la Société financière internationale a engagé un programme d’émission d’obligations, dit « programme panafricain d’émission de bons à moyen terme négociables », d’abord en Afrique du Sud, au Botswana, au Ghana, au Kenya, en Ouganda et en Zambie, dans le but de promouvoir et de faire croître les nouveaux marchés financiers de la région, et d’améliorer les disponibilités de financement en monnaie locale pour le développement du secteur privé. En novembre 2011, le Groupe des Vingt a adopté un plan d’action en faveur des marchés d’obligations en monnaie locale dans les pays émergents et les autres pays en développement. Il a invité les organisations internationales à apporter leur concours à la collecte de données et aux travaux analytiques concernant ces marchés, de manière à définir un cadre commun de diagnostic ou un ensemble d’outils permettant aux autorités locales d’analyser l’état des marchés obligataires de leur pays et de déterminer les priorités en matière de réforme (IMF et al., 2013). En outre, veiller au bon développement des marchés de la dette intérieure est devenu un objectif de premier plan pour beaucoup de pays. Un certain nombre d’entre eux ont d’ailleurs fait des progrès notables pour diversifier leur base d’investisseurs, allonger les échéances et renforcer l’infrastructure des marchés.
Troisièmement, selon la CNUCED (2015c), on note des améliorations dans le développement du secteur financier et l’accès aux services bancaires entre 2011 et 2014. La capacité d’absorption et la couverture des systèmes financiers (mesurées par les indicateurs classiques du développement financier, comme le ratio « masse monétaire au sens large (monnaie et quasi-monnaie ou M2)/PIB » et le ratio « crédit au secteur privé/PIB ») se sont peu à peu renforcées, mais leurs niveaux initiaux étaient faibles. Cela étant, ces améliorations sont davantage le fait des pays à revenu intermédiaire que des pays à revenu inférieur, qui n’ont encore qu’un accès limité aux services financiers. De plus, certains groupes, notamment les populations rurales et les femmes, restent en grande partie exclus des services financiers formels. En Afrique, seulement 20 % des femmes y ont accès (UNCTAD, 2015c). La capacité d’absorption des marchés financiers africains, mesurée par le ratio M2/PIB, est présentée à la figure 9b. Elle est très élevée dans le cas de l’Afrique du Sud, de l’Égypte et de Maurice, dont les marchés financiers ont contribué à l’émission fructueuse et généralisée d’instruments de la dette intérieure, y compris de la part du secteur privé. Les services bancaires sont également devenus plus accessibles ces dernières années, comme il ressort de la hausse spectaculaire du taux de bancarisation qui a progressé de 20 % en 2011-2014, notamment en Afrique orientale et australe (IMF, 2015a). Or, grâce à un secteur financier solide et performant, il devient possible de mobiliser l’épargne et d’exploiter le potentiel des marchés de la dette intérieure pour combler l’énorme déficit de financement du continent africain.
Quatrièmement, les marchés africains d’obligations en monnaie locale s’ouvrent progressivement aux investisseurs non résidents. Si l’Afrique du Sud est depuis quelque temps l’une des principales destinations des investissements de portefeuille sur le continent, d’autres pays, comme le Ghana, l’Égypte, le Maroc, le Nigéria et la Zambie, ont également réussi à intéresser les investisseurs étrangers. En 2004, par exemple, ces derniers ont repris l’achat de titres publics zambiens, interrompu en 1994 (Bank of Zambia, 2015). En 2014, les investisseurs non résidents détenaient environ 20 % de l’encours total de la dette intérieure, contre moins de 0,1 % en 2004. De même, le Ghana a attiré une proportion de plus en plus grande d’investisseurs non résidents, au point que ses entrées nettes de capitaux ont culminé à 2,6 milliards de dollars environ (27 % de l’encours total des titres publics libellés en monnaie locale) en 2012. L’augmentation des investissements de portefeuille a coïncidé, au Ghana, avec l’ouverture des marchés des titres publics aux investisseurs étrangers en 2006 et, en Zambie, avec l’allongement des échéances pour les obligations d’État. Au Nigéria, les flux de portefeuille ont fait suite à des opérations d’allégement et/ou de restructuration de la dette de grande ampleur et ont ravivé la confiance dans les perspectives économiques du pays. En République-Unie de Tanzanie, les non-résidents n’étant pas autorisés à détenir des titres publics, les investissements étrangers dans des bons et des obligations du Trésor ont été effectués de manière indirecte, par l’intermédiaire de banques commerciales.
Grâce à la participation de non-résidents dans leurs marchés obligataires, les pays africains ont la possibilité de diversifier leur base d’investisseurs. Il leur faut toutefois surveiller étroitement l’ampleur de cette participation, qui peut les rendre plus vulnérables aux chocs extérieurs − par exemple, aux crises financières. Les difficultés qui faisaient autrefois hésiter le commun des investisseurs internationaux devant des instruments de dette intérieure libellés en monnaie locale (méconnaissance des crédits, des normes et de la documentation en vigueur dans le pays) sont maintenant prises en charge par des emprunteurs supranationaux tels que la Banque africaine de développement et la Banque mondiale (par l’intermédiaire de la Société financière internationale).
Évolution de la dette publique dans certains pays, 1990-2014
La structure des portefeuilles de la dette publique africaine a beaucoup changé depuis le milieu des années 2000. Grâce principalement à l’allégement de la dette extérieure dans le cadre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale, la part de la dette publique totale a sensiblement diminué, et la dette intérieure est devenue une composante importante des portefeuilles. Le présent rapport ne peut pas fournir une analyse exhaustive de la dette intérieure de chacun des 54 pays du continent africain, mais les faits observés dans l’échantillon de cinq pays examiné permettent de dégager certaines grandes caractéristiques de la dette intérieure et de tirer quelques enseignements. Il reste que cet échantillon n’est pas représentatif de l’ensemble des pays africains, dont environ un tiers est classé parmi les États fragiles et en situation de conflit par la Banque mondiale et qui, compte tenu de leur situation incertaine, ont peu de chances de se doter de marchés financiers dynamiques dans un avenir proche.
La figure 10a présente l’évolution de la dette publique de 1995 à 2013 dans les cinq pays considérés. En moyenne, la dette extérieure est bien plus faible que par le passé. Elle est passée de plus de 120 % du PIB en 1995 à 25 % en 2009, avant de remonter à 27 % en 2013. Cette diminution s’explique dans une large mesure par l’annulation des créances au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. Trois des pays considérés (Ghana, République-Unie de Tanzanie et Zambie) ont bénéficié de ces initiatives.
L’endettement intérieur n’est pas un phénomène récent, puisque plusieurs pays africains y ont eu recours dans les années 1980 ; son taux avoisinait alors 11 % du PIB (Christensen, 2004). Pourtant, il n’a enregistré aucune hausse sensible dans les années 1990 et jusqu’au milieu des années 2000, la peur de créer des tensions inflationnistes, de compromettre la viabilité de la dette et d’évincer les investissements du secteur privé ayant freiné les emprunts sur le marché intérieur. La question de l’endettement intérieur a occupé une large place dans les programmes pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance mis en œuvre durant cette période, dont la plupart ont restreint le financement intérieur des pays (IMF, 2007). Au Mozambique, en République-Unie de Tanzanie et en Zambie, des limites ont été posées à l’emprunt intérieur par crainte d’un effet d’éviction ; au Ghana, la restriction du financement intérieur mise en place par le programme répondait surtout au souci de maintenir la dette intérieure à un niveau soutenable. D’une manière générale, les pays pour lesquels les apports des donateurs ne suffisaient pas à combler les déficits budgétaires n’émettaient pas de titres de dette intérieure, car le FMI et la Banque mondiale conseillaient habituellement de réduire l’emprunt intérieur. De plus, les programmes pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance prévoyaient le plus souvent des augmentations de l’aide en vue du remboursement de la dette (IMF, 2005 ; IMF, 2007). Il était communément admis que l’aide extérieure, constituée de prêts à des conditions de faveur et de dons, continuerait de jouer un rôle clef dans le financement des programmes de réduction de la pauvreté et de promotion de la croissance dans les années qui suivraient. Or, cette aide s’est révélée instable, procyclique et insuffisante face à l’ampleur des besoins de financement de la région.
Alors que les pays se sont mis à pallier la baisse des flux d’aide par l’obtention de ressources aux conditions du marché et par la recherche d’un financement bilatéral auprès de nouveaux prêteurs, comme les pays du groupe BRICS, des données récentes montrent une hausse régulière du ratio dette intérieure/PIB, ce qui suppose que les pouvoirs publics se tournent de plus en plus vers les marchés de la dette intérieure pour répondre à leurs besoins nets de financement. Entre 1995 et la fin 2013, le taux d’endettement intérieur est passé de 11 % à environ 19 % du PIB (fig. 10a). Ce taux global ne rend toutefois pas compte des variations considérables du ratio dette intérieure/PIB selon les pays (fig. 10b). Par exemple, entre 1995 et 2014, ce ratio n’a cessé d’augmenter au Ghana et au Kenya, passant de 17 % à 31 % au Ghana et de 16 % à 27 % au Kenya. En revanche, il n’a que légèrement progressé au Nigéria, en République-Unie de Tanzanie et en Zambie. Si la dette intérieure a manifestement augmenté par rapport au PIB, elle est encore plus préoccupante en valeur nominale. De fait, les ratios dette intérieure/PIB (fig. 10) sont surtout déterminés par la croissance forte et soutenue du PIB dans les pays considérés au cours des dix dernières années. En valeur nominale, le gonflement de la dette intérieure est plus sensible. Par exemple, entre 2005 et 2014, la dette du Ghana est passée de 3,1 milliards de dollars à 10,8 milliards de dollars, et la dette du Kenya, de 3,6 milliards de dollars à 13,4 milliards de dollars (fig. 11).
Certains pays de la région, comme le Ghana, le Kenya et le Nigéria, ont pu répondre à une grande partie de leurs besoins de financement par le biais de leurs marchés financiers. En général, les réserves de financement intérieur des pays africains sont le résultat de plusieurs années de forte croissance économique et de décisions politiques telles que la libéralisation des comptes de capital et l’adoption de mesures macroéconomiques, réglementaires et prudentielles judicieuses. Un certain nombre de pays ont aussi considérablement développé leurs marchés des obligations publiques, mais les progrès ont été quelque peu plus lents sur les marchés des obligations de société.
Dette intérieure négociable et dette intérieure non négociable
De plus en plus, les pays africains ont répondu à leurs besoins de financement en émettant des instruments de dette négociables, plutôt que des instruments de dette non négociables. Les titres négociables regroupent les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les bons du Trésor et d’autres instruments du marché monétaire. Les titres négociables sont liquides, leurs échéances étant le plus souvent inférieures à 1 an. Avant 2003, la dette intérieure négociable représentait moins de 40 % de la dette totale des administrations centrales du Kenya, du Nigéria et de la Zambie (fig. 12a). Principalement détenue par les banques centrales et les banques commerciales, la dette intérieure était, en règle générale, quasiment négociable ; les titres étaient souvent achetés involontairement par les banques, pour un montant équivalent à celui du déficit budgétaire, grâce aux réserves et aux liquidités que celles-ci étaient tenues de constituer (fig. 12b).
Dette intérieure par échéance
Avant 2001, les instruments à court terme, généralement des bons du Trésor, étaient prédominants dans les stocks de la dette intérieure (fig. 13a). Dans la mesure où elle existait, la dette intérieure à plus long terme représentait une moindre proportion du portefeuille total et était en grande partie détenue par des organismes publics et quasi publics, dont les banques centrales. La dette à court terme prenait avant tout la forme de bons du Trésor à 91 jours. Cependant, en raison de taux d’inflation élevés et volatils au début des années 1990, il est devenu difficile pour un certain nombre de pays de vendre ces instruments, si bien que leur échéance a été rendue encore plus brève (par exemple, 28 jours en Zambie). Au cours des dix dernières années, et alors qu’ils étaient auparavant nombreux à ne pas pouvoir le faire, de plus en plus de pays ont démontré qu’ils étaient capables d’émettre des titres de dette en monnaie nationale et à longue échéance, ce qui laisse entendre que l’obstacle du péché originel24 est en train d’être surmonté (fig. 13b).
Dans les cinq pays considérés, les titres de la dette intérieure à échéance supérieure à 10 ans ont représenté en moyenne 24 % de l’encours total de la dette intérieure en 2014, contre 5 % en 2001 (fig. 13a). Chacun des cinq pays a émis des obligations du Trésor à échéance supérieure à 10 ans ; c’est au Kenya que la proportion de dette à long terme était la plus élevée (35 %) et au Nigéria et en Zambie qu’elle était la plus faible (respectivement 10 % et 2 %) (fig. 13b). Ce passage à des titres papier à long terme devrait réduire sensiblement les risques de refinancement et de marché.
Dans l’hypothèse où les investisseurs financiers internationaux conservent la même propension à prendre des risques, la capacité d’émettre des instruments à long terme dépend dans une large mesure, dans la plupart des pays africains, des conditions macroéconomiques générales ; il faut notamment que le revenu par habitant soit en progression, que le taux d’inflation soit faible et stable et que de grands investisseurs institutionnels, comme des fonds de pension, se manifestent. À mesure que les économies se développent, la demande de dispositifs plus complexes augmente et, en principe, le besoin d’instruments d’épargne à plus long terme se fait sentir (Christensen, 2004).
Dette intérieure par détenteur
Dans une certaine mesure, l’augmentation de la dette intérieure observée depuis 2009 reflète la diversification de la base des investisseurs au-delà des investisseurs traditionnels que sont les banques centrales et les banques commerciales (fig. 14a). Un certain nombre de pays ont peu à peu abandonné le financement monétaire de leurs déficits publics sur le marché monétaire au profit de la titrisation. En conséquence, la dette publique détenue par les banques centrales a progressivement diminué, bien que le ratio moyen dette intérieure/PIB ait augmenté.
La diversification de la base d’investisseurs tient pour beaucoup au développement des institutions financières non bancaires. Dans une certaine mesure, la diminution de la dette publique détenue par les banques centrales peut s’expliquer par des restrictions légales appliquées à la détention de ces avoirs. Dans la plupart des pays, les montants des prêts des banques centrales aux pouvoirs publics sont limités par la loi.
Depuis peu, la demande detitres de dette publique intérieure par les non-résidents augmente. Au Ghana, on estime que la part de la dette intérieure détenue par des non-résidents oscillait autour de 20 % de la dette intérieure totale (IMF, 2015a). En Zambie, les investisseurs étrangers détenaient 10,6 % du stock total de la dette publique intérieure à la fin 2014, contre 5,1 % à la fin 2013. Cet intérêt grandissant des non-résidents pour les instruments de la dette publique africaine s’explique non seulement par la situation récente sur les marchés internationaux, mais aussi par les taux de croissance élevés dans la région. L’Afrique du Sud fait aussi partie des pays où une forte proportion des titres émis sur le marché intérieur sont détenus par des non-résidents − cette proportion est passée de 12,8 % en 2008 à 37,2 % en 2014 (fig. 14b).
L’attrait des pays africains transparaît non seulement dans l’intérêt grandissant que leurs marchés de la dette suscitent auprès des investisseurs étrangers, mais aussi dans le succès de leur vente d’euro-obligations sur les marchés internationaux. Il reste toutefois à savoir si cet intérêt survivra à une détérioration de la situation économique.
Charges d’intérêt
Le principal problème de la dette intérieure réside dans les coûts et les charges financières qu’elle impose aux gouvernements par rapport à la dette extérieure. Dans la figure 15a, les taux d’intérêt implicites servent d’indicateur des charges d’emprunt dans les trois pays pour lesquels des données sont disponibles, à savoir le Kenya, la République-Unie de Tanzanie et la Zambie. D’une manière générale, la dette intérieure libellée en monnaie locale pèse aujourd’hui beaucoup plus lourdement sur les pays que la dette extérieure. Mais cela n’est vrai que si la monnaie locale est stable. Dès lors que les taux de change varient, le service de la dette extérieure augmente sous l’effet de la dépréciation. Par exemple, lorsque le Kenya a émis ses premières euro-obligations en juin 2014, un dollar équivalait à 87,5 shillings kényans environ. En décembre 2015, à la suite de l’appréciation du dollar sur le marché mondial des devises, le taux de change a été ramené à 102,3 shillings kényans pour un dollar. Cette dépréciation a fait bondir le service de la dette de près de 17 % en monnaie locale, ce qui n’avait pas été prévu au moment de l’émission des euro-obligations. De même, lorsque la Zambie a émis pour 1 milliard d’euro-obligations, en avril 2014, un dollar équivalait à 6,2 kwachas zambiens environ. À la fin décembre 2015, le taux de change a été ramené à 11 kwachas zambiens pour un dollar, si bien que, en monnaie locale, le coût de remboursement des euro-obligations a augmenté de plus de 70 %. Une telle escalade des coûts pourrait être évitée si les instruments de la dette intérieure étaient émis dans la monnaie du pays.
Cependant, si le coût nominal de l’emprunt intérieur est resté élevé en 2000-2014, le coût de la dette extérieure a évolué à la hausse, notamment en 2008-2014 (fig. 15a et b)25. De nombreux pays africains cherchent actuellement des substituts à l’aide publique au développement, qui se tarit : ils recourent à des ressources non concessionnelles (par exemple, sur les marchés financiers internationaux) et au financement bilatéral, notamment auprès de nouveaux prêteurs tels que les pays du groupe BRICS, qui imposent des conditions souvent plus strictes que les prêteurs traditionnels, comme l’Association internationale de développement (Greenhill and Ali, 2013 ; Griffiths et al., 2014). L’hétérogénéité des pays entraîne des variations dans leurs charges financières respectives. Par exemple, en 2014, les versements d’intérêts au titre de la dette intérieure ont représenté environ 2,2 % du PIB dans le cas du Kenya, contre moins de 1,5 % dans le cas de la République-Unie de Tanzanie et de la Zambie.
C. DYNAMIQUE DE LA DETTE INTÉRIEURE : ÉTUDES DE CAS PAR PAYS
Cette section est consacrée à l’étude de la dynamique et des déterminants de la dette intérieure à travers les cas du Ghana, du Kenya, du Nigéria, de la République-Unie de Tanzanie et de la Zambie. Ces pays ont été retenus d’une part parce qu’il existe des données les concernant mais surtout parce qu’ils ont commencé à émettre des obligations souveraines sur les marchés internationaux et qu’à la suite de la libéralisation de leur compte de capital, leurs marchés intérieurs (actions et obligations) se sont ouverts aux capitaux étrangers à court et à long terme. Ils sont donc non seulement de plus en plus intégrés sur les marchés internationaux de capitaux mais ils lèvent aussi toujours plus de fonds sur leur marché intérieur pour financer leur développement. Quatre des cinq pays étudiés (Kenya, Ghana, Nigéria et Zambie) comptent parmi les 10 pays de tête du classement établi selon l’indice fondamental obligataire africain 2014, qui évalue les marchés obligataires africains et qui a été mis au point par la Banque africaine de développement et par l’Initiative des marchés financiers africains, à partir de l’analyse des conditions macroéconomiques, de la gouvernance, de l’infrastructure des marchés obligataires, des émetteurs, des stratégies d’émission et de l’accès aux marchés, de la base d’investisseurs locaux et de la participation des agents économiques. La section précédente, qui présente les caractéristiques de la dette publique intérieure africaine, montre que cette dette a augmenté en part du PIB et que le taux d’endettement intérieur varie sensiblement entre les pays. La présente section examine les principales politiques macroéconomiques, la composition de la dette intérieure, la structure de maturité de la dette et les investisseurs. L’une des principaux objectifs est de déterminer les mesures que l’Afrique devrait prendre pour soutenir la création de marchés de capitaux nationaux capables de financer le développement du continent.
Ghana
Dans les années 1980 et 1990, comme d’autres pays africains, le Ghana s’est surtout appuyé sur les sources de financement à des conditions de faveur. En 2000, la dette extérieure représentait près de 80 % de la dette publique (fig. 16a). Or, même si, en part du PIB, la dette intérieure (19,3 % en 1998) était comparable à celle d’autres pays africains, elle était une source d’inquiétude majeure car les taux intérieurs étaient élevés. En octobre 1998, le Gouvernement a organisé un atelier sur la dette nationale, avec le concours de Debt Relief International ; l’une des recommandations était de créer un fonds de la dette intérieure financé par des donateurs afin de réduire le poids du paiement des intérêts. Les économies ainsi réalisées devaient contribuer à diminuer le déficit global et le financement intérieur net. La politique budgétaire a été conçue de telle sorte que le financement intérieur net soit ramené à zéro et permette un remboursement net de la dette intérieure compris entre 1,5 % et 2,5 % du PIB pour 2003 et les années suivantes. En 2003-2004, la dette intérieure a baissé, sous l’effet principalement des mesures d’allégement renforcé au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’aide des donateurs, et la situation budgétaire s’est améliorée. L’impact monétaire de ces apports a été considérable, car le Gouvernement a profité de l’amélioration de sa situation financière pour rembourser la dette intérieure au lieu de réduire sa dette nette auprès de la banque centrale, qui a dû multiplier les opérations de stérilisation. En 2004-2005, le financement intérieur net du budget a augmenté de 1 % du PIB, en raison notamment d’une hausse des dépenses consacrées aux mesures de réduction de la pauvreté et à la construction d’infrastructures essentielles, de l’accroissement des subventions pétrolières consécutive à la hausse des cours mondiaux du pétrole et des dépassements du budget liés aux traitements des fonctionnaires.
Dans les années qui ont suivi, la dette intérieure n’a cessé d’augmenter dans un contexte marqué par des besoins importants dus au financement du budget. La figure 16b montre que le Ghana n’a enregistré d’excédent budgétaire qu’en 2006, possiblement grâce aux dons reçus au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale. Depuis lors, le pays affiche des déficits budgétaires relativement élevés. De plus, depuis 2006, et la décision du Gouvernement d’ouvrir le marché intérieur ghanéen de la dette aux investisseurs non résidents, ce marché nouveau à croissance rapide attire de plus en plus d’ investisseurs étrangers. La dette extérieure a aussi augmenté peu à peu à la suite des émissions d’euro-obligations réalisées après 2007 alors que les conditions internationales étaient favorables.
Ces dernières années, le Gouvernement a fait face à d’importants besoins de financement dus à la détérioration des résultats économiques, aggravée par la forte chute des prix du pétrole et des produits de base et par les coupures de courant. La croissance est passée de 7,3 % en 2013 à 4,2 % en 2014, et les déficits budgétaires et courants se sont considérablement creusés, entraînant une forte dépréciation de la monnaie locale, la réapparition des pressions inflationnistes et la hausse des taux d’intérêt. Dans le budget de 2013, le Gouvernement s’est efforcé de rétablir la discipline budgétaire et de contenir la dette à des niveaux acceptables. Il avait notamment pour objectif de réduire le déficit budgétaire global (11,8 % du PIB en 2012) à 9 % du PIB pour 2013. Mais ce programme a été mis à mal par le niveau des recettes qui a été bien inférieur aux montants attendus et par les dépassements de dépenses considérables dus aux traitements des fonctionnaires et à des intérêts plus élevés que prévu. En 2013, les opérations budgétaires du Gouvernement se sont soldées par un déficit global représentant 10,1 % du PIB, contre un objectif de 9 %. Ce déficit a été financé principalement par l’emprunt intérieur, qui a porté le financement intérieur net à 8,1 % du PIB, alors que l’objectif visé était de 6,4 %. Le reste du déficit a été financé par des apports étrangers nets représentant 2,6 % du PIB.
Dans les années 1990 et au début des années 2000, c’est principalement la banque centrale qui s’est chargée d’assurer le financement intérieur du déficit budgétaire. En 1996, face aux gros besoins de financement du secteur public, la banque centrale a adopté une politique monétaire accommodante, autorisant les banques de dépôt à échanger ses bons émis dans le cadre d’opérations d’open market contre des bons du Trésor. En conséquence, la part des titres d’État détenus par les banques commerciales, qui était quasi nulle, est passée à environ 6 %. Dans les années 1990, les institutions financières non bancaires jouaient un rôle limité dans le système financier du Ghana. La plus grande institution financière non bancaire est la Social Security and National Insurance Trust, la caisse des pensions de l’État.
En 2000, les instruments de dette du Ghana étaient les bons du Trésor à court terme (à 91, 182 et 364 jours). Le seul titre de créance à moyen terme était le bon du Trésor à taux variable et à échéance 2 ans. Les instruments à long terme comprenaient les obligations d’État et les obligations pour réévaluation. Celles-ci avaient été émises en 1996 par le Gouvernement en faveur de la Banque du Ghana pour compenser les pertes subies lors de la réévaluation des actifs extérieurs nets, consécutive à la dépréciation de la monnaie locale. Ces pertes s’étaient accumulées dans les livres de la Banque centrale, qui affichaient de ce fait des fonds propres négatifs. En 2001, le Gouvernement a lancé un emprunt obligataire sur 3 ans indexé à l’inflation afin de restructurer la dette intérieure vers des instruments à long terme. La même année, le Gouvernement a repris une partie de la dette contractée par la raffinerie de pétrole de Tema (entreprise publique) auprès du système bancaire en la convertissant en obligations de 3 à 5 ans. D’autres instruments à moyen terme, comme un bon du Trésor sur 2 ans à taux fixe, une obligation d’État à 5 ans et un titre d’État pour le financement du pétrole, ont été émis en 2004 ; en 2005, le Gouvernement a lancé une émission d’actions Telekom Malaysia, après la privatisation de la société nationale des télécommunications. Entre 2000 et 2004, les bons du Trésor représentaient plus de 60 % de l’encours de la dette intérieure, et étaient principalement détenus par le secteur bancaire. Le passage progressif aux instruments à long terme, amorcé en 2005, reflétait la volonté du Gouvernement d’allonger la maturité de sa dette intérieure. En 2010, le portefeuille était constitué à 57 % de titres de moyen à long terme, et cette évolution s’est poursuivie (fig. 16c), puisqu’à la fin de 2014 une grande partie de la dette intérieure du Ghana était constituée de titres à long terme, essentiellement détenus par des investisseurs institutionnels et des banques commerciales.
Le coût de la dette intérieure est en hausse, depuis l’augmentation en 2014 des taux sur les bons du Trésor à 91 jours et à 182 jours, qui ont gagné quelque 700 points de base pour s’établir aux alentours de 26 %. En 2006, le Gouvernement avait ouvert le marché intérieur de la dette aux non-résidents mais limité les acquisitions aux titres dont l’échéance était supérieure à 3 ans. Ces dernières années, la part de la dette intérieure détenue par des non-résidents tourne autour de 20 % de l’encours total, ce qui présente des risques de refinancement et des risques de change et donc des risques de sorties de capitaux et de balance des paiements.
Au Ghana, tout nouvel emprunt public sur le marché intérieur risque fort d’évincer l’investissement privé et de provoquer des pressions inflationnistes sur l’économie. En ce qui concerne les taux d’intérêt, les taux de rendement réel sur les titres de créance intérieure sont restés largement négatifs durant la période 2000-2009. La situation s’est inversée en 2011, lorsque les taux sont devenus positifs. Cela dit, depuis 2009, le secteur non bancaire est devenu une source de financement de plus en plus importante, même si le Gouvernement fait souvent appel à la banque centrale en cas de difficultés budgétaires.
Kenya
Dans les années 1980, comme de nombreux pays en développement, le Kenya dépendait des flux de capitaux extérieurs assortis de conditions favorables pour financer son développement. Mais, dans la décennie suivante, l’aide au développement s’est peu à peu réduite en raison de l’incapacité du Gouvernement d’appliquer des politiques macroéconomiques prudentes et du ralentissement des réformes structurelles (Were, 2001). Le Gouvernement s’est donc tourné vers le marché intérieur pour financer les déficits budgétaires, et la dette intérieure s’est mise à grimper. Dans les années 1990, le Gouvernement a emprunté sur le marché intérieur pour rembourser les emprunts extérieurs qui arrivaient à échéance. La figure 17a montre qu’à cette période, certaines années, le montant de la dette intérieure était supérieur au montant du déficit budgétaire. Parmi les autres facteurs qui ont contribué au fort accroissement de la dette intérieure, on peut citer la stagnation des recettes fiscales réelles et la pression exercée par les dépenses (Maana, 2008). Dans le rapport annuel sur la gestion de la dette publié en juin 2007, l’accumulation de la dette a été imputée principalement à l’accès réduit aux financements extérieurs et à la nécessité d’emprunter sur le marché intérieur pour financer le budget.
En 2000, le PIB réel s’est contracté de 0,3 %, dans un contexte marqué par une grave sécheresse, les faibles niveaux d’aide provenant des donateurs, le déclin du tourisme, l’atonie de l’investissement privé et les incertitudes quant à la politique du Gouvernement. Le programme budgétaire s’est heurté à des difficultés, le déficit global dépassant le déficit prévu par 1 % du PIB. Le recours aux arriérés de paiement et le manque de financements pour achever les projets interrompus ont entraîné une accumulation des créances contre l’État.
Entre 2003 et 2009, la dette intérieure est passée de 25,5 % à 18,1 % du PIB grâce à la forte croissance économique, à des politiques budgétaires prudentes et à la baisse des taux d’intérêt. Ces bons résultats étaient dus à la solidité du mécanisme de recouvrement des recettes et aux mesures prises pour gérer de manière plus rigoureuse les dépenses récurrentes. Cette tendance s’est inversée pendant l’exercice 2009-2010, sous l’effet des politiques de relance budgétaire mises en place pour atténuer l’impact de la crise financière mondiale. La dette publique intérieure brute du Kenya représentait environ 24 % du PIB à la fin de 2014. Malgré un ratio dette intérieure/PIB relativement faible, le Kenya pourrait être exposé à la réalisation des passifs éventuels liés aux obligations non provisionnées du National Social Security Fund (caisse nationale de sécurité sociale), à l’actuel régime des pensions des fonctionnaires et à la dette intérieure des entreprises d’État.
Il semblerait que les non-résidents ne détiennent qu’une petite part du stock de dette intérieure. Celle-ci est essentiellement émise sous la forme d’instruments titrisés, en particulier de bons et d’obligations du Trésor, et ne comporte qu’un faible pourcentage d’instruments non titrisés (fig. 17b). Au moins 80 % de la dette intérieure du Kenya émise depuis 2001 est titrisée. En 2001, le portefeuille était constitué principalement de bons du Trésor (70 %), dont la proportion a ensuite diminué pour s’établir à 24 % en 2004, avant de se stabiliser. Depuis 2001, pour restructurer son portefeuille, le Gouvernement émet de la dette intérieure à long terme ; à la fin de l’exercice financier 2014, les instruments à long terme constituaient 75 % du portefeuille total (une baisse toutefois par rapport aux 82 % de juin 2011).
L’allongement de la structure des échéances de la dette intérieure est donc le fruit d’une politique d’emprunt volontariste destinée à limiter le risque de refinancement. Durant la dernière décennie, la Banque centrale du Kenya a engagé un train de réformes pour développer les marchés intérieurs de la dette. Après le redémarrage du programme d’émission d’instruments du Trésor, la Banque centrale
du Kenya, en partenariat avec ce dernier et avec les acteurs du marché, a créé le Market Leaders Forum, dont le but était alors de restructurer le portefeuille de la dette intérieure, qui était composé de 24 obligations du Trésor pour 76 bons. Le Market Leaders Forum avait également les objectifs suivants : faciliter le placement des titres publics par l’établissement de relations directes avec les investisseurs potentiels ; conseiller la Banque centrale du Kenya et le Trésor au sujet des différents événements qui survenaient sur les marchés de la dette et les marchés monétaires et qui avaient des incidences directes sur le déroulement des nouvelles émissions ; proposer des émissions d’instruments de dette propres à diversifier l’offre et à garantir ainsi la stabilité des marchés financiers. Tels étaient les fondements des mesures de réforme qui ont suivi. Grâce à ce programme et aux efforts déployés par le Market Leaders Forum, le marché obligataire kényan a été salué comme l’un des marchés obligataires africains les plus dynamiques par leur développement. Parmi les initiatives prises pour allonger la structure des échéances des titres d’État figurent notamment la réalisation d’un programme d’obligations de référence, la réouverture des émissions obligataires à moyen et à long terme et l’élaboration d’une nouvelle stratégie en matière de dette.
En 2007, le Market Leaders Forum a noté que le marché obligataire kényan était très fragmenté, avec de nombreuses émissions de petite taille dispersées le long de la courbe des rendements. Cette fragmentation rendait le marché non liquide, entraînant de la volatilité et entravant le processus d’expansion du marché. En 2009, la Banque centrale du Kenya s’est engagée avec succès dans la réouverture des émissions d’obligations du Trésor. Depuis lors, l’intensification des transactions nouvelles à la Bourse de Nairobi sur ces émissions a contribué au développement du marché secondaire qui était le principal objectif de cette démarche. La réouverture s’étant concentrée principalement sur les obligations à moyen et à long terme, la dette publique est à présent relativement bien répartie, avec des échéances comprises entre 2013 et 2041. Un nouvel instrument à long terme, émis en 2009, a remporté un vif succès. Exonéré de retenue à la source, il a été conçu pour financer des infrastructures publiques prioritaires.
En 2009, le Gouvernement a publié la première stratégie de gestion de la dette à moyen terme ; elle portait sur les exercices 2009-2010 à 2011-2012. Son objectif était de réduire le risque de refinancement, en particulier sur la dette intérieure, et de continuer de développer le marché intérieur. Le Gouvernement entendait aussi réduire l’exposition du portefeuille au risque de change, d’où le recours aux marchés intérieurs prévu dans la stratégie pour répondre aux besoins de financement. Cette stratégie a permis d’allonger les échéances des titres d’État et d’orienter l’emprunt intérieur vers l’émission d’obligations du Trésor à moyen et à long terme plutôt que vers l’émission de bons (fig. 17c). L’échéance de la dette est passée d’une moyenne d’environ 4,7 ans en 2009 à 6,6 ans en 2012.
Les banques commerciales et les institutions non bancaires détiennent aujourd’hui une part quasi égale des titres de dette intérieure – 48,1 % et 46,8 % respectivement –, tandis que la Banque centrale du Kenya détient la majeure partie du solde (fig. 17d). La part détenue par les institutions non bancaires a bondi en 2002, passant d’un peu moins de 5 % en 2001 à plus de 40 % ; elle est ensuite restée relativement stable, signe que la base des investisseurs nationaux s’était diversifiée et que le Market Leaders Forum avait rempli une partie de sa mission. Le volume des titres de dette détenu par la Banque centrale du Kenya a progressivement diminué ces dernières années.
En 1997, le Gouvernement a engagé une réforme du secteur des pensions de retraite, en créant une autorité chargée de l’encadrer et de le réglementer. Cette réforme était une étape importante sur la voie du développement du marché intérieur de la dette, auquel les régimes de retraite publics, dont la caisse nationale de sécurité sociale, comme les régimes privés ont pris une part beaucoup plus active. De plus, les fonds de pension étaient tenus d’investir jusqu’à 70 % de leurs actifs dans des titres d’État. C’est ainsi qu’une nouvelle catégorie d’investisseurs intéressés par des investissements à moyen et à long terme est apparue. Le Gouvernement a appliqué la même stratégie lors de la réforme du secteur des assurances. En janvier 2009, pour attirer les petits investisseurs, la Banque centrale du Kenya a abaissé les montants minimaux requis pour investir dans les bons et les obligations du Trésor, de 1 million de shillings kényans à 100 000 shillings kényans et 50 000 shillings kényans, respectivement. Il s’agissait d’encourager l’épargne privée en diversifiant l’offre de produits d’investissement et de promouvoir l’intégration financière. La base des investisseurs s’est élargie et comprend désormais des banques commerciales, des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des entreprises d’État et des particuliers. Parmi les initiatives prises dans ce cadre, citons les programmes d’alphabétisation financière et le projet de création d’une plateforme mobile qui permettra aux petits investisseurs d’acquérir plus facilement des titres publics.
Le service de la dette intérieure reste une lourde charge pour l’économie et représente en moyenne plus de 80 % du service de la dette totale. Depuis 2005, les taux d’intérêt réels implicites sur la dette intérieure sont volatils, en partie à cause de l’importance du stock de la dette intérieure par rapport à celui de la dette extérieure. Ces dernières années, le taux d’intérêt implicite sur la dette extérieure tend à augmenter, en raison des émissions de titres de dette non concessionnelle sur les marchés internationaux. Au Kenya, le nombre d’investisseurs non bancaires nationaux a progressé depuis 2000 ; ils couvrent en moyenne 45 % des besoins de financement du Gouvernement. Le secteur des pensions de retraite s’est développé d’une manière spectaculaire depuis sa libéralisation en 2003, et cette évolution, conjuguée aux réformes menées dans le secteur des assurances, a créé une demande d’obligations à long terme. Depuis 2000, la croissance du crédit au secteur privé est, elle aussi, restée forte, et les banques se montrent toujours plus disposées à placer leurs excédents de liquidités en titres de dette publique. Depuis 2008, les émissions de bons et d’obligations du Trésor sont sursouscrites, et cette tendance s’accentue. L’intérêt des banques commerciales pour les titres d’État à long terme a atteint un point culminant en 2012 (une émission a été sursouscrite à plus de 200 %), lorsque les rendements ont augmenté du fait de l’inflation. En raison des incertitudes concernant l’inflation et la politique monétaire, les banques préfèrent souscrire des titres d’État que prêter au secteur privé. Malgré tout, le Kenya est l’un des pays d’Afrique qui a su développer ses marchés obligataires intérieurs, et en particulier le marché obligataire privé.
Nigéria
Le ratio dette intérieure/PIB du Nigéria augmente depuis le début des années 1980, en raison des importants déficits budgétaires que le pays doit financer. Face à la baisse de l’aide étrangère, notamment des prêts et des subventions, le Gouvernement a multiplié les emprunts sur le marché intérieur pour financer son développement. Le montant du déficit budgétaire financé par l’emprunt sur le marché intérieur est passé de 209 millions de dollars en 2005 à 5,4 milliards de dollars en 2014. Comme la figure 18a le montre, depuis 2004 les déficits budgétaires sont financés principalement par l’emprunt intérieur. La baisse des prix du pétrole, l’une des principales sources de revenus du Nigéria, s’est récemment soldée par un creusement du déficit budgétaire. Le produit de l’emprunt intérieur a servi à financer non seulement les déficits prévus mais aussi les dépenses spéciales effectuées par le Gouvernement au titre de la politique de relance qu’il a menée entre 2008 et 2014. Conjuguées à la nécessité de financer le déficit infrastructurel, ces dépenses ont contribué à l’accroissement de la dette intérieure (fig. 18b).
En sa qualité de banque de souscription et d’administratrice des adjudications sur le marché primaire, la Banque centrale du Nigéria a longtemps été la principale source de financement et le principal détenteur de titres publics. La loi ne prévoyait aucune restriction quant au nombre de titres d’État qu’elle était autorisée à acquérir sur le marché primaire ; elle n’était toutefois pas autorisée à acquérir des titres dont l’échéance dépassait 25 ans. En règle générale, la Banque centrale achetait la plupart des émissions à 5 % environ au-dessous du taux d’équilibre du marché, maintenant le prix de l’emprunt intérieur public artificiellement bas.
Le volume des titres de dette intérieure détenus par la Banque centrale a diminué au fil des années pour s’établir à 0,2 % du PIB à la fin de 2014, à mesure que les entités financières non bancaires (compagnies d’assurances, fonds de pension publics et privés) se sont mis à acheter de plus en plus de titres dette publique (fig. 18c). Entre 1981 et 2003, le portefeuille de la dette intérieure du Nigéria était fortement concentré sur des échéances inférieures à 1 an, en majorité des bons du Trésor à 91 jours. Des bons du Trésor et des titres destinés au financement du développement avaient été émis pour des projets spécifiques dans le passé et, bien que négociables, ils étaient en large part détenus par la Banque centrale, exposant le Gouvernement à des risques élevés de taux d’intérêt et de refinancement. Ces risques budgétaires étaient encore aggravés par le faible développement du système financier, illustré par le modeste ratio M2 (monnaie et quasi-monnaie)/PIB (26 % à la fin de 2003) et par l’étroitesse de la base d’investisseurs. Ces faiblesses pesaient négativement sur les taux d’intérêt et risquaient de détourner les investisseurs du secteur privé au profit des emprunts lancés par le Gouvernement pour faire face à ses importants besoins de financement. Elles compliquaient aussi la politique monétaire de la Banque centrale, car une politique monétaire plus restrictive axée sur la stabilisation des prix pouvait avoir des effets négatifs sur le coût du service de la dette publique.
En 2003, des modifications ont commencé à être apportées à la structure de la dette intérieure après que le Gouvernement a pris la décision de réformer la gestion de la dette publique. Les réformes visaient non seulement à remédier aux faiblesses institutionnelles concernant la gestion de la dette publique, mais aussi à améliorer la gestion de la dette intérieure.
Premièrement, dans le cadre de ces réformes, le Gouvernement a rétabli le programme d’émission d’obligations souveraines, qui avait été abandonné en 1986. Des émissions de titres à long terme, composées de titres à taux fixe (obligations à 3 et 5 ans) et de titres à taux variables (à 7 et 10 ans), ont été lancées, conformément à la stratégie de restructuration du portefeuille visant un rapport long terme/court terme de 75/25. Avant l’entrée en vigueur de ce programme, le Gouvernement se finançait sur le marché intérieur principalement par le biais des bons du Trésor à 91 jours, c’est-à-dire en émettant des instruments à court terme qui n’étaient pas adaptés au financement de projets économiques et sociaux constituant pour la plupart des actifs à long terme.
Si la souscription n’a pas été à la hauteur des attentes en raison des craintes de défaut, le marché a radicalement changé de position après les mesures d’allègement de la dette dont le pays a bénéficié en 2006 et qui ont renforcé sa solvabilité et entraîné une augmentation des flux de portefeuille et des investissements étrangers directs. En outre, le PIB réel a affiché un taux de croissance annuel moyen de 6,8 % entre 2004 et 2014, faisant du Nigéria l’un des pays émergents les plus dynamiques de cette période. Le taux d’inflation est resté stable, et largement inférieur à 20 %. En conséquence, les investisseurs ont commencé à s’intéresser aux instruments de dette à long terme, et, entre 2006 et 2014, les émissions ont été sursouscrites dans une proportion comprise entre 60 % et 150 % . Alors qu’en 2003, les bons du Trésor à 91 jours représentaient 62 % du portefeuille de la dette intérieure, ce pourcentage était tombé à 36 % à la fin de 2014. Un autre facteur important à l’origine du succès des émissions d’obligations à long terme − dont l’échéance s’étend aujourd’hui jusqu’à 20 ans – a été l’établissement et l’expansion des marchés secondaires d’obligations d’État, qui ont continué de se développer. Grâce au bon fonctionnement de ces marchés, les investisseurs pouvaient dénouer leurs positions à long terme dès qu’ils avaient besoin de liquidités.
Deuxièmement, la structure de détention de la dette intérieure s’est transformée. En 2003, la Banque centrale du Nigéria détenait environ 46 % de l’encours de la dette intérieure, contre 87 % en 1995, alors que le secteur non bancaire n’en détenait que 16 %, contre 9 % en 1995. En 2014, la part de la banque centrale avait fondu et ne représentait plus que 2 %, tandis celle du secteur non bancaire était passée à 45 % (fig. 18c). La part détenue par le secteur bancaire commercial a augmenté au même rythme que celle du secteur non bancaire.
Cette évolution est importante pour l’économie nigériane : premièrement, le financement monétaire du déficit budgétaire est contrôlé, et la Banque centrale est à l’abri des conflits d’intérêts que pourrait faire naître son double rôle d’agent fiscal et d’autorité monétaire ; deuxièmement, la base des investisseurs susceptibles d’acheter des titres de dette intérieure s’est diversifiée. Des études antérieures (Christensen, 2004) soulignent les avantages de cette diversification, qui contribue à abaisser les coûts de l’emprunt et à réduire la volatilité des rendements et les possibles effets d’éviction. Depuis 2010, les coûts de financement des engagements intérieurs du Nigéria augmentent ; il en va de même de ses coûts extérieurs, en raison de l’émission d’euro-obligations aux conditions du marché.
Les titres de dette intérieure de l’État nigérian ont également attiré des investisseurs étrangers qui ont manifesté un regain d’intérêt pour la dette des marchés émergents du fait de ses rendements attractifs. De plus, en 2012, l’entrée du Nigéria dans l’indice EMBI (Emerging Markets Bond Index) de la banque JP Morgan était le signe objectif de la transformation du marché intérieur de la dette, conduisant à la participation des investisseurs étrangers. JP Morgan a ensuite exclu le Nigéria de l’indice, après que les restrictions sur les transactions en devises ont fait craindre aux investisseurs une pénurie de liquidités. Il n’en demeure pas moins que les investisseurs étrangers ont aujourd’hui une bien meilleure appréciation des conditions d’investissement au Nigéria qu’il y a dix ans.
Cette étude montre que le marché intérieur nigérian de la dette peut être une source majeure de financement du développement et qu’il est à présent plus facile d’émettre des titres de dette intérieure à long terme. De plus, la base des investisseurs s’élargit au-delà du secteur bancaire commercial, ce qui réduit le risque d’éviction des investissements dans le secteur privé. Le Nigéria, qui compte une forte proportion de créanciers privés mais dont la dette extérieure est faible, n’est peut-être pas vulnérable aux chocs extérieurs dus aux taux d’intérêt. Par contre, le pays est vulnérable à une faiblesse prolongée des prix du pétrole. La viabilité de la dette intérieure pourrait aussi s’en trouver affectée.
République-Unie de Tanzanie
La stratégie nationale d’emprunt de la République-Unie de Tanzanie, présentée dans les directives budgétaires de 2002, avait pour objectif initial de financer les déficits budgétaires nets exclusivement par des sources extérieures, notamment des prêts concessionnels (United Republic of Tanzania, 2002). Dans le droit fil de cette stratégie, le Gouvernement a voulu limiter le financement intérieur net à 1 % du PIB et maximiser les emprunts extérieurs concessionnels (fig. 19a). Si le Gouvernement a opté pour ce modèle, c’est parce que le marché intérieur de la dette n’était pas suffisamment développé et qu’il pouvait le faire à un coût raisonnable. En 2014, la majeure partie de la dette publique du pays était toujours concessionnelle, mais les emprunts non concessionnels ont augmenté ces dernières années.
La dette publique intérieure de la République-Unie de Tanzanie se compose de trois éléments : les titres de créance négociables, les titres de créance non négociables et les autres dettes. Les titres négociables sont les bons du Trésor (à 35, 91, 182 et 364 jours) et les obligations du Trésor (à 2, 5, 7 et 10 ans), tandis que les titres non négociables comprennent les obligations et les « stocks » spéciaux. Les autres dettes recouvrent la dette non titrisée, qui est constituée des engagements découlant des garanties émises pour le compte des ministères, des départements et des organismes publics et de celles émises pour le compte des entreprises publiques ; des arriérés dus aux fournisseurs ; et des engagements résultant des obligations contractuelles et non contractuelles du Gouvernement.
Avant 2004, la contribution des ressources intérieures au financement des déficits budgétaires était négligeable, et il n’y avait pas de rapport direct entre l’augmentation de la dette intérieure et le financement de ces déficits par des sources intérieures (fig. 19b). Une bonne partie de la dette intérieure accumulée dans les années 1990 était imputable aux recapitalisations de banques publiques et d’organismes parapublics dont les fonds propres étaient devenus négatifs par l’émission d’obligations spéciales (United Republic of Tanzania, 2002). La dette intérieure de la République-Unie de Tanzanie − 918,2 millions de dollars à la fin de 2000 − était l’une des plus faibles des pays africains ; elle cadrait non seulement avec la stratégie visant à limiter l’emprunt intérieur mais aussi avec le faible taux d’épargne intérieure et le relatif sous-développement des marchés de la dette et des capitaux.
Toutefois, l’encours de la dette intérieure et son ratio au PIB a fortement augmenté entre 2004 et 2014, où elle a atteint quelque 4,9 milliards de dollars, soit 14 % du PIB. Cette augmentation est due principalement aux besoins de financement croissants résultant de la baisse des recettes publiques, conjuguée à de fortes dépenses d’infrastructure et à la comptabilisation des passifs éventuels dans l’encours de la dette. Si le montant de la dette à court terme est restée relativement stable ces dernières années, reflétant la politique de renouvellement des bons du Trésor, la dette intérieure à moyen et à long terme a fortement augmenté, surtout pendant l’exercice budgétaire 2009-2010, en raison des émissions d’obligations spéciales lancées pour faire face à la crise financière mondiale et de la hausse des emprunts hors marché contractés par les ministères, les administrations et les organismes publics. Les engagements effectifs de l’État comprennent les engagements découlant des garanties émises en faveur des fonds de pension pour le compte des ministères, des administrations et des organismes publics en vue de la mise en œuvre de projets ; les engagements découlant des cotisations des fonctionnaires à la caisse des pensions de la fonction publique et à celle des autorités locales ; et les engagements découlant des demandes d’indemnités. Au fil des années, le Gouvernement a vu augmenter le nombre des demandes d’émission de garanties pour le compte des ministères, des administrations et des organismes publics afin que ces institutions puissent obtenir des facilités de crédit, principalement auprès des fonds de pension, pour réaliser des projets qui n’étaient pas financés par le budget.
Avant 1991, il n’existait pratiquement pas de marché monétaire ni de marché des capitaux en République-Unie de Tanzanie, et le secteur financier était essentiellement public, quelques effets non négociables à long terme étant détenus par des organismes d’État. Ce n’est qu’en 1993, dans le cadre de la réforme du secteur financier, que le Gouvernement a lancé les bons du Trésor, qui ont été utilisés exclusivement à des fins de financement jusqu’en 1996. Les bons à 91 jours servaient d’instrument de stérilisation à la Banque de Tanzanie. Les obligations du
Trésor ont été introduites en 1997 pour contribuer au remplacement des titres de créance non négociables. Il a fallu attendre 2002 pour que les autorités émettent des obligations à 5 ans. Ces obligations spéciales à long terme ont en effet été émises principalement pour recapitaliser les banques publiques dont les bilans étaient grevés par les prêts non productifs et les engagements non honorés. Elles sont réparties entre la Banque de Tanzanie (24 %) et les banques commerciales (72 %), et sont assorties de coupons à taux variable ou à taux fixe relativement bas (5 % à 11 %). Les échéances sont comprises entre 2 et 20 ans, et les intérêts sont payés trimestriellement. Les « stocks », dont la structure est identique à celle des obligations à long terme, provenaient principalement de la titrisation des avances, des pertes de change et d’autres engagements directs ou parapublics du Gouvernement auprès du système bancaire, en particulier la Banque de Tanzanie. Les échéances s’échelonnent entre 5 et 50 ans, et la Banque de Tanzanie en détient 90 %. Les coupons payés par cette catégorie de titres varient d’un taux très élevé à zéro, et le versement des intérêts est semestriel.
L’analyse de la dette intérieure par type d’instrument montre la domination croissante des obligations d’État, qui sont passées en moyenne de 37 % en 2003 à 63 % en 2014 (fig. 19c). Cette évolution est conforme aux stratégies, qui visent à réduire les risques de refinancement associés à l’émission de titres de dette à court terme en allongeant les échéances des titres d’État. Comme on l’a déjà dit, il importe de noter l’existence d’obligations et de « stocks » à long terme émis au fil des années ainsi que l’évolution des bons et des obligations du Trésor. À cela s’ajoutent les titres émis par la Banque centrale pour stériliser les entrées de capitaux étrangers, principalement les importants flux d’aide. La République-Unie de Tanzanie a connu une hausse substantielle des émissions d’instruments de ce type en 2005, laquelle s’est combinée au second semestre de l’année avec une forte hausse (plus de 2 % du PIB) des émissions par le Gouvernement d’effets financiers destinés à faire face à un épisode de sécheresse et aux dépenses liées aux élections.
En 2000, 28 % seulement des titres d’État étaient négociables. La prédominance des titres non négociables a diminué à mesure que les autorités et les investisseurs se sont tournés vers les instruments négociables. En 2014, 90 % au moins des instruments étaient négociables. Dans l’ensemble, les taux de rendement réel sur les titres du Trésor tanzanien sont demeurés positifs. Les taux sur les bons du Trésor sont passés d’un niveau plancher de 3 % à la fin de 2002 à un niveau moyen de 15 % à la fin de 2005 ; ils sont ensuite devenus extrêmement volatils, les écarts de mois en mois atteignant près de 10 points de pourcentage. Entre 2001 et 2005, les émissions de titres de dette intérieure se sont sensiblement multipliées, pour les besoins des opérations de stérilisation et de financement du budget. La courte échéance des titres d’État entraînait une révision fréquente et défavorable des taux. Du côté de la demande, l’augmentation rapide des prêts au secteur privé, amorcée en 2003, a réduit les fonds que les banques commerciales consacraient habituellement aux titres d’État. Si les facteurs mentionnés ci-dessus ont sans doute contribué à la hausse des rendements observés en République-Unie de Tanzanie, la forte concentration de titres de dette publique et la volatilité des rendements tout au long de 2006 et de 2007 suggèrent que des facteurs tels que des positions de force sur le marché, des décisions stratégiques d’investissement et l’étroitesse du marché sont peut-être aussi entrés en ligne de compte.
La République-Unie de Tanzanie dispose de suffisamment de marge de manœuvre pour accroître sa dette intérieure sans évincer le crédit bancaire au secteur privé et créer des pressions inflationnistes sur l’économie. Au vu du ratio moyen dette intérieure/dépôts bancaires qui est inférieur à 30 %, de l’important potentiel de développement du secteur financier et de la présence d’acteurs institutionnels et d’acteurs étrangers sur les marchés financiers, les capacités d’émission de titres de dette intérieure semblent prometteuses. Toutefois, la dette publique extérieure, en part tant du PIB que des exportations, augmente rapidement (tableau 2).
La République-Unie de Tanzanie devrait néanmoins être en mesure de supporter une augmentation de l’encours de sa dette intérieure sans pour autant que sa croissance soit compromise ; sa dette est en effet émise sous la forme de titres négociables, elle est assortie de taux d’intérêt réels positifs et elle est de plus en plus fréquemment placée auprès d’investisseurs non bancaires, en particulier auprès de fonds de pension et de compagnies d’assurances. Dans l’ensemble, les titres du Trésor tanzanien affichent des taux de rendement réel positifs depuis 2002.
Zambie
À la fin des années 1960, la Zambie a financé le développement du secteur public et les dépenses sociales élevées grâce aux recettes provenant de l’exploitation du cuivre, qui avait connu dix ans de forte expansion. Or, malgré les réformes menées dans le cadre d’une série de programmes d’ajustement structurel soutenus par le FMI et la Banque mondiale, mais abandonnés à la fin des années 1980, l’économie était stagnante, le déficit budgétaire élevé et l’inflation croissante (Hill and MacPherson, 2004).
Dans les années 1990, le Gouvernement zambien a adopté un programme de réforme économique appuyé par le FMI, qui lui a permis de diminuer radicalement ses dépenses. Un cadre de gestion de la trésorerie fondé sur le principe qu’il n’y aurait pas de financement monétaire net des déficits publics a été mis en place en 1993, afin de réduire la charge de financement du déficit. Globalement, les programmes de stabilisation mis en œuvre dans le cadre de la Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI visaient à contenir progressivement le recours à l’emprunt sur le marché intérieur. Il s’agissait d’améliorer la position en matière d’endettement intérieur et de limiter l’éviction du crédit au secteur privé. Le Gouvernement s’est donc fixé pour priorité de maximiser les sources de financement concessionnel et de faire appel au marché intérieur pour financer le déficit résiduel aux conditions du marché. Toutefois, l’emprunt intérieur a augmenté plus que prévu, lorsque les emprunts concessionnels se sont révélés insuffisants pour financer les déficits budgétaires. En 2004, des mesures de rééquilibrage budgétaire ont été prises, qui ont sensiblement réduit les besoins de financement intérieur du Gouvernement, atténué les pressions tendant à la monétisation de la dette et réduit l’éviction des crédits bancaires au secteur privé. Les mesures d’allégement dont la Zambie a bénéficié au titre de l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de l’Initiative d’allégement de la dette multilatérale en 2006 ont renforcé la croissance et la stabilité macroéconomique. Avec un PIB réel affichant une progression moyenne de 4,5 % par an, le pays s’est redressé après une période de stagnation économique et de baisse du revenu par habitant qui a duré plus de vingt ans.
Toutefois, dans la période 2011-2014, la baisse des prix du cuivre et la forte hausse des traitements des fonctionnaires ont creusé les déficits budgétaires. À cela s’ajoutait l’accumulation des créances au titre du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux exportateurs et d’autres arriérés de dépenses publiques. Selon les estimations du FMI, ces impayés sont passés de 1 % à 3 % du PIB entre la fin de 2013 et la fin de 2014. En ce qui concerne les dépenses, les arriérés intérieurs dus au titre du régime public des pensions, des travaux confiés à des entreprises routières et des engagements liés aux subventions agricoles représentaient, en 2014, 2,5 % du PIB.
La corrélation entre le financement intérieur et l’ampleur du déficit budgétaire s’est accentuée après 1993 et les réformes financières qui ont abouti à la libéralisation des taux d’intérêt et à la mise en place d’un certain nombre d’instruments de financement du déficit. C’est à partir de cette date que le Gouvernement a commencé à financer systématiquement ses déficits budgétaires sur le marché intérieur. Le financement intérieur net a augmenté, malgré les engagements pris par le Gouvernement, dans le cadre de plusieurs programmes de stabilisation soutenus par le FMI, de veiller à ce que, à moyen et à long termes, l’emprunt intérieur ne dépasse pas 0,5 % du PIB, afin d’éviter l’éviction des crédits au secteur privé. En conséquence, la valeur nominale de la dette intérieure a augmenté rapidement (fig. 20a). En 2001, la restructuration du bilan de la Banque de Zambie et de la Zambia National Commercial Bank, détenue par l’État, a conduit à une importante émission de titres publics spéciaux en faveur de la Banque de Zambie (1 647 milliards de kwachas zambiens, soit 12,6 % du PIB, en 2001) et de la Zambia National Commercial Bank (248 milliards de kwachas zambiens, soit 1,5 % du PIB, en 2002).
La dette gouvernementale était constituée d’emprunts, d’avances et de crédits-relais détenus par la Banque de Zambie. Les crédits-relais en kwachas étaient les fonds accordés au Gouvernement par la Banque de Zambie pour financer le déficit budgétaire, tandis que les crédits-relais en devises étaient accordés au Gouvernement pour financer le service de la dette extérieure. Le système bancaire reste la principale source de financement du Gouvernement zambien, même si le secteur non bancaire prend une part de plus en plus active. La part de titres d’État détenus par la Banque de Zambie est restée bien au-dessous de 10 % (fig. 20c), sauf en 2006 et 2007 où, après le point d’achèvement, elle s’est élevée à 19 % et 15 % respectivement. Les bons du Trésor sont demeurés le principal instrument de financement du Gouvernement, représentant au moins 90 % du portefeuille de la dette entre 1995 et 2000, avant de diminuer à partir de 2001 lorsque des mesures ont été prises pour allonger les maturités (IMF, 2015b).
Afin de favoriser le développement d’un marché des obligations à long terme, le Gouvernement a lancé des obligations à 3 et 5 ans en août 2005 ; dans le même temps, il a entrepris de retirer graduellement les titres à 12 et 18 mois. Ces obligations à long terme représentaient une avancée vers la stabilité macroéconomique et l’amélioration du système financier zambien. Les autorités espéraient que ces titres procureraient aux investisseurs institutionnels et autres de nouveaux produits d’investissement dont ils avaient grand besoin et qu’ils serviraient de référence pour l’établissement des prix des instruments privés à long terme. En 2005, le montant des émissions de titres d’État a été calculé sur la base des besoins de financement du Gouvernement et de la nécessité de contenir les excédents de liquidité pour contribuer à réduire l’inflation. À cet égard, la taille moyenne des adjudications hebdomadaires de bons du Trésor et d’obligations d’État a fortement augmenté. À la fin de 2014, le portefeuille de la dette intérieure titrisée était composée à 54 % de bons du Trésor et à 46 % d’obligations du Trésor, exposant le Gouvernement à un risque de refinancement qui demeurait élevé (fig. 20b).
Le coût de l’emprunt sur le marché intérieur a été généralement plus élevé que le coût sur les marchés extérieurs, principalement à cause du sous-développement des marchés financiers. Le coût implicite de la dette intérieure est passé d’environ 34 % à la fin de 1995 à plus de 46 % à la fin de 1996 (fig. 20d). Cela dit, la réduction des emprunts publics entre 1996 et 2000 a contribué à faire baisser les taux d’intérêt et le coût implicite de la dette publique, qui est tombé à 8 % en 2011. Récemment, en raison d’importants besoins de financement public, les taux intérieurs ont bondi, le taux sur le bon du Trésor à 1 an grimpant d’environ 12 % en 2012 à plus de 20 % en 2014. En conséquence, le coût implicite de la dette intérieure augmente depuis 2012. Le taux d’inflation annuel est passé de 7,1 % en 2013 à 7,9 % en 2014, poussé par une forte augmentation des traitements des fonctionnaires à la fin de 2013, la dépréciation de la monnaie au premier semestre de 2014 et la hausse des prix des carburants et des tarifs de l’électricité. Malgré les variations de l’inflation et des taux de change, la Zambie est l’un des quelques pays d’Afrique qui a réussi à faire en sorte que les taux de rendement réel sur les titres d’État restent, dans l’ensemble, positifs (fig. 20e). Cette situation a aussi incité les banques à revoir leurs portefeuilles et à se détourner des actifs étrangers pour profiter des rendements plus favorables servis sur la dette intérieure. C’est ainsi que l’appétit des investisseurs pour les titres d’État ne s’est pas démenti depuis 2006, et que les adjudications sont largement sursouscrites.
En 2004, l’environnement macroéconomique et la confiance dans l’économie s’étant améliorés, les investisseurs étrangers ont recommencé de souscrire la dette publique zambienne, à laquelle ils tournaient le dos depuis 1994. À la fin de 2005, l’encours de la dette publique détenue par des investisseurs étrangers avait atteint 139,8 millions de dollars (477,5 milliards de kwachas zambiens), alors qu’il était inférieur à 214 000 dollars (1 milliard de kwachas zambiens) à la fin de 2004 (tableau 6). À la fin de 2005 toujours, les investisseurs étrangers détenaient environ 13 % de l’encours de la dette intérieure titrisée, dont 103,1 millions de dollars (352,2 milliards de kwachas zambiens) en bons du Trésor, et le reste en obligations d’État. Dans le portefeuille des bons du Trésor, les investisseurs détenaient la majorité des bons à 364 jours, soit 60 % du portefeuille. En ce qui concerne les obligations d’État, les investisseurs détenaient environ 47 % des titres à 5 ans. D’autres raisons expliquent l’afflux en Zambie de capitaux privés, provenant notamment des fonds spéculatifs : l’amélioration des fondamentaux macroéconomiques et la stabilisation des politiques publiques, qui ont réduit la prime de risque du pays, l’absence de contrôle sur les capitaux étrangers, et la transparence des adjudications organisées par la Banque de Zambie.
Depuis 2006, le marché des effets publics zambiens est devenu plus compétitif. L’écart de rémunération par rapport aux autres marchés émergents d’Afrique s’est sensiblement réduit, les investisseurs locaux, en particulier les fonds de pension, en quête d’investissements à plus long terme pour faire face à leurs engagements surenchérissant par rapport aux investisseurs étrangers. La Banque de Zambie a commencé de constituer un réseau d’opérateurs primaires afin d’encourager les ventes de titres d’État sur le marché secondaire.
La bonne tenue des fondamentaux macroéconomiques et les rendements relativement élevés ont contribué à attirer les investisseurs de portefeuille étrangers en 2006-2007. Toutefois, l’éclatement de la crise financière en 2008 s’est soldé en fin d’année par un retrait massif (-19 %) des investisseurs étrangers du marché des titres d’État. En raison de la lenteur du redressement des conditions financières au niveau mondial, la participation des investisseurs étrangers aux marchés de la dette publique est restée timide en 2009, après les fuites de capitaux qu’a subi le pays au plus fort de la crise de 2008. En 2009, la part des titres d’État détenus par des non-résidents a encore diminué de 34 %, pour s’établir à 121,2 millions de dollars à la fin de l’année, contre 182,8 millions de dollars en 2008. Les titres détenus par des investisseurs étrangers représentaient 7 % du total de l’encours de la dette, soit 14 % de moins qu’à la fin de 2008. Toutefois, en 2010-2014, à mesure que les risques associés à la crise financière mondiale et à la récession économique s’estompaient et que les perspectives macroéconomiques du pays s’amélioraient, les investisseurs étrangers sont revenus sur le marché zambien de la dette (tableau 6). Il importe de noter que ces investisseurs sont plus présents sur le marché des bons du Trésor, signe peut-être qu’ils ont des doutes sur la cohérence de la politique macroéconomique du pays, mais qui soulève aussi le problème de l’exposition au risque de refinancement.
Toute augmentation des emprunts publics sur le marché intérieur risque de faire obstacle à l’investissement dans le secteur privé et de causer des pressions inflationnistes. Bien que le niveau de la dette soit modéré, compte tenu de la petite taille du marché financier intérieur et donc de ses capacités d’absorption, le Gouvernement pourrait limiter le financement intérieur à moins de 2 % du PIB pour éviter d’évincer le crédit au secteur privé (IMF, 2015a). Du fait de l’accumulation accélérée de sa dette extérieure, la Zambie doit trouver le bon compromis entre la nécessité de réduire son important déficit budgétaire et celle d’investir dans ses infrastructures. Le risque est d’autant plus important qu’une large part de l’encours de la dette intérieure est constituée d’instruments à court terme. Le Gouvernement fait néanmoins de plus en plus appel au secteur non bancaire, ce qui peut atténuer l’effet d’éviction du secteur privé. Il serait possible d’améliorer encore la situation en renforçant les capacités de gestion du service national de la dette et en réduisant les subventions publiques, qui représentaient 2 % du PIB en 2014. Les régimes de pensions pourraient aussi être réformés de façon à viabiliser leurs opérations. À la fin de 2014, les arriérés au titre du fond de pension des fonctionnaires s’élevaient à 1,6 % du PIB ; le Gouvernement compte les apurer d’ici à 2018 (IMF, 2015a). L’emprunt auprès de créanciers privés expose aussi les pays africains à l’action des fonds vautours et aux procédures d’arbitrage en matière d’investissement. Ces dernières années, la Zambie a, par exemple, été la cible de poursuites coûteuses de la part de fonds vautours (Pulitzer Centre on Crisis Reporting, 2014)26.
Principales conclusions et recommandations
Le présent chapitre contient des données nouvelles sur l’évolution de la dette intérieure dans cinq pays africains entre 1995 et 2014. Premièrement, les faits stylisés issus de l’analyse de ces données font apparaître une augmentation progressive de la dette intérieure, qui est passée en moyenne de 11 % du PIB en 1995 à 17 % du PIB en 2014. Deuxièmement, comme le montrent des études antérieures (Christensen, 2004), la charge des intérêts de la dette intérieure demeure supérieure à celle de la dette extérieure, mais elle diminue au fil du temps, avec le développement des marchés intérieurs. Toutefois, la dette extérieure s’accompagne de risques de change dont la dette intérieure est exempte ; le coût des intérêts sur la dette en monnaie locale ne devrait donc pas être considéré comme un obstacle à la levée de fonds sur les marchés intérieurs pour le financement du développement. Troisièmement, au cours des dix dernières années, de plus en plus de pays ont acquis les capacités nécessaires pour émettre des titres de dette à long terme libellés en monnaie locale, ce qui permet de supposer que le problème du péché originel serait peut-être en train d’être surmonté. Dans l’ensemble, le marché s’est développé, les échéances sont plus longues et la base d’investisseurs plus large, rendant l’emprunt intérieur beaucoup plus facile pour les gouvernements. De plus, le cycle financier mondial a peut-être aussi facilité le processus, les investisseurs internationaux ayant recherché très activement de meilleurs rendements sur les marchés émergents.
Si le risque de manquer de financement pour faire les investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable reste très réel dans de nombreux pays, les faits tendent à montrer qu’il recule, à en juger par l’intérêt récent porté aux obligations dans les pays et aux obligations libellées en monnaie locale à l’étranger. Cet intérêt accru, conjugué au renforcement de la stabilité macroéconomique, multiplie les possibilités de lever des fonds sur les marchés intérieurs des pays africains pour financer le développement du continent. Certains États qui approchent le statut de pays à revenu moyen inférieur pourraient supporter un niveau d’endettement intérieur plus élevé sans compromettre leurs perspectives de croissance économique, car ils ont pris des mesures pour diversifier leur base d’investisseurs, développer leurs marchés financiers et créer de nouveaux instruments de dette. Toutefois, il est possible d’améliorer encore le fonctionnement des marchés intérieurs existants, notamment en réformant le secteur financier non bancaire pour élargir la base des investisseurs en instruments de dette publique à long terme. Le renforcement du secteur des pensions de retraite et du secteur des assurances augmentera le montant des fonds à long terme dont les marchés intérieurs de la dette ont besoin.
Les pays devraient examiner les sources tant traditionnelles que nouvelles de financement du développement. Le recours accru à l’emprunt comme instrument de mobilisation des ressources intérieures pour le financement du développement pourrait contribuer à réduire l’exposition du continent à la volatilité de l’investissement étranger direct et de l’aide publique au développement et lui redonner de la marge d’action. Il pourrait aussi amener les gouvernements à mieux prendre leurs responsabilités politiques et à s’approprier leur stratégie de développement, car le fait de pouvoir compter sur des sources internes pour financer ce développement peut réduire la vulnérabilité liée à l’endettement extérieur. Tous ces éléments devraient toutefois être mesurés à l’aune des risques d’une exposition accrue aux changements d’appréciation des investisseurs.
Chapitre 4
MODALITÉS COMPLÉMENTAIRES DE FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE
A. INTRODUCTION
Les chapitres précédents ont montré que la dette intérieure et la dette extérieure sont en augmentation en Afrique, et que le fait d’assurer la viabilité des niveaux d’endettement permettra de limiter les nouvelles hausses. Devant le tarissement du financement traditionnel, la question se pose de savoir comment combler les besoins croissants du continent en la matière. Il existe un large éventail de modalités complémentaires de financement du développement qui exploitent les ressources existantes et s’appuient sur celles-ci pour en mobiliser de nouvelles. Ces modalités vont des partenariats public-privé (PPP), des fonds souverains, des envois de fonds, des obligations-diaspora, des obligations indexées sur le PIB et des fonds pour le climat jusqu’aux nouvelles émissions de droits de tirage spéciaux et aux réserves internationales, en passant par des politiques visant à endiguer les flux financiers illicites.
Les pays africains ayant exploré plusieurs de ces modalités, ils disposent à cet égard d’une certaine expérience. Le rapport porte principalement sur trois importantes modalités de financement du développement. Le présent chapitre examine tout d’abord les avantages et les inconvénients des partenariats public-privé, car ils ont connu un essor rapide en Afrique au cours de la dernière décennie, en particulier pour ce qui est du financement des infrastructures. Il se penche ensuite de manière plus approfondie sur le rôle des envois de fonds et des obligations-diaspora, étant donné qu’ils constituent une importante source de financement anticyclique pour de nombreux pays en développement. En outre, depuis 2010, l’Afrique a reçu plus de devises grâce aux envois de fonds que par le biais de l’investissement étranger direct ou de l’aide publique au développement. Enfin, le chapitre examine les flux financiers illicites, leur ampleur ayant privé l’Afrique d’une source de financement du développement majeure.
B. PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ
Confrontés à l’insuffisance des fonds publics, de nombreux pays en développement privilégient les modalités de financement qui s’appuient sur les ressources du secteur privé pour multiplier la contribution des ressources existantes. Dans ce contexte, les partenariats public-privé (encadré 5) ont commencé à jouer un rôle plus prépondérant dans le financement du développement. Les pays en développement ont ainsi enregistré ces dix dernières années une augmentation considérable du montant des ressources investies dans ce type de partenariats (Romero, 2015). La même tendance a été observée en Afrique, les PPP étant de plus en plus utilisés comme mode de financement alternatif, en particulier pour financer l’infrastructure.
Encadré 5. Qu’est-ce-qu’un partenariat public-privé ?
Il n’existe pas une définition unique, internationalement reconnue, de ce concept. La Banque mondiale (2016e), par exemple, définit le partenariat public-privé comme un arrangement contractuel à long terme entre une entité ou une autorité publique et une entité privée afin de fournir un bien ou un service public et dans le cadre duquel la partie privée assume une part importante du risque et des responsabilités de gestion. Cette définition inclut les PPP qui offrent des biens et des services, existants ou nouveaux. Elle englobe également les partenariats où la partie privée est entièrement rémunérée par les utilisateurs des services et ceux où l’organisme public effectue une partie ou la totalité des paiements (World Bank et al., 2014).
La longue durée des contrats et la gestion des risques par le partenaire privé sont deux éléments qui distinguent les PPP des autres types de partenariats associant acteurs publics et privés. En règle générale, la société privée concernée tire une partie de ses recettes du budget de l’État ou de diverses redevances pour service rendu, ou des deux à la fois. Outre les allocations budgétaires, la contribution des pouvoirs publics prend souvent la forme d’accès à la terre, de biens, de garanties de crédit, de financement de la dette et/ou de prise de participation pour couvrir les dépenses en capital. Il existe une vaste gamme de PPP axés sur le développement des infrastructures, notamment ceux alliant conception-construction-financement-exploitation ; conception-construction-exploitation ; exploitation-entretien ; construction-exploitation-transfert ; ainsi que les concessions ; les contrats de location ; et les contrats axés sur la gestion et les résultats.
À certains égards, il est plus facile de définir les partenariats public-privé en fonction de ce qu’ils ne sont pas. Ainsi, ils ne constituent pas une forme de privatisation, car la prestation des services publics demeure la responsabilité de l’État alors que, dans le cas d’une privatisation, cette responsabilité est transférée au secteur privé, même lorsque l’État conserve les pouvoirs de réglementation. Les PPP ne constituent pas non plus une forme de marchés publics, car ces derniers concernent la location ou l’achat ponctuel d’un bien ou d’un service par l’État, tandis que les premiers sont souvent d’une plus grande ampleur, font appel à des instruments financiers plus complexes et couvrent une plus longue période. Ces partenariats sont devenus un élément important de la lutte contre le déficit d’infrastructures en Afrique. L’une des clefs de leur succès tient au fait qu’ils permettent de trouver le bon équilibre entre les secteurs public et privé et de répartir les risques entre ces différents acteurs.
L’infrastructure est l’une des principales priorités de développement de l’Afrique. Ainsi, l’Agenda 2063 vise notamment à établir une infrastructure d’intégration de stature internationale qui desservirait l’ensemble du continent. Pour atteindre cet objectif, les États Membres de l’Union africaine se sont engagés à prendre une série de mesures destinées à développer les infrastructures des transports, de l’énergie et des technologies de l’information et des communications, et se sont dits déterminés à mobiliser les ressources de l’Afrique afin de financer le développement des infrastructures. Les PPP sont considérés comme une solution prometteuse pour attirer les investisseurs privés requis à cette fin. Par conséquent, le présent chapitre met l’accent sur les partenariats public-privé axés sur le développement des infrastructures. La section ci-après décrit les PPP qui existent en Afrique afin de donner un aperçu de l’ampleur et de la répartition des ressources qui y sont investies.
Caractéristiques des partenariats public-privé axés sur le développement des infrastructures
Bénéficiaires des partenariats public-privé, valeurs, secteurs et types de contrats
D’après la base de données de la Banque mondiale sur la participation privée aux infrastructures27, le nombre de PPP axés sur le développement des infrastructures est en hausse en Afrique, bien qu’à partir d’un plancher plus bas, et représente environ 10 % de la valeur totale de ces partenariats à l’échelle mondiale, et 594 PPP, d’une valeur de 235 milliards de dollars, ont été clos du point de vue financier depuis 1990. La valeur et le nombre des partenariats destinés à développer les infrastructures sont relativement moindres en Afrique que dans d’autres régions du monde, notamment en Amérique Latine et dans les Caraïbes, en Asie de l’Est et dans le Pacifique (fig. 21).
La répartition des PPP par pays varie énormément d’un bout à l’autre de l’Afrique. Sur les 52 pays africains28 examinés au cours de la période 1990-2014, le Nigéria se classe premier, avec des investissements atteignant 37,9 milliards de dollars, suivi par le Maroc (27,5 milliards de dollars), l’Afrique du Sud (25,6 milliards de dollars), l’Égypte (24,8 milliards de dollars) et l’Algérie (13,2 milliards de dollars). Pris globalement, ces cinq pays représentent près des deux tiers de la valeur totale des investissements africains s’inscrivant dans des PPP tandis que, par ailleurs, la moitié des pays du continent africain (27 pays) y ont investi moins d’un milliard de dollars. Les pays dont la valeur des PPP axés sur le développement des infrastructures est la moindre sont l’Éthiopie, les Comores et le Swaziland, où ces investissements ont été minimes, comme le montre la figure 22.
Bien que la valeur totale des investissements nationaux s’inscrivant dans des PPP varie considérablement d’un pays africain à l’autre, la répartition sectorielle semble en général être assez homogène29. Ainsi, dans la plupart des pays, le secteur des télécommunications arrive en tête, avec 68 % des investissements d’infrastructures, suivi par le secteur de l’énergie (21 %) et par le secteur des transports (10 %). Dans la majorité des pays, c’est le secteur de l’eau et de l’assainissement qui enregistre la valeur totale des investissements la moins élevée, soit 1 %.
La figure 23 compare quant à elle la répartition sectorielle des partenariats public-privé en Afrique (a) et dans le monde (b). Elle indique que les secteurs des télécommunications et de l’électricité représentent 29 % de la valeur des PPP en Afrique, contre 40 % au niveau mondial. Alors que les partenariats public-privé visant à construire des routes se classent au troisième rang à l’échelle mondiale, représentant 17 % de la valeur des PPP, ce chiffre n’est que de 1 % en Afrique. D’autres secteurs semblent moins prioritaires en Afrique, notamment les aéroports, l’eau et l’assainissement, les chemins de fer et le gaz naturel. La même tendance est observée au niveau mondial.
Les PPP vont des simples contrats de services jusqu’aux concessions de grande ampleur, en passant par les projets de création d’infrastructures30 et les cessions (UNCTAD, 2015c). Comme le montre la figure 24, la très grande majorité (70 %) des PPP axés sur le développement des infrastructures concernent la création d’infrastructures (valeur estimée à 143,3 milliards de dollars). Ces types de PPP sont très répandus dans les quatre secteurs mentionnés ci-dessus, celui des télécommunications représentant la valeur la plus importante (97,2 milliards de dollars). Les PPP destinés à la création d’infrastructures prévoient généralement des investissements dans de nouvelles installations, qui peuvent revenir au secteur public à la fin de la période de concession.
Les cessions représentent quant à elle 22 % de la valeur des investissements effectués dans le cadre de PPP. Ces contrats concernent la plupart du temps le secteur des télécommunications et, dans une bien moindre mesure, celui de l’énergie. Ces investissements sont à relativement forte intensité de capital, comme en témoigne le faible nombre de projets, représentant pourtant une valeur de 43,9 milliards de dollars. Les cessions supposent la vente d’une entreprise d’État au secteur privé. Il peut s’agir d’une cession totale31, soit un transfert à 100 %, ou d’une cession partielle, lorsque le gouvernement ne transfère qu’une partie de l’entreprise au secteur privé. C’est au Maroc, en Tunisie, en Afrique du Sud et en Égypte que l’on retrouve les plus grands projets de cession (secteur des télécommunications), leur valeur étant estimée à plus d’un milliard de dollars.
Les concessions représentent pour leur part 8 % de la valeur des investissements s’inscrivant dans des PPP, soit 17,1 milliards de dollars. Elles concernent principalement des PPP instaurés dans le secteur de l’énergie, puis dans une moindre mesure dans celui des transports. Elles constituent la forme la plus traditionnelle de partenariats public-privé, soit lorsqu’une entité privée reprend généralement les responsabilités de gestion d’une entreprise d’État pour une période donnée au cours de laquelle elle effectue d’importants investissements et assume les risques d’investissement connexes. De nombreux pays africains (27) comptent au moins un contrat de concession dans le secteur des transports et/ou dans celui de l’énergie. Ces contrats nécessitent aussi des fonds propres importants, le plus gros (3 milliards de dollars) ayant été établi par le Maroc dans le secteur de l’énergie, le deuxième en importance ayant été conclu par le Nigéria dans le secteur des transports (2,4 milliards de dollars).
Les contrats de gestion et de location représentent quant à eux moins de 1 % (276 millions de dollars) de la valeur des investissements réalisés dans le cadre d’un PPP. Ces partenariats concernent essentiellement le secteur de l’eau et de l’assainissement, suivi par les secteurs des transports, des télécommunications et de l’énergie. La plupart des projets ne requièrent aucun investissement, un seul d’entre eux, établi par l’Algérie dans le secteur des transports, ayant nécessité un investissement de 161 millions de dollars. Selon ce type d’arrangement, une entité privée est chargée de gérer une entreprise publique pour une période donnée moyennant une redevance. Dans le cas des contrats de gestion, le gouvernement demeure le principal preneur de risques alors que, dans le cas des contrats de location, il délègue les risques à un exploitant privé. Dans les deux cas, l’État continue d’être propriétaire de l’entreprise et de prendre les décisions en matière d’investissement.
Facteurs déterminants des partenariats public-privé axés sur le développement des infrastructures
Arguments en faveur des partenariats public-privé
Les PPP sont de plus en plus courants en raison des avantages escomptés et connexes qu’ils offrent.
Ces partenariats permettent d’avoir accès à des sources de financement additionnelles, de s’appuyer sur les ressources du secteur privé pour multiplier la contribution des ressources existantes et d’améliorer la qualité des services publics. Grâce à eux, l’État peut tirer parti des compétences spécialisées, des technologies et de l’esprit d’innovation du secteur privé, ce qui conduit à une plus grande efficacité opérationnelle et, partant, à des services publics de meilleure qualité. Les PPP peuvent donc être des instruments attrayants pour les pays en développement qui cherchent à améliorer la qualité et la compétitivité de leur offre de services. Ce constat vaut particulièrement pour les services d’infrastructure, tels que les télécommunications, où la compétitivité dépend du haut niveau de compétence des prestataires et des technologies de pointe (UNCTAD, 2015c).
Par ailleurs, les gains d’efficacité dégagés doivent compenser les coûts de financement supérieurs des PPP pour respecter le principe de l’additionnalité des ressources. Ces coûts ont en effet tendance à être plus élevés, étant donné que les partenaires privés doivent généralement assumer des coûts de financement plus importants que les pouvoirs publics. Le Rapport sur le commerce et le développement, 2015 (UNCTAD, 2015b) appelle donc à la prudence face à l’idée que les PPP mènent nécessairement à l’attribution de ressources additionnelles au secteur public. Il indique en effet qu’à l’échelle mondiale, les résultats sur le plan de l’additionnalité des ressources sont, au mieux, ambigus car les gains d’efficacité sont mitigés.
Dans le contexte africain, toutefois, les PPP ont permis d’élargir les nouveaux services d’infrastructure, ce qui laisse présager une certaine additionnalité. On pourrait aussi invoquer le fait que les acteurs privés et publics montrent un intérêt constant et croissant dans ces partenariats32. Cette situation pourrait bien être celle de nombreux pays Africains qui luttent pour assurer le financement de leurs projets d’infrastructure. Pour les gouvernements dont l’accès au crédit est limité au point qu’ils ne peuvent emprunter, le partenariat public-privé est une modalité de financement envisageable.
Les PPP offrent d’autres avantages connexes sur les plans de la formation et du perfectionnement professionnel, de la recherche-développement et de l’échange de connaissances. Ils permettent de développer les capacités du secteur privé local grâce à l’établissement de coentreprises avec de grandes entreprises internationales et offrent des possibilités de sous-traitance aux entreprises locales dans des domaines tels que les travaux de génie civil et électrique ; la gestion des installations ; ainsi que les services de sécurité, de nettoyage et d’entretien (UNCTAD, 2015d).
Les partenariats public-privé peuvent constituer une solution de rechange à l’obtention de prêts sur le marché financier ou à la privatisation. Contrairement à cette dernière, l’État n’a pas à renoncer au contrôle d’un service public, car il ne s’agit pas d’une privatisation totale (Qizilbash, 2011). En outre, ces partenariats permettent de répartir les risques associés à un projet entre les acteurs publics et privés. Une répartition adéquate des risques, suivant les capacités de gestion des risques de chacun, donne l’occasion de réduire le coût total que l’État doit supporter. En règle générale, le secteur privé assume les risques liés à la construction et à l’environnement, tandis que le secteur public accepte les risques liés à la réglementation et le risque de change, les risques financiers et commerciaux étant partagés entre eux. Ce qui distingue le plus les PPP des autres modalités de financement du développement est peut-être leur souplesse. Ces instruments peuvent en effet être adaptés aux besoins spécifiques inhérents à une relation contractuelle entre acteurs publics et privés.
Action régionale en faveur des partenariats public-privé
Au niveau régional, les partenariats public-privé sont utilisés pour financer d’importants projets transnationaux dans les secteurs des télécommunications, des transports, de l’eau et de l’énergie dans un grand nombre de pays africains. Plusieurs initiatives et programmes établis au niveau panafricain sont axés sur les PPP. Le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique considère les PPP comme une solution prometteuse afin d’attirer les investisseurs privés si nécessaires au développement des infrastructures africaines (African Union, 2001).
La valeur de ces partenariats est également reconnue dans le Programme de développement des infrastructures en Afrique. De nombreux pays ne sont toutefois pas en mesure de tirer pleinement parti de l’intérêt que le secteur privé porte aux projets d’infrastructure parce qu’ils ne disposent ni de la réglementation, ni des compétences locales requises et qu’ils ne comprennent pas bien la répartition des risques propre aux PPP, ce qui est susceptible d’empêcher ces partenariats de contribuer à la transformation de l’Afrique (African Union et al., 2010).
Les communautés économiques régionales33 s’emploient à améliorer la situation en instaurant des PPP qui reposent sur des règlements ou des instruments modaux. Le Protocole sur l’énergie de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest constitue un bon exemple à cet égard, car il vise à promouvoir l’élaboration de divers programmes énergétiques grâce à la mobilisation des investissements du secteur privé dans l’énergie. Le Protocole a également servi de fondement à l’accord établissant le pool énergétique de l’Afrique de l’Ouest, qui comprend 14 États membres de la Communauté et fixe le cadre de la participation et de l’association des entités publiques et privées du secteur de l’énergie faisant partie du pool.
Le cadre régional de la Communauté de développement de l’Afrique australe qui régit les PPP fait aussi partie des nouvelles politiques et réglementations régionales en la matière. Ce cadre donne la priorité au développement des infrastructures dans les 15 pays membres de la Communauté et établit un ensemble de principes et de directives à partir des exemples de PPP existants pour soutenir les institutions de la région qui participent à l’élaboration et à la gestion de tels partenariats. Dans le même ordre d’idées, le Marché commun de l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe (COMESA) a publié, fin 2013, un cadre directif en matière de surveillance et d’évaluation à l’intention de ses 20 États membres, afin d’harmoniser la structure des PPP conclus dans la région.
La Communauté d’Afrique de l’Est propose quant à elle une autre initiative intéressante, à savoir un cadre législatif et institutionnel pour les PPP axés sur le développement des infrastructures. Lancé en 2012, le réseau des services consultatifs sur les partenariats public-privé a pour objectif d’aider la Communauté à renforcer les capacités des États Membres afin qu’ils puissent tirer un meilleur parti de ces PPP. Du point de vue de l’action publique, ces efforts sont jugés propices à l’élaboration d’une politique régionale sur les partenariats public-privé qui cherchera à harmoniser la réglementation, les normes et les politiques en vigueur dans l’ensemble de la Communauté (World Bank, 2014).
Dans le même esprit, un certain nombre de protocoles régionaux sur l’investissement, comme ceux du COMESA, de la Communauté d’Afrique de l’Est, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de la Communauté de développement de l’Afrique australe, abordent implicitement la question des PPP. Par exemple, l’Accord portant création de la zone d’investissement commune du COMESA a notamment pour but de promouvoir le Marché commun en tant que zone d’investissement attractive (art. 2). L’Accord dispose (art. 1.9) que l’investissement s’entend « des actifs admis ou admissibles en conformité avec les lois et règlements pertinents de l’État membre du COMESA sur le territoire duquel l’investissement est effectué » et fournit une liste positive de ce qui est considéré comme un investissement. Cette liste comprend entre autres « les concessions commerciales conférées par la loi ou par contrat, y compris pour la construction, l’exploitation, la propriété/le transfert, la modernisation, l’élargissement, la restructuration et/ou l’amélioration des infrastructures ; ainsi que les concessions pour la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles », ce qui correspond aux formes traditionnelles de partenariats public-privé.
Il en va de même des règles d’investissement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Une autre loi, établissant les règles communautaires sur l’investissement et leurs modalités d’application au sein de la Communauté, inclut dans la définition d’investissement « les droits découlant de contrats clefs en main ou de contrats de construction, de gestion, de production ou de partage des recettes, de concessions ou d’autres contrats analogues »34. De même, le Protocole sur la finance et l’investissement de la Communauté de développement de l’Afrique australe définit l’investissement comme « les droits conférés par la loi ou par contrat, y compris les licences pour la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation des ressources naturelles »35.
Les partenariats public-privé sont également visés par certains règlements sur l’investissement adoptés par des communautés économiques régionales, mais il est trop tôt pour en évaluer les incidences. En principe, un PPP visé par l’un des accords existants et conclu par un investisseur d’un État Membre pourrait relever du mécanisme de règlement des différends prévu dans ces divers protocoles sur l’investissement. Cela en soi pourrait être contesté devant un tribunal national ou régional et, partant, influer sur la capacité institutionnelle de mieux comprendre la réglementation et les clauses contractuelles des PPP.
Problèmes et facteurs de risque associés aux partenariats public-privé axés sur le développement des infrastructures
L’utilisation, par de nombreux pays, des partenariats public-privé comme modalité de financement a mis au jour plusieurs problèmes et risques connexes, qui sont examinés dans la présente section. La possibilité que ces partenariats deviennent un fardeau budgétaire constitue le principal facteur de risque, ce qui mérite une analyse minutieuse dans le contexte du financement du développement en Afrique.
Les partenariats public-privé traités comme des passifs éventuels et leur incidence sur la viabilité de la dette
Les PPP sont souvent traités comme des opérations hors budget comptabilisées en tant que passifs éventuels, ce qui signifie que les obligations de l’État n’ont pas à être exécutées immédiatement et dépendent de certaines conditions. Ces obligations peuvent être explicites, et sont alors précisées dans un contrat ou prennent la forme de garanties expressément formulées par l’État. S’il est vrai que ce mécanisme ou traitement permet aux pays concernés d’élargir leur marge de manœuvre budgétaire, il peut aussi être générateur d’obligations.
Par exemple, même si une dette contractée au titre du développement des infrastructures dans le cadre d’un PPP est officiellement assumée par le secteur privé et n’est pas comptabilisée dans le budget de l’État, ce partenariat oblige les pouvoirs publics à acheter les services d’un exploitant privé donné et à honorer les garanties (Jubilee Debt Campaign, 2012). Toutefois, comme l’exécution de ces obligations prend généralement du temps et que les garanties s’appliquent seulement lorsque les PPP échouent ou ne donnent pas les résultats escomptés, ces éléments sont souvent considérés comme des passifs éventuels par le gouvernement et, partant, ne sont en règle générale pas comptabilisés dans les budgets de l’État.
Ces obligations peuvent aussi être implicites, et les pouvoirs publics doivent alors les assumer même sans avoir fourni de garantie (Martin, 2015). Par exemple, l’État peut être amené à supporter la dette d’une société privée avec laquelle il a établi un PPP. Si cette dette est considérable et atteint un niveau que la société privée ne peut plus supporter, et si le problème n’est pas résolu, elle pourrait entraîner une surchauffe du secteur bancaire national et engendrer des risques systémiques. Cette situation pourrait conduire à une éviction du secteur privé ou à un déficit de trésorerie. En pareil cas, l’État serait tenu de venir à la rescousse de l’entreprise ayant contracté la dette auprès de banques privées, voire d’utiliser les ressources budgétaires existantes pour endiguer ce risque, ce qui aurait un impact sur les engagements qu’il a pris dans d’autres secteurs.
On peut donc comprendre que les PPP soient susceptibles d’avoir un coût budgétaire considérable et de menacer laviabilité de la dette à long terme. En d’autres termes, l’échec d’un partenariat public-privé peut entraîner des compressions budgétaires, puisque les pouvoirs publics doivent assumer les obligations contractées dans le cadre d’un accord. Dans le cas des projets d’infrastructure à forte intensité de capital qui sont garantis par l’État, les conséquences peuvent être graves, en particulier pour les petits pays, alors contraints d’utiliser les recettes existantes et/ou de s’endetter davantage pour financer les activités prévues au budget et les engagements existants.
En outre, les projets financés par des prêts internationaux comportent des risques de change qui affecteraient le remboursement de la dette et les dividendes. Les rendements sont certes en monnaie locale, mais tout soubresaut du taux de change influe sur la capacité de l’État à rembourser et à déterminer la rentabilité de ces projets (UNCTAD, 2015b).
Dans le contexte plus large de la gestion de la dette extérieure, l’incidence des passifs éventuels sur la viabilité de la dette n’est généralement pas évaluée par les tests de résistance prévus dans le cadre de viabilité de la dette actuel (IMF, 2013a)36. Le fait que les PPP sont souvent traités comme des opérations hors budget pourrait inciter certains pays à utiliser cette modalité pour contourner les plafonds d’endettement établis au niveau national ou par le FMI (Griffiths et al., 2014).
Il est donc important qu’un gouvernement comprenne bien dans quel type d’arrangement contractuel il s’engage et qu’il évalue les risques que celui-ci comporte pour la viabilité de la dette. Selon Caliari (2014), ainsi que Prizzon et Mustapha (2014), les partenariats public-privé pourraient peser sur la viabilité de la dette, ce qui serait susceptible de nuire au financement du développement.
Compte tenu de l’impact potentiel de ces instruments sur la dette publique, il faut examiner les moyens de réduire le niveau d’endettement grâce à une gestion efficace de la dette. Dans le cas du développement des infrastructures, qui exige d’importants capitaux et dont les risques connexes sont rarement connus à l’avance, il est particulièrement souhaitable d’améliorer le cadre de surveillance, notamment s’agissant des risques macroéconomiques, pour quantifier convenablement les passifs éventuels, en l’espèce les PPP.
Autres problèmes et facteurs de risque
Les partenariats public-privé sont des entreprises complexes, en particulier lorsqu’ils sont axés sur les infrastructures. Ils font intervenir plusieurs partenaires liés les uns aux autres par des arrangements contractuels complexes et motivés par des incitations différentes ; ils ont tendance à s’inscrire sur le long terme et concernent généralement des projets à forte intensité de capital. Ces facteurs constituent des risques considérables.
Certains PPP se heurtent à des difficultés en raison de l’absence de réglementation ou de l’insuffisance de celle-ci. Cette lacune entraîne des incertitudes et freine l’investissement, car les parties contractantes ne peuvent avoir recours à un système juridique qui protège leur investissement de manière prévisible en cas de conflit. On observe aussi des asymétries d’information entre les partenaires d’un PPP, les données sur la solvabilité de chacun d’eux n’étant pas toujours suffisantes. Cette situation pourrait se traduire par une augmentation du coût du partenariat, car l’État doit fournir des garanties pour couvrir les risques implicites.
D’autres moyens permettent de combler les lacunes en matière de réglementation, notamment l’inclusion de clauses contractuelles sur un mécanisme de règlement des différends permettant de saisir des instances reconnues sur le plan international en cas de litiges commerciaux ou de différends en matière d’investissement. Toutefois, ces instruments peuvent engendrer des problèmes et des coûts supplémentaires pour les partenaires − en particulier les pouvoirs publics − qui sont parties à un différend relatif aux investissements.
Il existe également un certain risque juridique, ou un risque de litige, en cas d’interprétation divergente ou de violation d’un PPP qui s’inscrit dans le contexte plus large d’un accord d’investissement bilatéral. Comme ces instruments protègent les investissements et que les PPP sont souvent considérés comme une forme d’investissement, l’État peut légalement être tenu d’assumer certaines responsabilités si les partenaires privés sont protégés par un accord d’investissement bilatéral qu’il a conclu avec le pays hôte.
Divers problèmes et risques sont aussi associés à l’élaboration et à la mise en œuvre des partenariats public-privé. Les principaux problèmes rencontrés ont trait à l’opacité des procédures qui entourent la délivrance et l’attribution des contrats ; aux fluctuations d’un régime d’incitation évoluant en fonction du stade du partenariat ; à la manière de répartir les avantages à court, à moyen et à long terme de façon optimale ; ainsi qu’au respect et au maintien des normes de qualité et de durabilité pendant la durée du PPP et au-delà.
Par ailleurs, les cas de force majeure et les risques environnementaux, en particulier ceux associés à l’élaboration de projets dans différents secteurs d’infrastructure, devraient être examinés dans l’optique du développement durable. Ainsi, la possibilité qu’une sécheresse de longue durée se produise au cours de la période visée par un partenariat axé sur la construction d’un barrage destiné à alimenter une centrale hydroélectrique peut fortement influer sur la rentabilité des investissements et les résultats escomptés de ce partenariat. Même si elles font aussi généralement partie du processus suivi pour établir d’importants PPP axés sur le développement des infrastructures, les études d’impact environnemental ne peuvent pas prendre en compte tous les phénomènes que les changements climatiques sont susceptibles de provoquer, ni tous les autres phénomènes naturels qui peuvent être considérés comme des cas de force majeure.
Les PPP risquent aussi de déséquilibrer le rapport de forces lorsqu’un État traite avec une personne morale dont le pouvoir d’intervention sur le marché est comparable, voire supérieur, au sien. Une telle situation peut en effet engendrer des déséquilibres lors de la négociation des modalités d’un contrat et, partant, permettre à la société partenaire d’être suffisamment grande et puissante pour croiser le fer avec les organismes de réglementation en cas de conflit (Shaoul, 2009).
Des problèmes et des risques sont également associés aux coûts d’opportunité des PPP. Les coûts inhérents à ces partenariats sont souvent opaques pour les vérificateurs, les parlements et la société civile et ne sont pas soumis à l’obligation de rendre compte. En règle générale, les PPP nécessitent initialement que le gouvernement hôte offre certaines incitations fiscales et/ou procède à des transferts qui sont difficiles à quantifier à l’avance et ne sont généralement pas comptabilisés dans les comptes publics. L’État peut par exemple accorder une exonération fiscale lors de l’acquisition de machines à une société qui construit une route dans le cadre d’un PPP. En règle générale, cette exonération ne sera pas comptabilisée, mais représentera un manque à gagner correspondant au montant de l’exonération, montant qui aurait normalement pu être utilisé afin de financer les dépenses publiques liées aux programmes sociaux et de santé.
Un autre coût associé aux PPP dépend du genre de services fournis par les exploitants privés. Ce type d’accord occasionne en effet des coûts d’opportunité implicites parce qu’il fait perdre les recettes fiscales qui seraient autrement tirées des droits de douane ou des redevances pour service rendu (Caliari, 2014). Dans d’autres régions, certains éléments indiquent également que ces coûts d’opportunité implicites peuvent aussi donner des résultats mitigés sur le plan de la qualité et de l’exécution des PPP (UNCTAD, 2015b ; United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, 2011).
Des réserves ont aussi été exprimées quant à la pertinence de recourir à ces partenariats dans le but de financer le développement, car ils sont classés parmi les modalités de financement les plus coûteuses (Griffiths et al., 2014). On estime en effet qu’ils peuvent être trois ou quatre fois plus onéreux que les obligations, et que les prêts octroyés au secteur privé sont assujettis à des taux d’intérêt supérieurs de 3 % à 5 % à ceux des prêts publics (Martin, 2015). Dans le contexte du développement national, un tel constat soulève aussi la question des coûts d’opportunité, à savoir ce que le gouvernement aurait pu financer si les PPP n’avaient pas occasionné de coûts supplémentaires. Ces coûts alourdissent en définitive la gestion de la dette, car ils obligent généralement l’État à trouver des ressources additionnelles pour couvrir les déficits de financement après avoir utilisé certaines ressources budgétaires à des fins autres que celles qui étaient prévues à l’origine.
De manière générale, les PPP présentent plus de risques que les projets de développement exclusivement financés par des sources privées. Beaucoup de ces partenariats ne seraient normalement pas susceptibles de bénéficier d’un concours financier au sens traditionnel en raison des divers risques associés à ces modalités de financement. En effet, les PPP sont commercialement viables seulement parce que les pouvoirs publics protègent habituellement les investisseurs contre les divers risques associés à la mise en œuvre de ces projets de développement. Il est alors d’autant plus important que les gouvernements qui se portent garants comprennent bien les risques auxquels ils s’exposent lorsqu’ils s’engagent dans de tels partenariats, ce qui constitue un problème majeur dans de nombreux pays.
Quels sont les risques d’échec d’un partenariat public-privé axé sur le développement des infrastructures ?
On sait qu’en Afrique, 60 PPP axés sur le développement des infrastructures ont été annulés ou sont en difficulté37. D’une valeur de 1 milliard de dollars, ces partenariats représentent 4 % de l’investissement total (tableau 7). Bien que le pourcentage des investissements effectués dans des PPP qui se sont soldés par un échec soit minime (4 %), il représente tout de même un fardeau financier qui doit être partiellement ou intégralement pris en charge par l’État, garant de la plupart de ces accords.
La proportion des PPP ayant échoué ou en difficulté est relativement faible en Afrique par rapport aux chiffres enregistrés pour l’Asie du Sud-Est et l’Amérique latine. Ainsi, entre 1990 et 2014, 89 projets ont été annulés ou considérés en difficulté en Asie du Sud-Est, soit 9 % du total des investissements réalisés dans cette région, ce chiffre atteignant 146, soit 6 %, en Amérique latine38. Le nombre de PPP instaurés dans ces deux régions est cependant beaucoup plus élevé, ce qui peut expliquer en partie le nombre supérieur de risques et d’échecs. L’Afrique a sans doute aussi su tirer parti de l’expérience des autres régions pour mieux gérer les partenariats public-privé et, partant, empêcher leur échec. L’aversion au risque pourrait aussi expliquer ses résultats, les pays africains s’engageant peut-être dans des PPP seulement lorsque les projets sont considérés comme moins risqués.
Comment atténuer les risques et favoriser des partenariats public-privé durables ?
Une question majeure soulevée dans le cadre de la présente analyse concerne les mesures à prendre pour se prémunir contre les divers types de risques et pour les atténuer. Plus fondamentalement, quelles mesures doivent être mises en place pour que les PPP fonctionnent bien et donnent les avantages et résultats escomptés ? Comment les pays africains résolvent-ils les problèmes liés aux PPP au niveau de la prise de décisions ?
La mise en place d’un cadre qui régirait les partenariats public-privé tout en permettant d’écarter ou d’atténuer les risques qui leur sont associés constitue un défi de taille. Pour y parvenir, il faut pouvoir compter sur un ensemble complexe de compétences juridiques, administratives et techniques grâce auxquelles il sera possible de préciser les rôles et responsabilités des parties contractantes, de trancher un litige, de planifier et de surveiller la mise en œuvre de manière efficace, d’évaluer soigneusement les investissements et de procéder à des analyses financières.
Selon une étude réalisée par le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (Farlam, 2005), les PPP sont particulièrement fructueux lorsqu’ils s’accompagnent d’une planification minutieuse, d’une bonne communication, d’un engagement ferme de la part de toutes les parties ainsi que d’une surveillance, d’une réglementation et d’une application efficaces par les pouvoirs publics. Ces derniers doivent améliorer leur traitement des risques susmentionnés pour réaliser les gains d’efficience et d’efficacité offerts par les PPP.
Il est important de disposer d’un cadre de gestion des passifs éventuels approprié, qui accompagne et soutient les pouvoirs publics pendant toute la durée du PPP, tout en permettant d’identifier rapidement les risques − tels que la résiliation anticipée ou la modification du contrat − et de prendre les mesures correctives adéquates pour empêcher l’échec du partenariat. Il faut pour cela disposer d’une information financière normalisée, qui permet d’évaluer régulièrement les coûts et les risques associés aux obligations financières directes et conditionnelles imposées pendant la phase de mise en œuvre. Grâce à la prise en compte des risques, on peut beaucoup mieux évaluer les coûts explicites et implicites des partenariats public-privé. Un PPP dont les coûts sont établis de manière appropriée contribue en effet à assurer sa durabilité et à prévenir son échec.
Un autre moyen d’améliorer la gestion des risques consiste à surveiller la mise en œuvre des PPP. Par exemple, un conseil d’administration pourrait être établi en bonne et due forme par des comités interinstitutions pour chaque partenariat, afin de surveiller régulièrement son application. Des dispositions pourraient également être prises afin d’établir, au sein du Trésor public ou de la Banque centrale, un fonds qui couvrirait les passifs éventuels et assurerait la gestion des PPP en difficulté, fonds auquel il serait possible d’avoir accès seulement sur autorisation du conseil.
Du point de vue de la gestion de la dette, l’État ne devrait pas être contraint de se tourner vers des modalités de financement plus risquées parce que les autres solutions sont limitées. La plupart des pays risquent d’ailleurs de ne pas avoir les provisions budgétaires suffisantes pour financer leurs infrastructures, d’où le fait qu’ils offrent souvent des garanties aux investisseurs privés pour les inciter à financer des projets d’infrastructure. Les PPP constituent un bon moyen de financement lorsqu’ils servent principalement à attirer des compétences particulières qui ne seraient autrement pas disponibles.
La transparence et une répartition appropriée des risques sont les clefs d’un PPP qui fonctionne bien. D’une part, on peut accroître la transparence en établissant une liste des projets concernés et, éventuellement, en soumettant ceux-ci au grand public pour examen. D’autre part, on peut répartir les risques en respectant plusieurs principes de gestion, notamment ceux qui prescrivent l’identification des risques et leur prise en charge par la partie la mieux placée pour les gérer, une évaluation adéquate des coûts associés aux risques et l’adoption des mesures nécessaires pour atténuer les risques éventuels (Kauf, 2015).
Il est indispensable d’avoir les connaissances et les compétences requises pour comprendre et évaluer la complexité des PPP. Pour gérer les risques qui leur sont associés, il faut analyser la situation au préalable et avec clairvoyance, en particulier lorsqu’il s’agit de déterminer la charge financière que ces instruments peuvent représenter pour le gouvernement.
Les organismes de réglementation chargés de surveiller les PPP doivent pouvoir compter sur le soutien des pouvoirs publics et sur le renforcement des institutions existantes. Les nouveaux efforts déployés pour réglementer les partenariats public-privé dans nombre de pays africains et de communautés économiques régionales devraient également être soutenus par des institutions suffisamment autonomes
chargées de superviser le fonctionnement de ces partenariats. Il a été reconnu − dans le Rapport 2015 sur le développement économique en Afrique − que bien que l’État demeure un acteur majeur de la prestation de services d’infrastructure, l’indépendance des autorités de réglementation est un élément important de l’efficacité de la prestation de ces services (UNCTAD, 2015c) et, partant, du soutien en faveur des PPP.
Les gouvernements et les communautés économiques régionales qui élaborent des politiques et des instruments de partenariat public-privé devraient peut-être aussi envisager de créer des services spécialisés qui seraient chargés d’assurer la transparence du processus, de résoudre les problèmes et les goulets d’étranglement y afférents et de protéger l’intérêt public. Les autorités pourraient également avoir besoin d’adopter rapidement une législation visant à modifier les procédures de passation des marchés souvent associées aux PPP, pour rendre le processus plus transparent et l’axer davantage sur les résultats, en particulier s’agissant de la sélection des projets. Les institutions compétentes devraient être investies des pouvoirs requis et jouir de l’indépendance nécessaire pour superviser ces types de contrats. Elles devraient aussi disposer de mécanismes leur permettant d’intervenir en cas d’échec d’un PPP, et ce, en respectant les plus hautes normes de qualité et d’accessibilité, y compris sur le plan financier, dans l’intérêt du grand public et de l’ensemble des Africains.
Le rôle des capacités d’absorption des pays concernés mérite d’être souligné à cet égard. Étant donné que le succès d’un partenariat public-privé dépend du fait qu’un gouvernement dispose d’un cadre réglementaire propice, cela explique en partie pourquoi de nombreux pays développés africains se sont tournés vers les PPP.
Les régimes régionaux d’investissement qui concernent les PPP peuvent donner l’occasion d’harmoniser les politiques pertinentes et de traiter ces partenariats d’une manière plus coordonnée et plus cohérente. Cet exercice se révélerait particulièrement utile pour les PPP qui couvrent plusieurs pays des sous-régions africaines. Il est important de noter que les accords d’investissement régissant ces partenariats peuvent cependant engendrer des risques additionnels associés aux litiges qu’ils soulèvent. Ainsi, s’agissant des accords régionaux d’investissement, les tribunaux nationaux et régionaux risquent d’être saisis de certains litiges, ce qui pourrait influer sur les capacités juridictionnelles et judiciaires des institutions compétentes à mieux comprendre la réglementation et les clauses contractuelles relatives aux PPP à l’avenir.
Deux véritables défis doivent être relevés à cet égard : esquiver les écueils rencontrés avec les partenariats public-privé instaurés en Afrique et adopter les meilleures pratiques des sous-régions africaines. Pour ce faire, il faut diffuser et échanger davantage les éléments fructueux ayant présidé à la conception et à l’élaboration d’un PPP. En outre, des ressources devraient être affectées à la formation et au renforcement des capacités afin que les responsables publics aux niveaux national et régional puissent acquérir les compétences appropriées et améliorer leur connaissance de la gestion de ces partenariats.
L’encadré 6 donne un aperçu de la manière dont les pays africains ont traité les politiques en matière de PPP au niveau national. Il montre que si les pays incluent bien ces partenariats dans leurs plans de développement respectifs, ils ne précisent cependant pas en quoi les PPP peuvent favoriser leur développement.
Encadré 6. Politiques nationales en matière de partenariat public-privé
|
Très peu de pays ont mis en place des politiques ou des réglementations nationales spécifiques, mais un certain nombre ont reconnu cette lacune et ont indiqué leur désir ou leur intention d’inclure ces instruments dans leurs plans de développement.
Enfin, une nouvelle catégorie de partenariats a vu le jour : les partenariats public-privé en faveur des pauvres. Ceux-ci intègrent certaines stratégies et méthodes du secteur non structuré de l’économie, tout en ciblant les groupes les plus vulnérables de la population. Ils ont pour but d’aider les pauvres en associant aux négociations les communautés locales et la société civile à titre d’acteurs clefs et en mettant en place un système doté des fonds nécessaires pour surveiller et évaluer l’impact d’un projet sur les pauvres.
Conclusions
Le nombre de partenariats public-privé est en hausse dans de nombreux pays africains. La présente analyse montre que ces partenariats jouent un rôle important dans le financement des projets de développement des infrastructures à forte intensité de capital, tant aux niveaux national que régional. Bien que certains estiment qu’il s’agit là de la modalité de financement la plus coûteuse, les PPP sont volontiers utilisés dans l’ensemble de l’Afrique et devraient se répandre de plus en plus. De nombreux projets et investissements s’inscrivant ainsi dans le cadre de PPP sont en cours pour financer le développement des infrastructures. La quasi-totalité des pays africains disposent d’une certaine expérience de ces partenariats. En outre, beaucoup de pays ont élaboré, ou sont en train d’élaborer, des réglementations ou des politiques en la matière afin de tirer un meilleur parti de ce type d’investissement dans les divers secteurs concernés, comme l’indiquent de nombreux plans nationaux de développement.
Au niveau régional, les sous-régions africaines s’engagent également dans des partenariats public-privé, en particulier dans le secteur de l’énergie, comme en témoignent les pools énergétiques de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique australe. On pourrait affirmer que ces partenariats sont un instrument de promotion du régionalisme développementiste de plus en plus important. Une réglementation se dessine lentement, et les PPP sont progressivement incorporés dans des protocoles et des accords régionaux axés sur des secteurs tels que l’énergie, sur l’investissement et sur des cadres propres aux PPP intégrant une perspective sous-régionale. Cette évolution majeure pourrait stimuler l’attractivité et la bancabilité des projets régionaux d’infrastructure tout en favorisant l’harmonisation des PPP et de la réglementation pertinente.
Les partenariats public-privé ne sont ni la seule solution pour financer les infrastructures en Afrique, ni une panacée ; il est par conséquent important que les décideurs évaluent individuellement les conditions de chaque projet. Non seulement les PPP présentent-ils des avantages sur le plan de l’investissement, mais ils permettent aussi de tirer parti de l’esprit d’innovation, du savoir-faire, des capacités de gestion spécialisées et de la prestation de services du secteur privé.
La gestion des risques dans le contexte d’un partenariat public-privé constitue un défi de grande ampleur lorsqu’il s’agit d’assurer la viabilité de la dette et la pérennité du développement. De par leur nature, ces partenariats sont considérés comme des passifs éventuels, ce qui signifie que le risque d’échec associé à ce type de projets est inconnu. Il est donc important de disposer d’un cadre de gestion des passifs éventuels approprié, qui accompagne et soutient les pouvoirs publics tout au long de la durée du PPP tout en permettant d’identifier rapidement les risques et de prendre les mesures correctives adéquates pour empêcher l’échec du partenariat, ce qui pourrait entraîner des coûts inutiles.
C. ENVOIS DE FONDS ET OBLIGATIONS-DIASPORA
La migration est un phénomène répandu en Afrique, un grand nombre d’Africains ayant migré vers d’autres pays du continent ou ailleurs dans le monde. Une fois à l’étranger, beaucoup de migrants continuent de soutenir leur famille en utilisant leur épargne pour lui envoyer de l’argent. Les envois de fonds ont connu un essor remarquable ces quinze dernières années et apporté un appui financier à d’innombrables familles. Dans le même temps, compte tenu de l’ampleur et de la stabilité de ces flux, des États et des institutions financières ont conçu des instruments financiers destinés à mettre l’épargne et les envois de fonds des diasporas au service du financement du développement.
La Banque mondiale estime que les envois de fonds à destination des pays en développement ont représenté 436 milliards de dollars en 2014, soit 4,4 % de plus qu’en 2013, et prévoit qu’ils s’élèveront à 479 milliards de dollars en 2017 (World Bank, 2015c). En Afrique, il est estimé que leur montant a été de 63,8 milliards de dollars en 2014, ce qui est supérieur aussi bien à l’aide publique au développement qu’à l’investissement étranger direct dont a bénéficié le continent. L’augmentation de ce chiffre s’explique largement par la forte hausse constatée au Kenya (10,7 %), en Afrique du Sud (7 %), et en Ouganda (6,7 %). Si les envois de fonds vers l’Afrique présentent une forte concentration (le Nigéria, l’Égypte et le Maroc comptant respectivement pour 33 %, 31 % et 11 % du total), ils jouent néanmoins un rôle crucial dans plusieurs autres pays africains, où ils constituent une contribution appréciable au PIB et/ou une importante source de devises. Comme le montre le tableau 8, les petits États et les pays non producteurs de pétrole, comme Cabo Verde, les Comores, la Gambie, le Lesotho, le Libéria et le Sénégal, tendent à être plus dépendants des envois de fonds.
La présente section porte sur la contribution que les envois de fonds et l’épargne des diasporas peuvent apporter au financement de l’action publique et du développement. Sachant que la capacité de financer le développement grâce à ces envois est largement conditionnée par le recours aux circuits formels, on y examine les moyens de promouvoir ces derniers.
Tirer parti des envois de fonds et de l’épargne des diasporas pour financer le développement
L’épargne réelle et potentielle des diasporas est considérable. En s’appuyant sur des données relatives aux migrants internationaux, la Banque mondiale a estimé que les diasporas des pays en développement ont épargné 497 milliards de dollars en 2013 (World Bank, 2015c). Celles-ci envoient une grande partie de cette épargne dans leur pays d’origine. Une fois dépensées, les sommes transférées contribuent au budget de l’État destinataire à travers l’impôt indirect.
Les diasporas conservent une grande proportion de leur épargne sous forme de dépôts bancaires. Les taux d’intérêt sur les dépôts étant proches de zéro dans les banques des pays d’accueil, les travailleurs migrants peuvent préférer d’autres instruments d’investissement, notamment les obligations-diaspora, à savoir « des titres de dette émis par un pays souverain pour lever des fonds en les plaçant auprès de sa population expatriée » (UNCTAD, 2012b). Ces obligations permettent aussi de tirer parti des liens affectifs et des motivations d’ordre patriotique des diasporas pour attirer l’investissement, ce qui leur confère un caractère moins procyclique que d’autres flux financiers extérieurs. Il est crucial, pour les gouvernements qui envisagent d’émettre des obligations de ce type, de déterminer si le coût du capital acquis au moyen de ces obligations est inférieur à celui du capital emprunté sur les marchés internationaux. La question ne se pose pas, cependant, si un pays n’a pas, ou n’a que très peu, accès à ces marchés, les obligations-diaspora pouvant alors représenter la seule source de devises autre que les exportations. En outre, les coûts associés au placement et à la vente de ces obligations peuvent être importants et réduire l’avantage lié au fait de verser des taux d’intérêt plus faibles aux détenteurs. Afin d’atteindre un nombre suffisant d’acheteurs et, partant, de diminuer les coûts d’émission, la CNUCED a suggéré que les obligations soient émises au niveau régional par un groupe de pays, avec l’appui d’une banque régionale de développement (UNCTAD, 2012).
Plusieurs pays ont obtenu de très bons résultats en émettant des obligations-diaspora : la Société israélienne de développement a ainsi mobilisé plus de 25 milliards de dollars depuis 1951, et la State Bank of India, plus de 11 milliards de dollars depuis 1991 (Ketkar and Ratha, 2010). À Sri Lanka, les obligations pour le développement ont permis de lever environ 580 millions de dollars depuis 2001. Selon la Banque mondiale, les obligations-diaspora pourraient permettre de mobiliser environ un dixième de l’épargne annuelle des diasporas – soit plus de 50 milliards de dollars – pour financer des projets de développement (World Bank, 2015c).
Certains pays africains, comme l’Éthiopie, le Ghana, le Kenya et le Zimbabwe, étudient la possibilité de combler leurs déficits de financement en émettant des obligations-diaspora. En 2007, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, le Ghana a émis des bons d’épargne d’une valeur totale de 50 millions de dollars à l’intention des Ghanéens résidant dans le pays ou à l’étranger. Les fonds ainsi recueillis devaient être investis dans des projets d’infrastructure. En 2011, l’Éthiopie a lancé sa deuxième émission obligataire destinée aux membres de sa diaspora, afin de financer la construction du Grand barrage de la Renaissance, dont le coût était estimé à 4,8 milliards de dollars (African Development Bank, 2012). L’idée reposait sur un rabais « patriotique » (au bénéfice de l’émetteur), c’est-à-dire d’une obligation assortie d’un coupon dont le taux était inférieur à celui du titre de référence, généralement un bon à 10 ans du Trésor des États-Unis ou une obligation comparable. L’achat de l’obligation-diaspora comporte donc un surcoût et est motivé par un attachement affectif au pays émetteur (UNCTAD, 2012b).
L’expérience des pays africains conduit à penser que les obligations-diaspora donnent généralement de meilleurs résultats si une importante diaspora de première génération réside dans des pays à revenu intermédiaire ou élevé. C’est pourquoi des pays comme l’Égypte, l’Éthiopie, le Kenya, le Nigéria, la Somalie et l’Afrique du Sud, et d’autres pays dont une grande proportion de la population vit à l’étranger sont sans doute bien placés pour tirer parti d’une politique vigoureuse en matière d’obligations-diaspora. Certains pays africains pourraient cependant avoir du mal à convaincre les investisseurs, parce que ceux-ci considèrent le risque politique comme trop important. Ils risquent également d’avoir de la peine à exploiter le potentiel de ces obligations en raison des prescriptions techniques ou administratives qu’il faut respecter pour les vendre à l’étranger, par exemple aux États-Unis.
Un autre moyen d’encourager les migrants à investir leur épargne dans leur pays d’origine est de leur permettre d’y effectuer des dépôts bancaires en devises, éliminant ainsi le risque de change, un des éléments de la prime de risque associée au pays d’origine. La prime de risque restera cependant suffisante pour offrir un rendement supérieur à celui des dépôts bancaires effectués dans la plupart des pays d’accueil. Ces dépôts se caractérisent par des taux d’intérêt attractifs, surtout lorsque l’échéance est longue (2 ou 3 ans). De plus, ils améliorent les bilans des banques du pays d’origine et contribuent au développement du secteur financier.
Les envois de fonds s’étant révélés relativement stables à moyen et à long terme, ils peuvent faire office de flux à recevoir dans le cadre d’une titrisation. Dans certaines opérations de ce type, ces flux futurs ont ainsi permis de réduire le taux d’intérêt et d’allonger l’échéance. D’après Suhas Ketkar et Dilip Ratha, la Banque du Brésil a mobilisé 250 millions de dollars en 2002 en émettant des obligations adossées aux envois de fonds futurs en provenance du Japon (Ketkar and Ratha, 2009). Ces obligations étaient mieux notées que l’emprunteur souverain (BBB+ contre BB-) et leur taux d’intérêt était inférieur d’environ 9 points de pourcentage au taux des emprunts souverains. Les prescriptions associées à cet instrument ne sont cependant pas faciles à satisfaire : en général, les pays doivent avoir une cote de crédit supérieure ou égale à B, recevoir au minimum 500 millions de dollars d’envois de fonds par an et permettre à quelques banques de gérer la plus grande partie de ces flux.
Les conditions sont plus souples lorsqu’il s’agit d’utiliser les envois de fonds comme garantie dans le cadre de prêts consortiaux à long terme que dans le cas de la titrisation39. Le risque souverain peut être atténué par les envois de fonds, et les banques de développement peuvent offrir des instruments de rehaussement du crédit. La Banque africaine d’import-export a l’expérience de l’organisation de prêts consortiaux fondés sur des flux futurs d’envois de fonds. Ainsi, en 2001, elle a lancé un programme de préfinancement adossé à des flux financiers futurs afin de développer l’utilisation des envois de fonds et d’autres flux futurs comme garanties pour mobiliser un financement extérieur à moindre coût et à échéance plus longue. En 2013, 5 % de ses prêts ont été accordés au titre de ce programme, à l’origine de plusieurs prêts adossés à des flux futurs d’envois de fonds en Éthiopie, au Ghana et au Nigéria. La Banque a été primée pour ces activités, qui ont amélioré l’accès des contreparties africaines à un financement abordable du commerce extérieur et de projets auprès des marchés grâce à l’utilisation des envois de fonds de ressortissants africains de la diaspora comme garantie et principale source de remboursement (UNCTAD, 2012b).
Pour contribuer à renforcer le secteur financier et servir de garantie lors de prêts et d’opérations de titrisation, les envois doivent être enregistrés officiellement. Cela n’est possible que s’ils passent par des filières formelles. En général, les migrants ont cependant recours à tout un éventail de circuits formels et informels, qu’ils choisissent en fonction de leur coût, de leur fiabilité, de leur facilité d’accès et de la confiance qu’ils leur accordent. Par conséquent, une grande partie des envois de fonds passe par des filières informelles et n’est pas enregistrée.
Promouvoir les filières formelles d’envoi de fonds
Les politiques destinées à promouvoir les circuits formels d’envoi de fonds doivent tenir compte des avantages que présentent les filières informelles, notamment leur coût moindre et leur plus grande disponibilité, particulièrement dans les zones rurales.
La réduction des coûts de transfert devrait être facilitée par l’adoption de politiques à cet effet dans les pays d’envoi et les pays de destination. La CNUCED a indiqué que, pour réduire ces coûts, « la régularisation du statut des migrants et la possibilité d’ouvrir un compte bancaire [étaient] des conditions préalables indispensables » dans bon nombre des pays d’envoi (UNCTAD, 2012). Si les migrants pouvaient recourir aux services financiers de leur pays d’accueil pour effectuer des virements, l’accroissement des envois de fonds inciterait d’autres acteurs du secteur financier à entrer sur ce marché, d’où une intensification de la concurrence et une baisse des coûts de transfert.
Dans les pays de destination, la concurrence entre les organismes offrant des services de transfert monétaire tend à se développer. Dans beaucoup de PMA africains, les filières formelles d’envoi de fonds sont contrôlées par un petit nombre d’acteurs. Les accords d’exclusivité brident la concurrence en empêchant les concurrents d’entrer sur le marché, ce qui fait augmenter les coûts et diminuer le nombre de prestataires. Il faudrait donc réviser ces accords, de même que les réglementations régissant les transferts monétaires et la supervision des institutions financières, de façon à permettre aux institutions de microfinancement, aux coopératives d’épargne et de crédit, aux caisses de crédit mutuelles, aux bureaux de poste, par exemple, de jouer un rôle plus actif dans ces filières (Maimbo and Ratha, 2005 ; Orozco and Fedewa, 2006). Cela réduirait les coûts de transfert, tout en y élargissant l’accès dans les zones rurales.
La CNUCED a souligné que « la promotion de la concurrence se heurt[ait] néanmoins à certains problèmes d’ordre réglementaire, à savoir la nécessité de garantir la fiabilité et l’intégrité des systèmes de transfert et la nécessité d’éviter que le système ne soit utilisé à mauvais escient (pour le blanchiment d’argent, par exemple) » (UNCTAD, 2012). Les décideurs doivent donc s’attacher à trouver le juste équilibre entre la promotion de la concurrence au sein de ce marché et le maintien d’une réglementation efficace.
En outre, les pays de destination peuvent rendre les circuits informels plus attrayants en permettant aux membres de leurs diasporas d’y ouvrir des comptes bancaires en devises, ce qui élimine le risque de change. En 2004, la Banque nationale d’Éthiopie a par exemple autorisé les Éthiopiens vivant à l’étranger et les ressortissants étrangers d’origine éthiopienne à ouvrir des comptes en devises dans toute banque commerciale agréée du pays.
Il est possible d’exploiter davantage les nouvelles technologies, en particulier les modes de transfert par Internet et par téléphonie mobile, qui permettent d’offrir des services bancaires sans succursale et d’améliorer l’accès aux services financiers dans les zones rurales.
L’Institut africain pour les versements, administré par l’Union africaine avec l’appui de la Banque mondiale et de la Commission européenne, en coopération avec la Banque africaine de développement et l’Organisation internationale pour les migrations, a pour objectif central de faciliter et d’accroître l’utilisation des filières formelles d’envois de fonds. Il vise à rendre les envois de l’Europe à l’Afrique plus économiques, plus rapides et plus sûrs, ainsi qu’à renforcer la capacité des États membres de l’Union africaine, des expéditeurs, des destinataires et des autres parties prenantes à élaborer et à appliquer des stratégies judicieuses et des instruments opérationnels pour utiliser ces transferts afin de réduire la pauvreté40.
Incidence des envois de fonds et des obligations-diaspora sur la dette publique
Les rapports entre envois de fonds et dette publique sont multiples. Premièrement, les envois de fonds (envois de fonds des travailleurs et rémunération des salariés) ont une incidence positive sur le compte courant. Ils réduisent donc le désquilibre de la balance des paiements des pays déficitaires, ainsi que la nécessité pour ceux-ci de s’endetter pour corriger ce déséquilibre. Deuxièmement, le FMI et la Banque mondiale ont progressivement révisé le cadre de viabilité de la dette, afin de tenir compte de l’incidence des envois de fonds sur la capacité de remboursement de la dette ainsi que sur la probabilité de défaut de paiement (IMF and World Bank, 2012 ; World Bank and IMF, 2014). Lorsque des données fiables sont disponibles au sujet des envois de fonds, elles sont utilisées pour évaluer le risque de surendettement. Troisièmement, étant donné que les envois de fonds accroissent le volume et souvent la stabilité des entrées de devises dans les pays de destination, ils améliorent leur capacité à rembourser la dette extérieure et par conséquent leur solvabilité. Une meilleure cote de crédit se traduit par des coûts d’emprunt plus faibles. Quatrièmement, comme indiqué plus haut, la possibilité d’utiliser les envois de fonds pour garantir les opérations de titrisation ou les prêts consortiaux à long terme permet aux États d’emprunter à moindre coût sur les marchés de capitaux internationaux et d’avoir un meilleur accès aux sources de financement à long terme aux fins du développement. Les obligations-diaspora peuvent leur donner de nouveaux moyens de financer le développement et leur permettre d’emprunter à des taux d’intérêt généralement inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur le marché intérieur, voire sur les marchés de capitaux internationaux si l’investissement est favorisé par des motivations d’ordre affectif et patriotique.
Les envois de fonds et les obligations-diaspora donnent lieu à des entrées de devises substantielles qui appellent une gestion macroéconomique rigoureuse, particulièrement en ce qui concerne les taux de change (Ratha and Plaza, 2011) et la capacité qu’ont les destinataires d’absorber et de dépenser ou d’investir ces ressources. Dans certains pays, ces entrées risquent d’entraîner une revalorisation de la monnaie (Ratha, 2013). Cela est également vrai des obligations libellées en monnaie nationale, qui causent des entrées importantes de devises au moment de leur émission et éventuellement des flux en sens inverse à leur échéance.
D. RÉDUCTION DES FLUX FINANCIERS ILLICITES
Chaque année, d’importantes sommes d’argent sont transférées illégalement hors du continent africain. Ces flux financiers illicites ont des effets négatifs sur les pays concernés : ils limitent les ressources dont ceux-ci ont besoin pour leurs dépenses intérieures et leurs investissements publics et privés, sont susceptibles d’affaiblir la conduite des affaires publiques et ouvrent la voie à la criminalité transnationale organisée et à la corruption. Les flux financiers illicites et leurs coûts économiques constituent, par conséquent, un obstacle au développement des pays africains qui préoccupe beaucoup les décideurs. À ceux-ci s’ajoutent un grand nombre de mouvements (sorties) de capitaux dommageables qui, sans être illégaux – selon le contexte législatif –, échappent au pouvoir réglementaire de la plupart des pays désireux de récupérer ces fonds, par exemple auprès de paradis fiscaux extraterritoriaux. Ces mouvements de capitaux peuvent être tout aussi substantiels, si ce n’est plus, que les flux financiers illicites et ont donc leur importance dans le contexte plus large du financement du développement.
Selon le Rapport du Groupe de haut niveau chargé de la question des flux financiers illicites en provenance d’Afrique publié en 2014, ces flux peuvent atteindre 50 milliards de dollars par an. On estime qu’ils ont fait perdre environ 854 milliards de dollars au continent africain entre 1970 et 2008, soit 22 milliards de dollars par an en moyenne. Ce chiffre équivaut à peu près au montant total de l’aide publique au développement reçue par l’Afrique au cours de la même période (OECD, 2015b). Or, seulement un tiers de cette somme aurait suffi pour rembourser complètement la dette extérieure africaine, qui s’élevait à 279 milliards de dollars en 2008. D’après les données de l’organisation Global Financial Integrity, l’Afrique se classait au deuxième rang des régions du monde pour ce qui était de la progression des flux financiers illicites (+19,8 % par an) et au premier rang pour ce qui était de leur part du PIB (5,7 %) pendant la période 2002-2011 (Herkenrath, 2014). Le Groupe de haut niveau fait observer que, malgré des différences attribuables aux méthodes utilisées, les estimations réalisées par Ndikumana et Boyce (2008 ; 2011), Kar et Cartwright-Smith (2010) et Kar et Freitas (2011) aboutissent toutes aux deux mêmes conclusions majeures : les flux financiers illicites en provenance d’Afrique représentent des sommes importantes pour le continent et ils ne cessent d’augmenter.
À l’heure où les besoins de financement du développement se font pressants, il conviendrait de réfléchir sérieusement à la manière de réduire sensiblement les flux financiers illicites et, partant, d’accroître les ressources financières intérieures. C’est ce qui ressort du Programme d’action d’Addis-Abeba issu de la troisième Conférence internationale sur le financement du développement (A/RES/69/313), adopté par la communauté internationale en 2015. S’agissant des ressources publiques intérieures, les dirigeants réunis à cette occasion ont déclaré : « Nous n’épargnerons aucun effort pour réduire de façon appréciable les flux financiers illicites d’ici à 2030 en vue de les éliminer à terme, notamment en luttant contre la fraude fiscale et la corruption, en renforçant pour cela la réglementation nationale et en intensifiant la coopération internationale ».
En résumé, les pays africains doivent poursuivre deux objectifs interdépendants : redoubler d’efforts pour mobiliser des ressources intérieures, notamment en endiguant les flux financiers illicites, et entamer une série de réformes afin d’attirer des capitaux privés, en faisant en sorte de servir la transformation structurelle et en luttant contre les flux financiers illicites.
Les flux financiers illicites : définition et caractéristiques
L’organisation Global Financial Integrity définit les flux financiers illicites comme des « mouvements illégaux d’argent ou de capitaux entre deux pays », leur caractère illicite résidant dans le fait que l’argent ou les capitaux en question sont acquis, transférés et/ou utilisés illégalement. Cette définition est aussi celle retenue par le Groupe de haut niveau, selon lequel « ces flux financiers sont des violations du droit dès leur origine, ou pendant leur déplacement ou leur utilisation, et doivent donc être considérés comme illicites ». Le Groupe de haut niveau souligne en outre qu’il importe de distinguer les flux financiers illicites des fuites de capitaux, lesquelles peuvent obéir à des facteurs macroéconomiques ou administratifs et être parfaitement licites.
Les flux financiers illicites ont trois grandes origines. Pour certains, ils résultent d’activités commerciales (ou liées au commerce), d’activités criminelles ou de pratiques de corruption (Global Financial Integrity) ; pour d’autres, ils sont le produit d’activités criminelles, de pratiques de corruption ou de la fraude fiscale, y compris par la manipulation des prix de transfert (Task Force on Development Impact of Illicit Financial Flows, 2011). Étant donné l’objet du présent rapport, l’analyse sera essentiellement consacrée aux flux financiers illicites résultant d’activités commerciales. Le Groupe de haut niveau fait observer que ces flux répondent à plusieurs finalités, « telles que la volonté de dissimuler des richesses, d’éviter l’impôt de façon agressive, et de contourner les droits de douane et les taxes intérieures », et qu’ils « sont difficiles à déterminer, s’agissant de la ligne de démarcation entre l’utilisation légitime des incitations prévues par les politiques commerciales et leur utilisation abusive, et l’ampleur et la portée des activités économiques engendrant des sorties de capitaux ». La difficulté est de définir et de reconnaître les transactions qui relèvent de la fraude fiscale (illégale) et celles qui relèvent de l’évasion fiscale (légale, s’il ne s’agit pas de pratiques fiscales abusives).
Selon le Groupe de haut niveau chargé de la question des flux financiers illicites en provenance d’Afrique, les flux financiers illicites liés à des activités commerciales (fraude fiscale) peuvent résulter des opérations suivantes :
- La manipulation des prix de transfert, qui consiste à falsifier les prix dans le cadre de transactions internationales entre entreprises multinationales apparentées. Si ces entreprises tirent parti de leurs multiples structures pour transférer leurs bénéfices dans d’autres pays sans appliquer le principe de pleine concurrence, elles participent à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices. La complexité des réseaux internationaux de production rend ce type d’opérations très difficile à repérer ;
- La manipulation des prix commerciaux, qui consiste à falsifier les prix, la qualité et la quantité des biens échangés, pour des raisons diverses. Cela peut passer par la sous-facturation des exportations ou la surfacturation des importations ;
- La fausse facturation de services et de biens incorporels, qui est souvent liée à des prêts entre entreprises d’un même groupe et à des frais de propriété intellectuelle et de gestion. Dans ce cas, l’évolution technologique et le manque d’informations comparatives sur les prix contribuent à générer des flux financiers illicites ;
- La passation de contrats inégaux, qui sont conclus en secret et alimentés par des pots-de-vin pour éluder les dispositions légales existantes. Ces contrats sont souvent une source de préoccupation dans les industries extractives, où il existe en outre une asymétrie d’information entre les pays et les entreprises multinationales, celles-ci ayant souvent une meilleure connaissance, d’un point de vue quantitatif et qualitatif, des gisements miniers qui font l’objet des contrats.
Selon Kar et Cartwright-Smith (2010), le produit d’une fraude fiscale liée à des activités commerciales, essentiellement obtenu par la manipulation des prix commerciaux, est de loin la principale source des flux financiers illicites, dont il représente quelque 60 % à 65 % du total mondial. D’où l’importance de la communication et de la coopération entre pouvoirs publics et secteur privé, et de la gouvernance d’entreprise lors de l’application de mesures correctives.
Répercussions économiques des flux financiers illicites
Les flux financiers illicites sapent directement les efforts déployés pour mobiliser des ressources intérieures. Ils empêchent d’obtenir tous les avantages escomptés des politiques nationales volontaristes susceptibles d’être adoptées à cet égard (réformes de la fiscalité et de l’administration publique, changements de gouvernance et développement du secteur financier, en particulier) et de tirer parti des envois de fonds. Il est donc impératif pour les pays africains de lutter contre les flux financiers illicites s’ils veulent réussir à mobiliser plus de ressources intérieures.
Les flux financiers illicites ont aussi des répercussions indirectes. Ils dissuadent par exemple les acteurs publics et privés corrompus de faciliter une transformation structurelle qui permettrait de rendre leur pays moins tributaire des industries extractives. Selon le Groupe de haut niveau, ce sont dans les industries extractives que les flux financiers illicites sont les plus importants, notamment dans les sous-secteurs du pétrole, des métaux et minéraux précieux, du fer et de l’acier, ainsi que du cuivre. De même, les flux financiers illicites peuvent réduire l’efficacité des mesures visant à réformer la gouvernance et à renforcer les capacités dans une optique de développement, car ces mesures se heurteront probablement à la résistance de puissants groupes d’intérêt, privés et publics, profitant des activités illicites. Ces flux peuvent aussi compromettre le renforcement des institutions politiques et contribuer à maintenir des rapports de forces inégaux dans la société, au détriment du développement économique et social (Herkenrath, 2014). Ils peuvent également influer sur les décisions d’investissement public et privé, avec des conséquences néfastes sur le rendement des capitaux investis. Par exemple, les fonctionnaires corrompus ont tendance à orienter les investissements vers les secteurs économiques les plus propices à la corruption, plutôt que vers les secteurs qui participent davantage à la transformation structurelle. Les flux financiers illicites creusent les inégalités, car ils sont principalement le fait de privilégiés qui manipulent les prix des importations et des exportations ou qui sont en mesure de s’approprier ou de transférer illégalement des ressources à l’étranger (African Development Bank et al., 2012).
En outre, les flux financiers illicites rendent les pays plus tributaires de l’aide et de la dette extérieure. Or, comme cela a déjà été mentionné, cette dépendance ne peut pas tenir sur la durée. En effet, l’aide est souvent imprévisible et variable, et ne constitue pas une source de financement à long terme souhaitable, et la dépendance à l’égard de la dette extérieure s’accompagne d’un risque d’insolvabilité. L’aide et la dette extérieure réduisent la marge d’action des pays africains.
Lutter contre les flux financiers illicites
Pour s’attaquer aux flux financiers résultant de pratiques de corruption et d’activités criminelles, et donc illégaux par nature, il faudrait commencer par améliorer la gouvernance. Cette question est certes importante, mais elle dépasse le cadre du présent rapport. Il s’agit ici d’examiner les différents moyens de lutter contre les flux financiers illicites qui découlent d’activités commerciales (fraude fiscale) et de limiter les possibilités d’évasion fiscale, de manière à ce que les pays conservent la valeur créée sur leur territoire. Il est très difficile pour les administrations fiscales de détecter les sorties de capitaux illicites lorsque celles-ci font intervenir des montages fiscaux très élaborés reposant sur une manipulation des prix de transfert et qu’elles sont favorisées par des failles de la législation fiscale et par l’opacité financière que les paradis fiscaux garantissent aux entreprises multinationales et aux personnes fortunées. Cette situation impose manifestement de prendre des mesures aux niveaux national et international.
Niveau national
Le Groupe de haut niveau reconnaît l’importance d’un cadre réglementaire bien défini, qui rend « illégale la notification délibérément incorrecte ou imprécise des prix, des quantités, des qualités et des autres aspects du commerce des biens et services dans le but de transférer des capitaux ou des profits vers une autre juridiction, de manipuler les prix ou [d’]éviter toute forme d’imposition, notamment les droits de douane et les impôts indirects ». Pour que ce cadre soit crédible et efficace, des dispositifs doivent être mis en place afin de contrôler son application et de sanctionner les contrevenants.
La lutte contre la fausse facturation passe par une administration douanière performante. Il serait donc souhaitable que les mesures douanières soient mieux appliquées et, pour ce faire, que les agents des douanes reçoivent la formation et le matériel nécessaire pour mieux détecter les fausses factures. Le Système douanier automatisé (SYDONIA) peut se révéler utile à cet égard. Il a pour objectif d’augmenter les recettes douanières en faisant en sorte que tous les biens soient déclarés, que les droits et taxes soient correctement établis et que les droits, les exonérations et les régimes préférentiels, entre autres, soient dûment appliqués et administrés. D’une manière plus générale, SYDONIA a été conçu dans le but de moderniser et d’accélérer le processus de dédouanement, grâce à l’informatisation et à la simplification des procédures, ce qui se traduit par une réduction des coûts administratifs pour les entreprises et par des économies pour les pays concernés.
Le Groupe de haut niveau recommande également que les organismes nationaux et multilatéraux communiquent pleinement et librement, dans les meilleurs délais, des données sur les prix des biens et des services faisant l’objet de transactions internationales, en se conformant à la codification admise. Grâce à ces données, les pays pourront procéder à des comparaisons de prix et repérer les transactions qui méritent un examen plus approfondi. Il faudrait en outre que les pays créent leurs propres bases de données, de manière à constituer un ensemble plus solide de comparateurs locaux et régionaux.
Le recouvrement de l’impôt dépend beaucoup des capacités de l’administration fiscale. Il serait donc bon de créer, au sein de cette dernière, des services spécialisés dans les mécanismes de prix de transfert et de leur donner les moyens d’appliquer les meilleures pratiques recensées à l’échelle mondiale. Les entreprises multinationales devraient être tenues de notifier aux services spécialisés du pays dans lequel elles sont installées leurs recettes, leurs bénéfices, leurs pertes, leur chiffre d’affaires, les impôts et taxes payés, ainsi que le nombre de leurs filiales et le nombre de leurs salariés par pays ou par filiale. Il serait également souhaitable que les transactions commerciales impliquant des paradis fiscaux fassent l’objet de la plus grande vigilance de la part des autorités fiscales et douanières ainsi que des organes chargés de l’application des lois (Spanjers and Frede Foss, 2015).
Le Groupe de haut niveau recommande aussi que les pays créent des institutions indépendantes et des organismes publics qui seraient chargés de prévenir les flux financiers illicites, ou renforcent ceux existants, notamment par le biais de méthodes et de mécanismes de partage de l’information et de coordination entre les principales parties prenantes. Compte tenu du rôle majeur qu’elles jouent dans la prévention et l’élimination des flux financiers illicites, les banques et les institutions financières devraient faire l’objet d’une supervision rigoureuse de la part des banques centrales et des organes de surveillance financière. Les autorités nationales de réglementation financière devraient exiger de toutes les banques exerçant des activités dans le pays qu’elles connaissent le ou les titulaires réels de tout compte ouvert dans leurs succursales.
Niveau international
Les pays africains ne seront pas en mesure de lutter efficacement contre les flux financiers illicites si leurs partenaires régionaux et internationaux ne coopèrent pas davantage avec eux.
Au niveau mondial, des efforts considérables ont été faits en faveur d’une coopération fiscale internationale. Depuis 2000, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales, sous les auspices de l’OCDE et du G20, sert de cadre multilatéral aux activités menées sur ces questions par les pays membres de l’OCDE et par d’autres pays. Depuis sa réorganisation, en 2009, le Forum mondial est l’instance internationale qui est chargée de garantir, par des activités de suivi et des examens collégiaux, que les normes internationales en matière de transparence et d’échange de renseignements à des fins fiscales sont appliquées partout dans le monde.
Le projet OCDE/G20 de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, adopté par les Ministres des finances du G20 en juillet 2013, proposait de faire concorder fiscalité et activités économiques, de veiller à la cohérence des régimes fiscaux nationaux et de favoriser une plus grande transparence. Lors d’une réunion organisée à Brisbane (Australie), en novembre 2014, les dirigeants du G20 ont adopté une norme commune de déclaration pour l’échange automatique de renseignements fiscaux et sont convenus de commencer à échanger ces informations entre eux et avec d’autres pays en 2017 ou d’ici à la fin de 2018, sous réserve de la mise en place des procédures législatives nécessaires. Tous les pays ont été invités à souscrire à la nouvelle norme, mais il est entendu que certains pays en développement manquent cruellement de moyens pour la mettre en œuvre. Les activités de renforcement des capacités proposées par le Forum mondial vont de l’appui aux compétences à l’apprentissage mutuel entre les pays membres, en passant par l’élaboration d’outils d’aide à l’application des normes.
Suivant la même logique, des Ministres et d’autres représentants de pays africains ont lancé une initiative visant à faire mieux connaître les mérites de la transparence. Cette initiative est menée par des membres africains du Forum mondial ainsi que par le Président et co-fondateur du Forum africain sur l’administration fiscale, en collaboration avec le Forum mondial, l’OCDE, le Groupe de la Banque mondiale et le Centre de rencontres et d’études des dirigeants des administrations fiscales.
En 2002, à l’issue des travaux de l’OCDE sur les pratiques fiscales dommageables, des accords d’échange de renseignements en matière fiscale ont été établis. En juin 2015, le Comité des affaires fiscales de l’OCDE a adopté un modèle de protocole à ces accords, en vertu duquel les parties contractantes peuvent étendre leurs accords existants aux échanges automatiques ou spontanés de renseignements fiscaux. Il reste que ces accords sont peu accessibles aux pays à faible revenu. Comme il s’agit d’accords bilatéraux, ces pays n’ont en effet ni la capacité, ni l’influence politique nécessaires pour en conclure un grand nombre. De plus, ces accords n’intervenant qu’après la présentation d’une demande de renseignements, il est long et difficile d’obtenir les informations requises auprès des paradis fiscaux. L’intégration régionale de l’Afrique a ici son importance. La Communauté d’Afrique de l’Est, par exemple, a élaboré un code de conduite dans le but de prévenir la concurrence fiscale dommageable et de promouvoir l’harmonisation des incitations fiscales aux entreprises, de manière à éviter le « chacun pour soi » et le nivellement par le bas.
Une grande partie des flux financiers illicites d’origine commerciale résultent de la manipulation des prix commerciaux ou des prix de transfert, ou encore de l’érosion de la base d’imposition et du transfert de bénéfices par des entreprises multinationales (African Union and United Nations Economic Commission for Africa Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Development, 2014 ; Economic Justice Network, 2011). Les entreprises multinationales sont de plus en plus amenées à appliquer des normes de déclaration différentes en fonction des pays et, par voie de conséquence, à notifier aux autorités fiscales des données désagrégées sur les investissements, l’emploi, les recettes, les bénéfices et les impôts et taxes pour chacun des pays où elles exercent des activités.
Afin de promouvoir la cohérence entre les politiques internationales en matière de fiscalité et d’investissement, la CNUCED a proposé l’application des 10 principes suivants (UNCTAD, 2015d) :
- La pratique consistant à tolérer ou à faciliter l’évasion fiscale ne devrait pas être considérée comme un moyen d’attirer des investissements étrangers ou de soutenir la compétitivité d’entreprises multinationales à l’étranger ;
- Il importe d’atténuer les effets sur l’investissement des mesures de lutte contre l’évasion fiscale ;
- Les responsables nationaux des politiques en matière d’investissement devraient réfléchir aux mesures qui pourraient être appliquées, au moment de l’« acquisition » et de l’« établissement » des investissements, pour empêcher l’évasion fiscale ;
- Il est possible de réduire les motivations et les possibilités d’évasion fiscale par des mesures de promotion et de facilitation des investissements et par une gestion constructive des relations avec les investisseurs ;
- Les interactions entre toute mesure nationale ou internationale destinée à lutter contre l’évasion fiscale et les accords internationaux d’investissement devraient être prises en compte ;
- Aussi bien les accords internationaux d’investissement que les conventions de double imposition font partie des outils de facilitation des investissements dont disposent les pays et, à ce titre, devraient être alignés ;
- Les décideurs devraient reconnaître le rôle joué par différents types de centres financiers extraterritoriaux et par les pays d’origine et d’accueil dans l’évasion fiscale pratiquée par des entreprises au niveau international ; ils devraient préciser le partage des responsabilités et prendre des mesures étendues ;
- L’évasion fiscale et le manque de transparence des transactions financières internationales sont des problèmes de dimension mondiale ; à ce titre, ils exigent une approche multilatérale, à laquelle les pays en développement doivent être associés dans toute la mesure qui convient ;
- Les décideurs devraient prendre en compte la contribution des investissements internationaux et des recettes fiscales au financement du développement durable, ainsi que les particularités des pays en développement en matière d’évasion fiscale ;
- Les renseignements relatifs à l’investissement et à la participation au capital sont essentiels pour analyser les pratiques d’évasion fiscale et devraient être considérés en priorité, au même titre que d’autres éléments, aux fins de l’adoption de mesures de lutte contre l’évasion fiscale et de la promotion du civisme fiscal.
Les lacunes en matière de communication d’informations et de transparence dans le secteur bancaire nécessitent aussi l’adoption de dispositions réglementaires. Ces lacunes, combinées à l’insuffisance de la réglementation prudentielle, notamment face à l’essor des activités bancaires transfrontières, ont été évoquées dans le Rapport 2015 sur le développement économique en Afrique. En 2009, les banques étrangères représentaient plus de 52 % des banques commerciales établies en Afrique et détenaient 58 % du total des avoirs bancaires. Les principaux problèmes résident notamment dans l’absence de normes et d’obligations de contrôle bancaire harmonisées entre les pays et dans le manque de compétence réglementaire, qui empêchent la surveillance intrarégionale ou intrasectorielle des services financiers ainsi que le contrôle des activités externalisées.
L’Union africaine et l’Organisation des Nations Unies doivent redoubler d’efforts pour faire comprendre aux dirigeants et aux universitaires africains, aux organisations non gouvernementales et aux autres organismes de la société civile que les recommandations du Groupe de haut niveau chargé de la question des flux financiers illicites en provenance d’Afrique doivent se traduire par des mesures concrètes aux niveaux national et régional. Ces mesures sont les suivantes :
- Au niveau multilatéral, un forum pourrait être régulièrement organisé sous les auspices de l’Union africaine et de l’Organisation des Nations Unies, afin que les États africains et les pays développés réfléchissent à la manière dont la coopération internationale devrait être mise à profit et dont un cadre international de lutte contre les flux financiers illicites pourrait être établi. Par exemple, il serait possible de créer un registre international des entreprises multinationales, qui contiendrait des renseignements sur leurs activités et leurs comptes, et d’établir des règles obligeant ces entreprises à communiquer des informations qui soient universellement comparables. Des dirigeants d’autres régions pourraient aussi être conviés au forum afin de mettre en évidence la dimension mondiale du problème et le besoin d’une coopération et d’une coordination à l’échelle internationale ;
- Au niveau bilatéral, les États africains devraient chercher une assistance technique auprès de leurs partenaires de développement sur la manière de traiter les causes et les caractéristiques des flux financiers illicites. Par exemple, pour empêcher la manipulation des prix commerciaux, des systèmes douaniers informatisés pourraient être mis en place afin de permettre aux pays importateurs et exportateurs de comparer rapidement la valeur, la qualité et la quantité des biens échangés et de partager des renseignements à ce sujet. En outre, une aide pourrait être apportée afin de créer des services chargés de lutter contre les flux financiers illicites, et la coopération entre les services ainsi créés dans différents pays pourrait être encouragée.
Les enseignements tirés par le Groupe de haut niveau pourraient contribuer à la définition d’une architecture ou d’une structure de gouvernance mondiale plus efficace qui permettrait de faire face à ce problème d’envergure planétaire et de lutter contre les flux financiers illicites, pour autant que ceux-ci fassent l’objet de débats francs et ouverts qui les replacent dans le contexte plus large du développement et, au bout du compte, du financement du développement.
De plus, des initiatives interdépendantes, comme la Vision africaine des mines, l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, le Groupe d’action financière et l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés41, devraient être pleinement associées à cette entreprise, afin de tirer parti de leurs réalisations et de leurs bonnes pratiques et d’éviter les doubles emplois. Bien qu’il ne soit pas mentionné dans le Programme d’action d’Addis-Abeba, le problème des flux financiers illicites est indissociable des dettes illégitimes et odieuses, et il convient de mettre fin à l’accumulation de ces dettes par des mesures énergiques (encadré 7). Enfin, il faudrait reconnaître que la société civile joue un rôle vital en tant que gardienne de la transparence et faire appel à elle pour renforcer la vigilance.
Encadré 7. S’attaquer aux dettes odieuses
Suivant la doctrine juridique, une dette souveraine contractée sans le consentement des citoyens et à l’encontre de leur intérêt est odieuse et ne devrait pas être supportée par le gouvernement ultérieur, surtout si les créanciers sont conscients de sa nature. Selon Howse (2007), la notion de « dette odieuse » fait intervenir différents arguments d’équité, dont les pays se sont souvent prévalus dans le but d’ajuster ou de réduire les charges du service de la dette en période de transition politique. Une analyse des divers types de transition montre que, lorsque la notion de dette odieuse est invoquée par les débiteurs pour limiter leurs obligations, elle varie selon que la transition politique concerne une sécession, une guerre, un processus de décolonisation ou un simple changement de régime.
Kremer et Jayachandran (2002) proposent deux solutions pour éviter que des prêts soient consentis à des régimes odieux. Premièrement, les pays créanciers pourraient modifier leurs lois afin que les actifs d’un autre pays ne puissent pas être confisqués en cas de non-remboursement d’une dette odieuse. Autrement dit, les contrats impliquant une dette odieuse pourraient être inexécutables. Deuxièmement, l’octroi d’une aide étrangère au gouvernement prenant la relève pourrait être subordonné au non-remboursement de la dette odieuse. Plus exactement, des donateurs pourraient refuser d’apporter leur aide à un pays parce que cela reviendrait, en quelque sorte, à verser des fonds à des banques détenant des créances illégitimes.
Chapitre 5
PRINCIPALES CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS PRATIQUES
Les nombreuses aspirations de l’Afrique en matière de développement sont contrariées par de grands obstacles, à savoir : l’ampleur colossale des besoins de financement dans un contexte où les modalités de financement sont en train de changer et l’augmentation rapide de la dette publique. Alors que le continent s’engage dans son processus de transformation économique, la dette intérieure joue un rôle de plus en plus important. Les pays africains devront tirer parti des diverses sources de financement du développement en conciliant leurs besoins de financement accrus et la viabilité de leur dette globale.
Le présent rapport examine quelques problématiques fondamentales propres à la dette intérieure et extérieure des pays africains et donne des conseils sur le fragile équilibre à trouver entre les différentes modalités de financement du développement et l’impératif de viabilité de la dette globale. Le présent chapitre récapitule les principales conclusions, les messages essentiels et les recommandations pratiques qui ressortent du rapport.
A. PRINCIPALES CONCLUSIONS
Les principales conclusions du rapport sont les suivantes :
- L’Afrique rencontre de grandes difficultés à satisfaire ses besoins de financement en matière de développement au moyen des ressources budgétaires publiques.
On estime que pour financer la réalisation des objectifs de développement durable, l’Afrique pourrait avoir besoin de 600 à 1 200 milliards de dollars par an (Chinzana et al., 2015 ; Schmidt-Traub, 2015 ; UNCTAD, 2014). Le coût des infrastructures à elles seules s’élèverait à 93 milliards de dollars, mais l’Afrique ne peut mobiliser que la moitié de ce montant.
- La dette extérieure de l’Afrique est en hausse, sous l’effet principalement de la baisse des recettes à l’exportation, d’un creusement du déficit des comptes courants et d’un ralentissement de la croissance économique.
En 2011-2013, le stock de la dette extérieure s’est établi en moyenne à 443 milliards de dollars, contre 303 milliards de dollars en 2006-2009. Les ratios dette extérieure/RNB sont faibles puisqu’ils sont inférieurs à 40 % dans la plupart des pays africains. Si, globalement, le stock de la dette extérieure a diminué dans le temps (depuis 2000, année où il représentait 107 % du RNB), il a augmenté dans plusieurs pays africains. Mais cette tendance générale occulte la hausse rapide de la dette extérieure enregistrée dans plusieurs pays africains au cours des dernières années. Bien que les ratios dette-RNB n’aient pas beaucoup évolué depuis 2006, le stock de la dette extérieure a progressé rapidement, soit en moyenne de 10,2 % par an en 2011-2013, contre 7,8 % en 2006-2009. Les principaux facteurs du gonflement de la dette sont le creusement du déficit des comptes courants et le ralentissement de la croissance économique. - La composition, les modalités et les conditions de la dette extérieure évoluent.
Premièrement, la part des financements concessionnels42 a diminué dans deux pays pauvres très endettés sur trois en Afrique entre 2005-2007 et 2011-2013. Deuxièmement, la durée moyenne de l’échéance et du délai de grâce des nouveaux emprunts extérieurs de ces pays a été sensiblement et régulièrement raccourcie depuis 2005. De plus, le taux d’intérêt moyen de ces nouveaux emprunts a augmenté même s’il est resté inférieur à la moyenne dans les pays pauvres peu endettés d’Afrique ainsi que dans les pays à faible revenu. Troisièmement, la dette publique et garantie par l’État détenue par des créanciers privés est non seulement en hausse dans les pays pauvres très endettés et dans les autres pays pauvres, mais elle s’est aussi diversifiée. La diminution de la part de la dette concessionnelle, l’augmentation des taux d’intérêt et le raccourcissement de l’échéance et du délai de grâce auront très probablement pour effet d’alourdir le fardeau de la dette des pays africains. - La structure et la composition de la dette sont importantes pour la viabilité de celle-ci et pour le Cadre de viabilité de la dette.
Le Cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu lancé conjointement par la Banque mondiale et le Fonds monétaire international est conçu pour aider ces pays à assurer la viabilité de leur dette lorsque de nouveaux emprunts sont contractés sous forme de prêts publics concessionnels. Il vise principalement à évaluer la viabilité de la dette afin de se prémunir contre les risques de surendettement. Le cadre actuel doit être revu afin d’éviter que les pays à faible revenu soient enfermés dans un scénario d’endettement et de croissance faibles et de prendre en compte la dette intérieure dans l’analyse de la viabilité de la dette. Il est difficile pour les pays africains d’assurer la viabilité de leur dette tout en s’efforçant de financer leur stratégie nationale de développement et de mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030. - La dette intérieure augmente régulièrement et la dette négociable y occupe une place grandissante.
L’analyse des cinq études de cas présentées fait ressortir des constantes comme l’augmentation régulière de la dette intérieure, qui est passée de 11 % à 17 % du PIB en 2014. Qui plus est, la plupart des gouvernements ont satisfait une part croissante de leurs besoins de financement par l’émission de dettes négociables au détriment des dettes non négociables. Parmi les titres négociables figurent les billets de trésorerie, les acceptations bancaires, les bons du Trésor et d’autres instruments du marché monétaire. - Les marchés nationaux de capitaux se sont développés au fur et à mesure que l’intérêt des investisseurs internationaux s’accroissait.
Au cours des dix dernières années, de plus en plus de pays ont acquis la capacité d’émettre des titres de dette libellés en monnaie locale et à longue échéance, ce qui laisse penser que l’obstacle du péché originel serait en train d’être surmonté. De manière générale, les marchés se sont développés, les échéances se sont allongées et la base des investisseurs s’est élargie, ce qui a permis aux gouvernements d’emprunter plus facilement sur le marché intérieur, les conditions financières mondiales ayant conduit des investisseurs financiers internationaux à s’intéresser à des marchés auparavant trop risqués à leurs yeux. Il est néanmoins possible d’améliorer le fonctionnement des marchés de la dette intérieure, notamment en réformant le secteur financier non bancaire afin d’élargir la base des investisseurs dans les titres publics à longue échéance. Un renforcement du secteur des prestations de retraite et de celui des assurances pourrait avoir pour effet d’accroître le montant de l’épargne à long terme disponible pour les marchés de la dette intérieure. On constate que si les taux d’intérêt de la dette intérieure sont encore plus élevés que ceux de la dette extérieure, ils diminuent avec le temps au fur et à mesure que les marchés intérieurs de la dette se développent. Mais la dette extérieure est sensible au risque de change, contrairement à la dette intérieure. Le taux d’intérêt de la dette libellée en monnaie locale ne devrait donc pas être considéré comme le seul facteur déterminant dans le choix de recourir aux marchés intérieurs de la dette comme source de financement du développement. Il faudrait aussi tenir compte du profil risque-rendement des instruments de dette extérieure ou intérieure. Enfin, les effets dynamiques du développement du secteur financier ne devraient pas être sous-estimés dans le contexte d’une croissance favorable aux pauvres et d’un développement économique axé sur la transformation car l’expansion du secteur financier peut influer dans une large mesure sur les possibilités d’accès aux services financiers dont bénéficient les personnes qui ne possèdent pas de compte bancaire, surtout les femmes – seules 20 % des femmes ont accès à des services financiers formels en Afrique (UNCTAD, 2015c). - Les envois de fonds et l’épargne de la diaspora sont des sources possibles de financement du développement.
Les gouvernements et les institutions financières ont conçu des instruments financiers pour tirer parti de l’épargne de la diaspora et mobiliser les envois de fonds comme sources de financement du développement. Le taux d’intérêt servi sur les obligations – diaspora devrait être suffisamment attrayant pour compenser le risque politique aux yeux des investisseurs étrangers. Les pays émetteurs pourraient aussi s’efforcer de tirer parti des possibilités offertes par ces obligations compte tenu des prescriptions techniques et administratives qu’il faut respecter pour les vendre à l’étranger. Le recours à des circuits formels d’envoi de fonds devrait être encouragé afin que ces fonds puissent servir de garantie et contribuer au développement du secteur financier. - Les flux financiers illicites pourraient devenir une source de financement du développement à condition que la lutte contre ce phénomène perdure au niveau national et international. L’Afrique a besoin d’une coopération permanente à l’échelle du continent ainsi que de la participation et de l’aide des organisations internationales et de leurs membres pour lutter contre les flux financiers illicites et alléger la dette. Cela est d’autant plus crucial que les fonds ainsi perdus par les pays africains se sont élevés à 854 milliards de dollars entre 1970 et 2008, somme pratiquement équivalente à la totalité de l’aide publique au développement reçue pendant cette période et dont un tiers aurait suffi à couvrir sa dette extérieure.Au niveau mondial, les travaux du Groupe de haut niveau sur les flux financiers illicites en provenance de l’Afrique pourraient contribuer à la mise en place d’une architecture ou d’une structure de gouvernance mondiale qui lutte plus efficacement contre les flux financiers illicites si ceux-ci sont appréhendés dans un dialogue sincère et ouvert qui les inscrit dans le cadre plus large du développement et, en fin de compte, du financement du développement. Il est impératif que tous les acteurs interagissent et participent à ce dialogue. En outre, d’autres initiatives telles que la Vision africaine des mines, l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, le Groupe d’action financière, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales et l’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés devraient y être associées afin d’éviter tout double emploi tout en tirant parti de leur expérience et de leurs bonnes pratiques. Enfin, il faudrait reconnaître le rôle essentiel que joue la société civile et faire sorte que celle-ci contribue à une vigilance accrue.
- Les partenariats public-privé s’étendent et doivent faire l’objet d’une attention particulière dans l’optique de la gestion de la dette.
Par rapport à d’autres régions, les partenariats public-privé dans les infrastructures sont d’une moindre ampleur et sont moins nombreux en Afrique, mais ils se multiplient. Les partenariats public-privé, surtout ceux axés sur le développement des infrastructures, sont complexes et très risqués. Ce sont généralement des projets capitalistiques à long terme dont les dispositions contractuelles sont complexes au point de rendre difficile leur évaluation et leur prise en compte selon des modalités satisfaisantes. Il est donc essentiel de mettre en place un cadre directif des partenariats public-privé qui remédie à ces risques et les atténue. Pour y parvenir, il est nécessaire de disposer d’un large éventail de capacités juridiques, administratives et techniques. Ces partenariats font courir un gros risque, notamment car ce sont des opérations hors budget (passifs éventuels) qui peuvent devenir un fardeau budgétaire. Certains pays peuvent aussi être incités à y recourir pour contourner les plafonds d’endettement établis au niveau national ou par le FMI. Aucune estimation de l’impact des passifs éventuels sur la viabilité de la dette n’est prise en compte dans le cadre actuel de viabilité de la dette.
B. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS PRATIQUES
L’Afrique est à la croisée des chemins dans son développement. En raison du coût élevé du financement de la réalisation des objectifs de développement durable, coût que l’aide publique au développement et la dette extérieure ne suffiront probablement pas à couvrir, la dette intérieure occupe une place grandissante dans le financement du développement. Il importe aussi d’assurer la viabilité de la dette et de prévenir tout surendettement. Il est clairement souhaitable de réaliser les objectifs susmentionnés tout en préservant la viabilité de la dette. Le dilemme est de savoir comment les pays africains vont atteindre le double objectif qui consiste à satisfaire leurs besoins de financement en matière de développement et à préserver la viabilité de la dette. Certaines recommandations pratiques examinées ci-après peuvent être utiles à l’Afrique.
- Mobiliser des ressources suffisantes pour financer le développement à partir de sources intérieures et extérieures afin d’atteindre les objectifs de développement et d’aboutir à une transformation structurelle
Compte tenu de la complexité des problèmes de développement de l’Afrique, de l’ampleur de ses besoins de financement en matière de développement et de l’acuité des contraintes qui pèsent sur leurs capacités, les pays africains ont besoin de mobiliser toutes les sources potentielles de financement. La dette, qu’elle soit intérieure ou extérieure, à côté d’autres sources complémentaires, ne saurait être exclue de la liste des modalités de financement du développement en Afrique. La dette destinée à financer la réalisation des objectifs de développement durable devrait donc être appréhendée de manière plus souple. Par exemple, si la dette servait à renforcer la résilience (objectif 9), elle contribuerait à surmonter des contraintes importantes pesant sur les capacités productives et favoriserait ainsi la transformation structurelle. Toutefois, la plupart des investissements nécessaires à la réalisation des objectifs de développement durable ne peuvent être financés par la seule dette car sa viabilité en pâtirait dans la majorité des pays africains. La mobilisation de ressources intérieures destinées à être investies dans le développement des capacités productives jouera un rôle essentiel dans la transformation structurelle de l’Afrique (UNCTAD, 2015e).
- Mobiliser la dette intérieure et extérieure sans compromettre la viabilité de la dette
La viabilité de la dette n’est jamais garantie. N’importe quel choc grave peut faire sortir un pays donné des limites d’un endettement viable. Un meilleur équilibre doit être trouvé entre les avantages liés à la contraction de nouveaux emprunts concessionnels et non concessionnels auprès de sources intérieures et extérieures et ceux que procure la restriction de ces emprunts dans le but d’assurer la viabilité de la dette. L’Afrique doit donc continuer de renforcer
ses fondamentaux macroéconomiques et de poursuivre sa transformation structurelle pour éviter de tomber à nouveau dans le piège de la dette. Il est aussi important que les pays africains :
- Réduisent le déficit de leurs comptes courants;
- Soient moins sensibles à l’instabilité des produits de base en diversifiant leurs exportations ;
- Conçoivent des programmes d’investissement rationnels qui comportent des projets bien choisis et recensent les principaux goulets d’étranglement afin de veiller à ce que les projets soient exécutés dans les délais impartis ;
- Luttent contre la corruption et la mauvaise allocation des fonds;
- Fassent en sorte que les dépenses publiques et le recouvrement des recettes soient plus efficaces ;
- Élaborent une approche stratégique permettant de recenser les meilleures solutions de financement en tenant compte des coûts financiers, de l’échéance et des structures de paiement, afin de les adapter aux nouveaux
En fin de compte, la responsabilité de préserver la viabilité de la dette incombe aux emprunteurs et aux prêteurs. Il faut ainsi redoubler d’efforts pour encourager les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à souscrire à des principes relatifs à la promotion de prêts et d’emprunts souverains responsables et à trouver un accord sur les processus de restructuration de la dette souveraine.
- Appuyer la révision d’un cadre de viabilité de la dette qui englobe la viabilisation de la dette et prend en compte les particularités de chaque pays dans son analyse
Compte tenu des besoins croissants de financement du développement des pays africains et des pays en développement en général, des arguments pourraient être avancés en faveur d’une révision des cadres de viabilité de la dette. Depuis les années 1990, malgré diverses améliorations apportées aux cadres et aux analyses de la viabilité de la dette, beaucoup considèrent que le cadre actuel est trop mécanique, rétrospectif et restrictif car il ne différencie pas assez les dépenses d’équipement des dépenses publiques récurrentes (UNCTAD, 2004). Pour de nombreux pays africains, il demeure difficile de concilier le gonflement de la dette extérieure destiné à financer les stratégies nationales de développement et la réalisation des objectifs de développement durable, d’une part, et le maintien de la viabilité de la dette extérieure, d’autre part.
Un autre problème réside dans le fait que l’on met trop l’accent sur des indicateurs généraux de la dette tels que les ratios dette-PIB ou dette-exportations, au lieu de s’intéresser au rapport entre le service de la dette intérieure et extérieure et les recettes publiques. Sous l’effet principalement de l’envolée des prix des produits de base au début des années 2000 et des découvertes récentes de gisements sur le continent, de nombreux pays africains ont vu leurs exportations enregistrer une progression à deux chiffres. D’où la faiblesse des ratios dette-exportations, qui ne traduisent pas forcément les capacités de paiement à long terme de ces pays, surtout dans les cas où les ressources extraites surtout par des sociétés multinationales procurent très peu de recettes publiques.
Fondamentalement, le cadre actuel de viabilité de la dette est peut-être trop restrictif pour les pays à faible revenu qui ont la capacité de s’endetter davantage et qui pourraient ainsi stimuler la croissance. Certains pays africains à faible revenu craignent que le Cadre de viabilité de la dette les enferme dans un scenario d’endettement et de croissance faibles.
Des améliorations peuvent être apportées au Cadre de viabilité de la dette afin d’autoriser une augmentation modérée du financement par la dette qui permette aux pays africains de réaliser progressivement les objectifs de développement durable sans tomber dans le surendettement. Le cadre révisé devrait notamment être caractérisé par les éléments suivants :
- Prendre en compte les investissements destinés au financement des objectifs de développement durable : Le cadre révisé devrait intégrer un système de surveillance qui contrôle la manière dont la dette est utilisée, en veillant à ce que les pays empruntent pour financer des investissements productifs, plutôt que des achats de consommation, et contribuent à la réalisation desdits objectifs ;
- Accorder une plus grande importance au plafonnement du service de la dette : Le Cadre de viabilité de la dette pour les pays à faible revenu serait sensiblement amélioré si l’accent était mis sur le rapport entre les remboursements au titre du service de la dette et les recettes publiques et si les remboursements étaient plafonnés, en réduisant proportionnellement les remboursements à tous les créanciers, y compris les créanciers Il faudrait alors inscrire les limites fixées en matière de service de la dette dans une clause d’action collective contraignante. Étant donné que l’on ne sait jamais si un problème de dette est dû à un manque passager de liquidités ou à un surendettement plus permanent, le service de la dette pourrait être plafonné à titre temporaire sans réduire le stock total de la dette. Si un problème de surendettement à plus long terme était avéré, une réduction de la dette serait nécessaire.
- Favoriser le développement et la diversification du secteur financier au niveau national afin d’accroître les ressources intérieures et d’attirer l’épargne de la diaspora
Le rapport a permis de constater que les pays africains avaient accompli des progrès importants dans le développement et la diversification de leur secteur financier. Il est encourageant d’observer que des pays ont été en mesure d’émettre des obligations et divers autres instruments à long terme qui étaient davantage négociables. En outre, les pays africains ont adopté des mesures visant à développer leur marché intérieur de la dette, avec l’aide d’institutions financières internationales publiques telles que la Banque africaine de développement, le FMI, l’OCDE et la Banque mondiale.
Cette évolution est encourageante, mais on peut aller encore plus loin dans le développement des activités financières. Par exemple, les possibilités offertes par l’épargne provenant du secteur des pensions de retraite et de celui des assurances devraient être mieux exploitées. De plus, si le recours aux circuits formels d’envoi de fonds était facilité et si les coûts de transfert étaient abaissés, le montant des sommes transitant par ces circuits augmenterait. Le développement du secteur financier permettra aussi de mobiliser et d’utiliser l’épargne de la diaspora, par exemple sous la forme d’obligations – diaspora, de dépôts libellés en devises et de prêts consortiaux garantis par les envois de fonds.
La hausse de la dette intérieure dans le cadre de la mobilisation de ressources intérieures destinées à financer le développement pourrait aider à réduire la dépendance de l’Afrique à l’égard de l’investissement étranger direct et de l’aide publique, qui sont l’un comme l’autre instables, et à accroître la marge d’action des pays africains. L’obligation de rendre compte des politiques suivies et l’appropriation par les pays de leur stratégie de développement pourraient aussi s’en trouver renforcées car le recours accru aux sources intérieures de financement peut réduire les vulnérabilités liées à la dette extérieure.
- Exploiter les possibilités qu’offrent les partenariats public-privé en renforçant les cadres qui les régissent aux niveaux national et régional tout en préservant la viabilité de la dette
Les gouvernements devraient mettre en place des cadres juridiques et directifs propres à optimiser le recours aux partenariats public-privé dans l’optique du développement tout en réduisant au minimum les incidences néfastes d’un échec éventuel de ces partenariats. À ce propos, la réglementation et l’élaboration des politiques doivent encore jouer un rôle important dans la définition des modalités de prise en compte de ces partenariats dans l’optique d’une gestion viable de la dette et du développement économique général. L’élaboration d’une réglementation qui sert de guide à une bonne évaluation et prise en compte des partenariats public-privé devrait s’accompagner de la définition de principes de gestion des risques et de l’étude de la possibilité de créer un fonds pour les passifs éventuels auquel recourir en cas d’intervention des pouvoirs publics rendue nécessaire par l’échec de ce type de partenariat.
Pour que les partenariats public-privé soient mieux gérés, les pays africains pourraient envisager d’utiliser le modèle du Cadre de viabilité de la dette afin de concevoir des scénarios sur mesure dans les analyses de la viabilité de la dette extérieure et de la dette publique. L’un de ces scénarios se présente sous la forme d’un test de résistance normalisé à un choc générique provenant d’un passif éventuel. Lorsque les informations sont disponibles, un scénario plus adapté à un pays donné peut se justifier afin de tenir compte des passifs éventuels liés notamment aux entreprises publiques, aux collectivités locales, aux partenariats public-privé et aux déficiences du secteur financier.
Il est tout aussi important pour les gouvernements des pays africains d’être vigilants face aux risques liés aux passifs éventuels. Les gestionnaires de la dette devraient veiller à prendre en compte l’impact des risques que ces passifs font peser sur les comptes publics, notamment sur la liquidité globale, lorsqu’ils conçoivent leur stratégie. Même s’il est clair que les négociations et les accords conclus entre un gouvernement (en particulier des entreprises publiques) et des sociétés privées doivent rester confidentiels, les conditions financières générales qui en découlent devraient néanmoins être rendues publiques. Si le gouvernement en question s’avère insolvable, ces passifs peuvent être problématiques pour les comptes publics. D’où la possibilité de renforcer le contrôle du Parlement, en confiant aux parlementaires la responsabilité d’approuver ces accords au cas par cas, plutôt que l’enveloppe globale des nouveaux emprunts pour l’année. Si cette pratique aboutissait à une situation de blocage, le contrôle exercé pourrait être restreint aux contrats dépassant un montant minimal. Il est essentiel de consolider les capacités institutionnelles de notation, de suivi et de gestion de la dette, publique ou privée, des pays africains, afin de leur permettre d’administrer leur dette de manière plus viable. La CNUCED peut aider ces pays à mettre au point des séries statistiques et à développer leurs capacités dans les domaines de la dette intérieure, de la dette extérieure privée, de la composition de la dette et de la restructuration de la dette souveraine.
- Resserrer la coopération internationale et régionale et développer des capacités institutionnelles permettant de faire face aux besoins de financement de l’Afrique
L’intégration régionale pourrait jouer un rôle essentiel dans la coordination et l’intégration d’éléments réglementaires et institutionnels essentiels provenant d’initiatives plus générales sur le financement du développement lancées dans le contexte de l’Agenda 2063 et du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il faudrait aider l’Union africaine et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique à stimuler les stratégies nationales et régionales, à instaurer les cadres institutionnels voulus et à promouvoir des instruments de mobilisation de ressources tels que des bourses régionales, le Fonds africain de garantie et le Programme de développement des infrastructures en Afrique. Pour y parvenir, il faudra afficher une forte volonté politique et mettre en commun de manière efficace les ressources du continent.
Il est encore possible d’améliorer la gestion de la dette en tenant compte de l’ensemble des sources de financement ; la mise en place d’une coordination avec l’Union africaine, conjuguée à une approche qui englobe l’ensemble des pouvoirs publics, pourrait aider à renforcer les stratégies de gestion de la dette à moyen terme. À cet égard, il pourrait être particulièrement important de promouvoir les principes de la CNUCED relatifs à des prêts et des emprunts souverains responsables. L’Afrique devra continuer de renforcer ses capacités de gestion de la dette. Si, au cours des dernières années, plusieurs programmes de formation ont été encouragés dans ce domaine, de nouvelles compétences relatives aux marchés financiers privés, compétences que les fonctionnaires n’ont peut-être pas encore acquises, sont nécessaires pour appréhender la complexité des nouvelles modalités de financement. Au niveau international, la coopération en matière fiscale et contre les flux financiers illicites devrait être poursuivie et renforcée. L’Afrique ne saurait lutter contre les flux financiers illicites toute seule ; une aide multilatérale serait particulièrement bienvenue pour renforcer ses capacités institutionnelles dans ce domaine, de même qu’un engagement de la communauté internationale de s’attaquer à cette question importante. Les capacités des autorités de recouvrement des recettes publiques devraient donc être consolidées dans divers domaines, en particulier en matière fiscale et en vue d’avoir une connaissance détaillée des flux financiers illicites et de les restreindre.
- Remédier au manque de données et développer les capacités analytiques de suivi et de gestion de la dette
Il existe encore des problèmes considérables de disponibilité de données. Suite aux nombreuses initiatives lancées, surtout concernant la gestion de la dette des pays africains, il est surprenant de constater que peu de données sur la dette intérieure et les recettes publiques sont rendues publiques. Si le FMI et la Banque mondiale possèdent des informations de ce type sur la plupart des pays, surtout sur les pays pauvres très endettés d’Afrique, qu’ils surveillent très régulièrement, la plupart d’entre elles ne sont pas facilement accessibles au public. Par exemple, les bases de données sur les Indicateurs du développement dans le monde et sur le financement du développement dans le monde ne contiennent pas d’informations sur la dette intérieure et comportent des lacunes considérables sur les recettes publiques. L’absence de ce type de données contribue à l’utilisation d’indicateurs de la dette qui sont moins pertinents comme les ratios dette-PIB et dette-exportations. Il sera essentiel d’accroître les capacités institutionnelles de collecte, de compilation et d’analyse des données sur la dette pour améliorer la viabilité de celle-ci, en particulier dans les pays en développement. Le Système de gestion et d’analyse de la dette de la CNUCED est une bonne illustration de la manière dont la coopération technique peut appuyer ce processus en Afrique. Un logiciel de gestion et d’analyse de la dette a ainsi été spécialement conçu pour répondre aux besoins opérationnels, statistiques et analytiques des gestionnaires de la dette. Il pourrait aider les pays en développement à améliorer la qualité de leur base de données sur la dette, contribuant ainsi à accroître la transparence et la responsabilité, la communication d’informations sur la dette et l’analyse de la vulnérabilité de celle-ci.
NOTES
NOTES
1 Le rendement s’entend du retour sur investissement et renvoie aux intérêts ou aux dividendes servis sur un titre, qui correspondent généralement à un pourcentage annuel calculé en fonction du coût de l’investissement ou de sa valeur marchande ou nominale courante. Le retour sur investissement correspond aux gains effectifs qu’un investisseur a enregistrés pendant une période écoulée et comprend les intérêts, les dividendes et les plus-values (liées notamment à l’augmentation des cours des actions). Il est rétrospectif et correspond aux gains concrets réalisés sur un investissement. Le rendement, quant à lui, correspond à une prévision, étant donné qu’il mesure le revenu, comme les intérêts et les dividendes, qu’un investissement peut procurer et ne tient pas compte des plus-values.
2 Au 1er juillet 2015, on entendait par pays à faible revenu les pays dont le RNB par habitant, calculé selon la méthode Atlas de la Banque mondiale, était égal ou inférieur à 1 045 dollars en 2014, par pays à revenu intermédiaire les pays dont le RNB par habitant était égal ou supérieur à 12 736 dollars, et par pays à revenu élevé les pays dont le RNB par habitant était égal ou supérieur à 12 736 dollars. Le seuil séparant les pays à revenu intermédiaire inférieur et les pays à revenu intermédiaire supérieur était fixé à 4 125 dollars de RNB par habitant (World Bank, 2016d).
3 Dans certains milieux, l’importance que le Programme d’action Addis-Abeba accorde à la mobilisation des ressources intérieures et au rôle du secteur privé a fait l’objet de critiques (Deen, 2015).
4 La mobilisation des ressources intérieures, conjuguée à une inversion des flux financiers illicites, a récemment gagné de l’importance pour devenir l’un des principaux moyens qu’a l’Afrique de financer ses besoins de développement, dans le droit fil des objectifs de développement durable et de l’Agenda 2063. On estime que les flux financiers illicites coûtent à l’Afrique environ 50 milliards de dollars par an (African Union and United Nations Economic Commission for Africa Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Delveopment, 2014).
5 Selon certaines études, les marchés boursiers ne contribuent pas particulièrement au développement de rattrapage, que ce soit à un stade précoce ou tardif (Singh, 2010).
6 En général, la part relative de la dette extérieure détenue par les débiteurs privés est faible en Afrique. Bien que le ratio dette extérieure privée/RNB augmente, il est encore nettement inférieur à celui qui prévaut en Asie ainsi qu’en Amérique latine et aux Caraïbes (UNCTAD, 2015b).
7 La présente section porte essentiellement sur le ratio dette extérieure/RNB car c’est le critère le plus connu et le plus couramment utilisé dans de nombreux débats sur l’endettement. Cela étant, la CNUCED a aussi réalisé des estimations de la valeur nette actuelle de la dette extérieure totale en tenant compte de l’évolution du taux d’actualisation dans le temps et de différences souvent notables entre la durée des prêts et les taux d’intérêt selon les pays. En 2006-2013, la valeur actuelle nette de la dette extérieure des pays africains a augmenté dans les pays pauvres peu endettés, mais le ratio valeur actuelle nette de la dette/RNB est resté stable, à 20 % environ, aussi bien dans les pays pauvres très endettés que dans les autres pays pauvres. Dans la plupart des cas, l’évolution constatée s’apparentait à celle qui était illustrée au tableau 2.
8 En janvier 2014-décembre 2015, les prix du pétrole brut ont baissé de 47 %, ceux des minéraux, des minerais et des métaux de 22 %, ceux des oléagineux et de l’huile de 20 % et ceux des produits alimentaires et des boissons tropicales ainsi que des matières premières de 14 % (UNCTAD, 2016). Les exportateurs ont ainsi subi le contrecoup de la baisse du prix des produits de base, même si le pétrole a été le plus touché.
9 En novembre 2015, aucune donnée n’était disponible sur Djibouti, la Guinée équatoriale, la Libye, la Namibie, la Somalie ou le Soudan du Sud dans World Bank (2016b). En décembre 2015, les Seychelles ne figuraient plus dans cette base de données.
10 En 2013, la Banque mondiale a défini les pays à revenu intermédiaire comme les pays dont le RNB par habitant dépasse 1 035 dollars. Selon cet indicateur, 15 pays africains (Algérie, Botswana, Cabo Verde, Congo, Égypte, Guinée équatoriale, Gabon, Libye, Maurice, Maroc, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland et Tunisie) étaient classés dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire en 2006 et 25 (pays énumérés auxquels s’ajoutent le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Kenya, le Lesotho, la Mauritanie, le Niger, Sao Tomé-et-Principe, le Soudan et la Zambie) entraient dans cette catégorie en 2013.
11 En décembre 2015, les Seychelles ne figuraient plus dans la base de données de la Banque mondiale (World Bank, 2016b).
12 D’après Davies et al. (à paraître), l’Ouganda ne se finance pas sur les marchés financiers internationaux en raison du coût des obligations souveraines et de la crainte de voir la dette publique atteindre un niveau intolérable en cas de dépréciation de la monnaie, entraînant une hausse des rendements obligataires.
13 La courbe des rendements indique le rendement ou le taux d’intérêt d’un même type de dette en fonction de la durée du contrat (2 mois, 2 ans ou 20 ans), illustrant ainsi la relation entre le (niveau du) taux d’intérêt (ou le coût de l’emprunt) et l’échéance de la dette pour un emprunteur donné dans une monnaie donnée.
14 Le rééchelonnement consiste à proroger ou transférer une dette ou tout autre arrangement financier. Il présente un risque lié au refinancement de la dette. En cas de hausse malencontreuse des taux d’intérêt, les pays sont contraints de se refinancer à un taux plus élevé et le montant de leurs remboursements augmente.
15 Le délai de grâce est le délai entre la date de la signature d’un prêt ou de l’émission d’un instrument financier et la date du premier remboursement du principal. L’échéance est le nombre d’années qui courent depuis la date initiale : elle comprend le délai de grâce et la période de remboursement, laquelle s’étend du premier au dernier remboursement du principal.
16 Parmi les facteurs analysés figurent la croissance du PIB, les réserves internationales/ PIB, l’ouverture commerciale, la sous-évaluation des taux de change, le taux de progression des crédits privés, le solde budgétaire et la balance des paiements courants, l’inflation et la lutte contre la corruption.
17 Les pays à faible revenu sont définis dans la note 2. La catégorie des pays les moins avancés est définie par l’ONU en fonction d’un ensemble différent de critères. En 2016, parmi les 31 pays à faible revenu répertoriés par la Banque mondiale, 29 étaient des pays les moins avancés et 26 étaient en Afrique.
18 L’indice d’évaluation de la politique et des institutions nationales est établi chaque année par la Banque mondiale pour tous les pays admis à bénéficier de l’aide de l’Association internationale de développement, notamment des pays pouvant prétendre à un financement mixte. Allant de 1 (plus bas) à 6 (plus haut), il comporte 16 indicateurs regroupés en quatre catégories : gestion économique, réformes structurelles, politiques d’insertion sociale et d’équité, gestion et institutions du secteur public. Il permet de classer les pays en trois catégories en fonction de la qualité de leur politique et de leurs institutions ; celles-ci sont considérées comme médiocres dans les pays dont le score est inférieur ou égal à 3,25, comme moyennement satisfaisantes dans les pays dont le score est supérieur à 3,25 mais inférieur à 3,75 et comme bonnes dans les pays dont le score est supérieur ou égal à 3,75 (IMF, 2013b).
19 Une clause d’action collective autorise une supermajorité de détenteurs d’obligations à s’entendre sur une restructuration de la dette juridiquement contraignante pour l’ensemble des détenteurs, y compris ceux qui votent contre cette restructuration. Elle constitue un moyen de faciliter la coordination des détenteurs d’obligations.
20 Ces risques sont actuellement analysés comme un choc générique entraînant une hausse de 10 % de la dette dans le PIB, créant des flux dans la deuxième année de la période de projection et donnent lieu à des scénarios sur mesure propres à chaque pays lorsque l’information est disponible (IMF, 2013b).
21 Selon les termes de l’exception de 2002 aux modalités d’accès à ses ressources, le FMI ne pouvait accorder son aide qu’à la condition que soit mise en œuvre une opération de restructuration de la dette d’ampleur suffisante pour lui permettre de conclure que, après cette restructuration, l’endettement du pays membre serait viable avec une forte probabilité. Craignant les effets systémiques potentiels d’une restructuration préalable de la dette, le FMI a modifié son cadre en 2010 afin d’autoriser une dérogation à l’obligation selon laquelle la dette devait être viable avec une forte probabilité lorsqu’il existait un risque élevé de retombées systémiques internationales.
22 Le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes naturelles peut apporter une aide aux pays à faible revenu admis à bénéficier de prêts concessionnels du fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance et dont le revenu par habitant est inférieur au plafond établi par l’Association internationale de développement (soit 1 215 dollars) ou, dans le cas de petits pays comptant moins de 1,5 million d’habitants, est inférieur à deux fois le plafond (soit 2 430 dollars).
23 Dans certains pays africains, les administrations des états et des collectivités ont la possibilité d’emprunter (souvent par l’émission d’obligations d’infrastructure) en dehors du contrôle des administrations fédérales ou centrales, au risque de rendre la dette insoutenable.
24 En économie, l’expression « péché originel » a été utilisée pour la première fois par Eichengreen et Haussmann (2003). Elle se rapporte à la difficulté pour les pays d’emprunter dans leur monnaie et pour une longue période sur le marché intérieur.
25 Il peut aussi s’agir d’effets de la parité des taux d’intérêt non couverte, c’est-à-dire où le risque de change (variations imprévues des taux de change) n’est pas couvert. En conséquence, l’écart des taux d’intérêt entre la dette intérieure et la dette extérieure pourrait vraisemblablement s’expliquer par des différences de taux d’inflation et des mouvements de change prévisibles.
26 Dans le cas de la Zambie, un fonds vautour qui avait acheté 3 millions de dollars de titres zambiens, a engagé des poursuites contre le pays. Il réclamait un montant de 55 millions de dollars et en a obtenu 15,5 millions de dollars. Les fonds vautours exercent des pressions sur les débiteurs souverains en essayant de faire saisir leurs actifs à étranger.
27 La base de données de la Banque mondiale contient les arrangements contractuels prévoyant ou non des investissements entre parties publiques et privées. Les informations communiquées concernent notamment le nombre de projets et les investissements effectués dans le cadre de partenariats public-privé. Les investissements peuvent être transformés en biens matériels, qui sont des ressources que la société chargée de l’exécution du projet s’engage à investir dans les installations requises pendant la période du contrat. Des investissements peuvent être réalisés pour de nouvelles installations, ou pour l’expansion et la modernisation de celles qui existent déjà, ou sous la forme de versements aux pouvoirs publics, qui sont des ressources que la société chargée de l’exécution du projet consacre à l’acquisition de biens appartenant à l’État, tels que des entreprises publiques ou des droits lui permettant de fournir des services dans un domaine spécifique ou d’utiliser certains spectres radio.
28 La base de données de la Banque mondiale sur la participation privée aux infrastructures ne contient aucune information sur la Libye ni sur la Guinée équatoriale.
29 Les partenariats public-privé inscrits dans la base de données de la Banque mondiale sur la participation privée aux infrastructures sont répartis entre quatre grands secteurs : l’énergie, les télécommunications, les transports ainsi que l’eau et l’assainissement. Le secteur des télécommunications concerne exclusivement les services fixes, mobiles ou longue distance. Le secteur de l’énergie englobe les partenariats public-privé conclus dans les sous-secteurs de l’électricité et du gaz naturel, tandis que le secteur des transports comprend les aéroports, les ports maritimes, les chemins de fer et les routes à péage. Le secteur de l’eau et de l’assainissement inclut les stations d’épuration et les réseaux de distribution.
30 Les projets de création d’infrastructures sont des projets élaborés de toutes pièces grâce à des investissements en capital. Ils visent généralement à construire ou à élargir une installation ou une infrastructure opérationnelle constituant un bien matériel qui n’existait pas avant l’investissement.
31 Une cession totale est parfois considérée comme une privatisation, car elle suppose que l’ensemble des intérêts qu’un gouvernement détient dans un équipement collectif ou dans une entreprise d’État sont transférés au secteur privé. Un équipement collectif ou un service public entièrement cédé ou privatisé se distingue d’une entreprise commerciale privée en ceci que le gouvernement conserve généralement un certain contrôle indirect ou pouvoir de réglementation sur le service privatisé au moyen d’une licence permettant à l’entité de fournir le service au public.
32 D’après une évaluation exhaustive des dépenses en capital visant des infrastructures en Afrique subsaharienne effectuée par Foster et Briceño-Garmendia (2010), les secteurs privé et public représentent chacun des investissements de 9,4 milliards de dollars par an. Les données disponibles ne sont toutefois pas suffisamment ventilées pour permettre de déterminer la part de ces montants qui est attribuable aux partenariats public-privé. Si l’on ajoute les coûts de fonctionnement et d’entretien aux dépenses en capital, on constate que les deux tiers des dépenses d’infrastructure sont assumées par le secteur privé chaque année.
33 Tous les pays africains étant membres d’au moins une communauté économique régionale − la plupart étant même membres de deux −, ils participent activement aux processus d’intégration régionale.
34 Voir l’adresse www.privatesector.ecowas.int/en/III/Supplementary_Act_Investment. pdf, consultée le 18 avril 2016.
35 Voir l’adresse www.sadc.int/files/4213/5332/6872/Protocol_on_Finance_ Investment2006.pdf, consultée le 18 avril 2016.
36 Le cadre de viabilité de la dette permet toutefois aux utilisateurs d’élaborer des instruments adaptés pour analyser la viabilité de la dette intérieure et de la dette extérieure. L’un de ces instruments est un test de résistance normalisé qui reproduit une perturbation générique des passifs éventuels − une augmentation du niveau d’endettement correspondant à 10 % du PIB − générant des flux au cours de la deuxième année de la période visée. Lorsque des informations pertinentes sont disponibles, un instrument mieux adapté peut être utilisé pour déterminer les passifs éventuels découlant, entre autres, d’entreprises d’État, de gouvernements infranationaux, de partenariats public-privé et des lacunes du secteur financier.
37 Les projets en difficulté sont ceux dont l’État ou l’exploitant a demandé la résiliation ou ceux qui sont soumis à l’arbitrage international.
38 Le rapport 2015 de Jubilee Debt Campaign répertorie des cas de PPP ayant échoué en Afrique.
39 Un prêt consortial est un prêt accordé à un emprunteur unique par un groupe de prêteurs (consortium).
40 Voir l’adresse www.gfmd.org/pfp/ppd/1861, consultée le 14 avril 2016.
41 L’Initiative pour le recouvrement des avoirs volés, lancée en 2007 par la Banque mondiale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, fournit une assistance technique devant permettre de localiser des richesses volées et des biens saisis ou confisqués ainsi que de mobiliser la coopération internationale (Brun et al., 2011).
42 Définis comme les prêts dont l’élément don représente 25 % ou plus du montant initial.
RÉFÉRENCES
Abbas SMA and Christensen JE (2007). The Role of domestic debt markets in economic growth: An empirical Investigation for low-income countries and emerging markets. IMF Working Paper No. 07/127.
Adams P (2015). Africa debt rising. Africa Research Institute. 22 January. Available at africaresearchinstitute.org/publications/africa-debt-rising-2/ (accessed 18 March 2015).
Adelegan OJ and Radzewicz-Bak B (2009). What determines bond market development in sub-Saharan Africa? IMF Working Paper No. 09/213.
African Capacity-Building Foundation (2015). Africa Capacity Report 2015 – Capacity Imperatives for Domestic Resource Mobilization in Africa. Harare.
African Development Bank, OECD, United Nations Development Programme and United Nations Economic Commission for Africa (2012). African Economic Outlook 2012: Promoting Youth Employment. OECD Publishing, Paris.
African Union (2001). New Partnership for Africa’s Development. Abuja.
African Union (2015). Agenda 2063: The Africa We Want, third edition, popular version. Addis Ababa.
African Union, African Development Bank and New Partnership for Africa’s Development (2010). Programme for Infrastructure Development in Africa – Interconnecting, integrating and transforming a continent. Available at nepad.org/sites/default/files/ PIDA%20Executive%20Summary%20-%20English.pdf (accessed 13 April 2016).
African Union and United Nations Economic Commission for Africa Conference of Ministers of Finance, Planning and Economic Development (2014). Track it! Stop it! Get it! Illicit financial flows. Report of the High-Level Panel on Illicit Financial Flows from Africa. Available at uneca.org/sites/default/files/PublicationFiles/iff_main_ report_26feb_en.pdf (accessed 13 April 2016).
Akyüz Y (2014). Internationalization of finance and changing vulnerabilities in emerging and developing economies. UNCTAD Discussion Paper No. 217.
Bank of Ghana (2015). Annual Reports, 2004–2014. Available at bog.gov.gh/index. php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=172 (accessed 13 April 2016).
Bank of Zambia (2015). Annual Reports, 2004–2014. Available at boz.zm/%28S%2 80ea5pb45vfolnqizj4k3xx45%29%29/GeneralContent.aspx?site=39 (accessed 13 April 2016).
Battaile B, Hernandez FL and Norambuena V (2015). Debt sustainability in sub-Saharan Africa: Unravelling country-specific risks. Policy Research Working Paper No. 7523. World Bank.
Brun J-P, Gray L, Scott C and Stephenson KM (2011). Asset Recovery Handbook: A Guide for Practitioners. World Bank, Washington, D.C.
Caliari A (2014). Post-2015 infrastructure finance: The new debt threat? Available at developmentprogress.org/blog/2014/02/10/post-2015-infrastructure-finance-newdebt-threat (accessed 18 April 2016).
Canavire-Bacarreza GJ, Neumayer E and Nunnenkamp P (2015). Why aid is unpredictable: An empirical analysis of the gap between actual and planned aid flows. Journal of International Development. 27(4):440–463.
Central Bank of Kenya (2015). Annual Reports, 2000–2015. Available at centralbank. go.ke/index.php/cbk-annual-reports (accessed 13 April 2016).
Central Bank of Nigeria (2015). Central Bank and Debt Management Office Annual Reports, 2000–2014. Available at cenbank.org/documents/annualreports.asp (accessed 18 April 2016).
Chinzana Z, Kedir A and Sandjong D (2015). Growth and development finance required for achieving Sustainable Development Goals inAfrica.Presented at theAfrican Economic Conference.Kinshasa.2–4November.Availableatafdb.org/uploads/tx_llafdbpapers/ Growth_and_Development_Finance_Requiredjor_Achieving_Sustainable_ Development_Goals__SDGs__in_Africa.pdf (accessed 13 April 2016).
Christensen J (2004). Domestic debt markets in sub-Saharan Africa. IMF Working Paper No. 04/46.
Davies F, Long C and Wabwire M (forthcoming). Age of choice: Uganda in the new
development finance landscape. Overseas Development Institute Working Paper.
Deen T (2015). Civil society sceptical over action agenda to finance development. Inter Press Service. 15 July. Available at ipsnews.net/2015/07/civil-society-scepticalover-action-agenda-to-finance-development/ (accessed 23 March 2016).
Economic Community of West African States: privatesector.ecowas.int/en/III/ Supplementary_Actjnvestment.pdf (accessed 18 April 2016).
Economic Justice Network (2011). Walking the talk on illicit financial flows: The G20’s responsibility in combating illicit capital flight. Available at taxjusticeafrica.net/ wp-content/uploads/2015/11/Policy-Brief-Illicit-Flows-Tax-Evasion-SA-G20.pdf (accessed 18 April 2016).
Eichengreen B and Hausmann R (2003). Original sin: The road to redemption. Available at eml.berkeley.edu/~eichengr/research/osroadaug21-03.pdf (accessed 13 April 2016).
Farlam P (2005). Working together: Assessing public–private partnerships in Africa. Policy Focus Series. South African Institute of International Affairs. Available at oecd. org/investment/investmentfordevelopment/34867724.pdf (accessed 13 April 2016).
Ferrarini B (2008). Proposal for a contingency debt sustainability framework. World Development. 36(12):2547–2565.
Financial Times (2016). Emerging market debt: A trawl for yield. 17 March.
Flassbeck H and Panizza U (2008). Debt sustainability and debt composition. Presented at the Workshop on Debt, Finance and Emerging Issues in Financial Integration. New York. 8–9 April. Available at un.org/esa/ ffd/events/2008debtworkshop/papers/Flassbeck-Panizza-Paper.pdf (accessed 13 April 2016).
Foster V and Briceño-Garmendia C, eds. (2010). Africa’s Infrastructure: A Time for
Transformation. World Bank and Africa Development Forum. Washington, D.C.
Lewis, JD (2013). What comes after debt relief? Some preliminary thoughts. Great Insights. 2(1):8–9.
Ghana Ministry of Finance (2015). Annual fiscal report data. Available at mofep.gov.gh/.
Greenhill R and Ali A (2013). Paying for progress: How will emerging post-2015 goals be financed in the new aid landscape? Overseas Development Institute Working Paper No. 366.
Griffiths J, Martin M, Pereira J and Strawson T (2014). Financing for development post-2015: Improving the contribution of private finance. European Parliament Directorate-General for External Policies of the Union. Available at europa.eu/eyd2015/sites/default/files/users/maja.ljubic/expo-deve_ et2014433848_en.pdf (accessed 13 April 2016).
Gunter B (forthcoming). Financing Africa’s development: Priorities, options and challenges. UNCTAD Discussion Paper.
Gutman J, Sy A and Chattopadhyay S (2015). Financing African Infrastructure: Can the World Deliver? Brookings Institution, Washington, D.C.
Guzman, M and Heymann, D (2015). The IMF debt sustainability analysis: Issues and problems. Journal of Globalization and Development. 6(2):387–404.
Herkenrath M (2014). Illicit financial flows and their developmental impacts: An overview. International Development Policy. Available at poldev.revues.org/1863#text (accessed 18 April 2016).
Hill C and MacPherson MF, eds. (2004). Promoting and Sustaining Economic Reform in Zambia. Harvard University Press. Cambridge, Massachusetts.
Howse R (2007). The concept of odious debt in public international law. UNCTAD Discussion Paper No. 185.
IMF (2005). World Economic Outlook April 2005 – Globalization and External Imbalances. Washington, D.C.
___________ (2007). Evaluation Report: The IMF and Aid to Sub‑Saharan Africa.
Washington, D.C.
__________ (2013a). Regional Economic Outlook: Sub-Saharan Africa – Building
Momentum in a Multi‑Speed World. Washington, D.C.
_____ (2013b). Staff guidance note on the application of the joint Bank-Fund debt
sustainability framework for low-income countries. Available at imf.org/external/np/ pp/eng/2013/110513.pdf (accessed 25 March 2016).
________ (2014a). Regional Economic Outlook: Sub‑Saharan Africa – Staying the
Course. Washington, D.C.
______ (2014b). The Fund’s lending framework and sovereign debt – preliminary
considerations. Available at imf.org/external/np/pp/eng/2014/052214a.pdf
(accessed 13 April 2016).
________ (2015a). Regional Economic Outlook: Sub‑Saharan Africa – Navigating
Headwinds. Washington, D.C.
________ (2015b) Zambia: Debt Sustainability Analysis – Staff report for the 2015
Article IV Consultation. IMF Country Report No. 15/152. Washington, D.C. Available at imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=42999.0 (accessed 20 April 2016).
IMF and World Bank (2012). Revisiting the Debt Sustainability Framework for LowIncome Countries. Available at imf.org/external/np/pp/eng/2012/011212.pdf (accessed 20 April 2016).
IMF, World Bank, European Bank for Reconstruction and Development and OECD (2013). Local currency bond markets – a diagnostic framework. Available at imf.org/ external/np/pp/eng/2013/070913.pdf (accessed 13 April 2016).
International Energy Agency (2012). World Energy Outlook 2012. Paris.
Jubilee Debt Campaign (2012). State of debt: Putting an end to 30 years of crisis. Available at jubileedebt.org.uk/reports-briefings/... (accessed 13 April 2016).
________ (2015). The new debt trap: How the response to the last global financial
crisis has laid the ground for the next. Available at jubileedebt.org.uk/reportsbriefings/report/the-new-debt-trap (accessed 13 April 2016).
Kar D and Cartwright-Smith D (2010). Illicit financial flows from Africa: Hidden resource for development in Report of the High-Level Panel on. Available at gfintegrity.org/ storage/gfip/documents/reports/gfi_africareport_web.pdf (accessed 13 April 2016).
Kar D and Freitas S (2011). Illicit financial flows from developing countries over the decade ending 2009. Available at gfintegrity.org/wp-content/uploads/2014/05/ HIGHRES-Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_over_the_Decade_ Ending_2009.pdf (accessed 13 April 2016).
Kauf A (2015). Financing as key enabling factor. Presented at the Multi-Year Expert Meeting on Transport, Trade Logistics and Trade Facilitation. Geneva. May. Available at unctad.org/meetings/en/Presentation/Ansgar%20KAUF.pdf (accessed 13 April 2016).
Kenya National Treasury (2014). Annual Public Debt Report July 2013–June 2014. Available at treasury.go.ke/(accessed 13 April 2016).
Ketkar SL and Ratha D, eds. (2009). Future-flow securitization. In: Innovative Financing for Development. World Bank. Washington, D.C.
_____ (2010). Diaspora bonds: Tapping the diaspora during difficult times. Journal
of International Commerce, Economics and Policy. 1(2):251.
Kremer M and Jayachandran S (2002). Odious debt. National Bureau of Economic Research Working Paper Series. Working Paper No. 8953.
Maana I (2008). Compilation and analysis of data on securitized public debt in Kenya. In: Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics Bulletin No. 31. Measuring Financial Innovation and Its Impact: Proceedings of the Irving Fisher Committee Conference. Bank for International Settlements. Basel: 35–43.
Maimbo SM and Ratha D, eds. (2005). Remittances: Development Impact and Future Prospects. World Bank, Washington, D.C.
Martin M (2015). Forestalling risks from contingent liabilities. Presented at the Tenth International Debt Management Conference. Geneva, 23–25 November. Available at unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=702 (accessed 13 April 2016).
Mavrotas G, ed. (2008). Domestic Resource Mobilization and Financial Development. Palgrave Macmillan in association with the United Nations University – World Institute for Development Economics Research. New York.
Ndikumana L and Boyce K (2008). New estimates of capital flight from sub-Saharan African countries: Linkages with external borrowing and policy options. Working Paper No. 166. Political Economy Research Institute. University of Massachusetts.
_____ (2011). Africa’s Odious Debts: How Foreign Loans and Capital Flight Bled a
Continent. Zed Books. London and New York.
OECD (2015a). African Central Government Debt – Statistical Yearbook 2003–2013. OECD Publishing, Paris.
_________ (2015b). Development Cooperation Report 2015: Making Partnerships
Effective Coalitions for Action. OECD Publishing, Paris.
Orozco M and Fedewa R (2006). Leveraging efforts on remittances and financial intermediation. Institute for the Integration of Latin America and the Caribbean Working Paper No. 24.
Panizza U (2008). Domestic and external public debt in developing countries. UNCTAD Discussion Paper No. 188.
Pigato MA and Tang W (2015). China and Africa: Expanding economic ties in an evolving global context. Working Paper No. 95161. World Bank.
Prizzon A and Mustapha S (2014). Debt sustainability in heavily indebted poor countries in a new age of choice: Taking stock of the debt relief initiatives and implications of the new development finance landscape for public debt sustainability. Overseas Development Institute Working Paper No. 397.
Pulitzer Centre on Crisis Reporting (2014). Zambia: The end of vulture funds? Available at unctad.org/en/pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=702 (accessed 13 April 2016).
Qizilbash A (2011). Public–private partnerships and the value of the process: The case of sub-Saharan Africa. International Public Management Review. 12(2).
Ratha D (2013). The impact of remittances on economic growth and poverty reduction. Migration Policy Institute Policy Briefs.
Ratha D and Plaza S (2011). Harnessing diasporas: Africa can tap some of its millions of emigrants to help development efforts. Available at imf.org/external/pubs/ft/ fandd/2011/09/pdf/ratha.pdf (accessed 13 April 2016).
Romero MJ (2015). What lies beneath? A critical assessment of PPPs [public–private partnerships] and their impact on sustainable development. European Network on Debt and Development.
Schmidt-Traub G (2015). Investment needs to achieve the Sustainable Development Goals – understanding the billions and trillions. Sustainable Development Solutions Network Working Paper, version 2.
Shaoul J (2009). Using the private sector to finance capital expenditure: The financial realities. In: Akintoye A and Beck M, eds. Policy, Finance and Management for Public–Private Partnership. Blackwell Publishing Ltd. Oxford.
Singh A (2010). Are the institutions of the stock market and the market for corporate control evolutionary advances for developing countries? Munich Personal Research Papers in Economics Archive No. 24346.
Southern African Development Community. Protocol on Finance and Investment. Available at sadc.int/files/4213/5332/6872/Protocol_on_Finance__Investment2006. pdf (accessed 18 April 2016).
South Africa National Treasury (2015). National Debt Report 2014–2015. Available at treasury.gov.za/publications/other/Debt%20Management%20Report%202014-15. pdf (accessed 13 April 2016).
Spanjers J and Frede Foss H (2015). Illicit financial flows and development indices. Available at gfintegrity.org/wp-content/uploads/2015/05/Illicit-Financial-Flows-andDevelopment-Indices-2008-2012.pdf (accessed 13 April 2016).
Standard and Poor’s (2014). Ghana downgraded to B- on external risks. Available at standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/1365808 (accessed 6 March 2016).
Sy A (2013). Financing Africa: Moving beyond foreign aid to issuing Eurobonds. Brookings Institution. 13 September. Available at brookings.edu/research/ opinions/2013/09/13-financing-africa-foreign-aid-eurobonds-sy (accessed 13 April 2016).
Tafirenyika M (2015). How healthy is Africa’s sovereign bond debt? Analysts caution against accumulating too much. United Nations Department of Public Information Africa Renewal 29(1):5–6.
Task Force on Development Impact of Illicit Financial Flows (2011). Final Report. Available at leadinggroup.org/IMG/pdf_Final_report_Task_Force_EN.pdf (accessed 13 April 2016).
Tyson JE (2015). Sub‑Saharan Africa International Sovereign Bonds, Part II: Risks for Issuers. Overseas Development Institute, London.
UNCTAD (2004). Economic Development in Africa: Debt Sustainability: Oasis or Mirage? United Nations publication. Sales No. E.04.II.D.37. New York and Geneva.
________ (2009). Enhancing the Role of Domestic Financial Resources in Africa’s
Development – A Policy Handbook. United Nations publication. New York and Geneva.
______ (2012a). Draft principles on promoting responsible sovereign lending and
borrowing. Available at http://unctad.org/en/Pages/GDS/Sovereign-Debt-Portal/ Sovereign-Lending-and-Borrowing.aspx (accessed 13 April 2016).
____________ (2012b). The Least Developed Countries Report 2012: Harnessing
Remittances and Diaspora Knowledge to Build Productive Capacities. United Nations publication. Sales No. E.12.II.D.18. New York and Geneva.
___________ (2014). World Investment Report 2014: Investing in the Sustainable
Development Goals – An Action Plan. United Nations publication. Sales No. E.14. II.D.1. New York and Geneva.
______ (2015a). The Least Developed Countries Report 2015: Transforming Rural
Economies. United Nations publication. Sales No. E.15.II.D.7. New York and Geneva.
_______ (2015b). Trade and Development Report, 2015: Making the International
Financial Architecture Work for Development. United Nations publication. Sales No. E.15.II.D.4. New York and Geneva.
_________ (2015c). Economic Development in Africa Report 2015: Unlocking the
Potential of Africa’s Services Trade for Growth and Development. United Nations publication. Sales No. E.15.II.D.2. New York and Geneva.
_____ (2015d). World Investment Report 2015: Reforming International Investment
Governance. United Nations publication. Sales No. E.15.II.D.5. New York and Geneva.
_________ (2015e). From Decisions to Actions: Report of the Secretary‑General of
UNCTAD to UNCTAD XIV. United Nations publication. New York and Geneva.
____________ (2016). UNCTADStat database. Available at unctadstat.unctad.org/
ReportFolders/reportFolders.aspx (accessed 19 April 2016).
United Nations (2005). In larger freedom: Towards development, security and human
rights for all. Report of the Secretary-General. A/59/2005. New York. 21 March.
United Nations Economic Commission for Africa (2015). Africa Regional Report on the Sustainable Development Goals. Addis Ababa.
United Nations Economic Commission for Africa and New Partnership for Africa’s Development (2014). Mobilizing Domestic Financial Resources for Implementing New Partnership for Africa’s Development National and Regional Programmes and Projects – Africa Looks Within. Johannesburg, South Africa.
United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean (2011). The economic infrastructure gap in Latin America and the Caribbean. Facilitation of Transport and Trade in Latin America Bulletin. 293 (1) Santiago. Available at repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/36339/FAL-293-WEB-ENG-2_ en.pdf?sequence=1 (accessed 20 April 2016).
United Republic of Tanzania (2002). National Debt Strategy: Domestic and total debt. Available at mof.go.tz/mofdocs/debt/nationaldebtstrategy.pdf (accessed 13 April 2016).
Bank of the United Republic of Tanzania (2015). Annual Reports, 2000–2014. Available at bottz.org/publications/ FinancialReports/FinancialStatements/2014/BOT%20 annual%20report%202014.pdf (accessed 13 April 2016).
Vaggi G and Prizzon A (2014). On the sustainability of external debt: is debt relief enough? Cambridge Journal of Economics. 38(5):1155–1169.
te Velde DW (2014). Sovereign bonds in sub-Saharan Africa: Good for growth or ahead of time? Overseas Development Institute Briefing No. 87.
Were M (2001). The impact of external debt on economic growth in Kenya: An empirical assessment. United Nations University World Institute for Development Economics Research Discussion Paper No. 2001/116.
World Bank (2012). Transformation Through Infrastructure. Washington, D.C.
________ (2014). Building Integrated Markets within the East African Community –
East African Community Opportunities in Public‑Private Partnership Approaches to the Region’s Infrastructure Needs. Washington, D.C.
______ (2015a). International Debt Statistics 2015. Washington, D.C.
____ (2015b). Public Private Infrastructure Advisory Facility Private Participation in
Infrastructure database. Available at ppi.worldbank.org/ (accessed 20 April 2016).
_____ (2015c). Migration and remittances: Recent developments and outlook.
Migration and Development Brief 24. Available at siteresources.worldbank.org/ INTPROSPECTS/Resources/334934-1288990760745/Migration and Development Brief24.pdf (accessed 13 April 2016).
__________ (2016a). Global Economic Prospects – Spiiovers amid Weak Growth.
Washington, D.C.
____ (2016b). International Debt Statistics database. Available at data.worldbank.
org/data-catalog/international-debt-statistics.
___________ (2016c). World Development Indicators database. Available at data.
worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators.
_________ (2016d). Country and lending groups. Available at data.worldbank.org/
about/country-and-lending-groups (accessed 8 March 2016).
_______ (2016e). Public–private partnerships. Available at worldbank.org/en/topic/
publicprivatepartnerships/overview#2 (accessed 20 April 2016).
World Bank and Debt Management Facility (2013). Africa since debt relief: Considerations for the Debt Sustainability Framework. Available at siteresources.worldbank.org/ INTDEBTDEPT/Resources/468980-1170954447788/3430000-1358445852781/ KB_AfricanHIPCs.pdf (accessed 13 April 2016).
World Bank and IMF (2014). Factsheet: The Joint World Bank–IMF Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries. Available at imf.org/external/np/exr/facts/ jdsf.htm (accessed 13 April 2016).
World Bank and IMF (2015). Public debt vulnerabilities in low-income countries: The evolving landscape. Board Report No. 101021. Available at documents.worldbank. org/curated/en/2015/12/25472395/public-debt-vulnerabilities-low-incomecountries-evolving-landscape (accessed 13 April 2016)
Rapports de la série Le développement économique en Afrique 173
Rapports de la série Le développement économique en Afrique
2000 Les flux de capitaux et la croissance en Afrique − TD/B/47/4 − UNCTAD/GDS/ MDPB/7
Auteurs : Yilmaz Akyüz, Kamran Kousari (chef d’équipe), Korkut Boratav (consultant).
2001 Bilan, perspectives et choix des politiques économiques − UNCTAD/GDS/AFRICA/1
Auteurs : Yilmaz Akyüz, Kamran Kousari (chef d’équipe), Korkut Boratav (consultant).
2002 De l’ajustement à la réduction de la pauvreté : Qu’y a-t-il de nouveau ?
− UNCTAD/GDS/AFRICA/2
Auteurs : Yilmaz Akyüz, Kamran Kousari (chef d’équipe), Korkut Boratav (consultant).
2003 Résultats commerciaux et dépendance à l’égard des produits de base − UNCTAD/GDS/AFRICA/2003/1
Auteurs : Yilmaz Akyüz, Kamran Kousari (chef d’équipe), Samuel Gayi.
2004 Endettement viable : Oasis ou mirage ? − UNCTAD/GDS/AFRICA/2004/1 Auteurs : Kamran Kousari (chef d’équipe), Samuel Gayi, Bernhard Gunter (consultant), Phillip Cobbina (recherche).
2005 Repenser le rôle de l’investissement étranger direct − UNCTAD/GDS/AFRICA/ 2005/1
Auteurs : Kamran Kousari (chef d’équipe), Samuel Gayi, Richard Kozul-Wright, Phillip Cobbina (recherche).
2006 Doublement de l’aide : Assurer la « grande poussée » − UNCTAD/GDS/ AFRICA/ 2006/1
Auteurs : Kamran Kousari (chef d’équipe), Samuel Gayi, Richard Kozul-Wright, Jane Harrigan (consultant), Victoria Chisala (recherche).
2007 Retrouver une marge d’action : La mobilisation des ressources intérieures et
l’État développementiste − UNCTAD/ALDC/AFRICA/2007
Auteurs : Samuel Gayi (chef d’équipe), Janvier Nkurunziza, Martin Halle, Shigehisa Kasahara.
2008 Résultats à l’exportation après la libéralisation du commerce : Quelques tendances et perspectives − UNCTAD/ALDC/AFRICA/2008
Auteurs : Samuel Gayi (chef d’équipe), Janvier Nkurunziza, Martin Halle, Shigehisa Kasahara.
2009 Renforcer l’intégration économique régionale pour le développement de
l’Afrique − UNCTAD/ALDC/AFRICA/2009
Auteurs : Norbert Lebale (chef d’équipe), Janvier Nkurunziza, Martin Halle, Shigehisa Kasahara.
2010 La coopération Sud-Sud : L’Afrique et les nouvelles formes de partenariat pour
le développement − UNCTAD/ALDC/AFRICA/2010
Auteurs : Norbert Lebale (chef d’équipe), Patrick Osakwe, Janvier Nkurunziza, Martin Halle, Michael Bratt, Adriano Timossi.
2011 Promouvoir le développement industriel en Afrique dans le nouvel environnement
mondial − UNCTAD/ALDC/AFRICA/2011
Auteurs : Norbert Lebale (chef d’équipe), Patrick Osakwe, Bineswaree Bolaky, Milasoa Chérel-Robson, Philipp Neuerburg (ONUDI).
2012 Transformation structurelle et développement durable en Afrique
− UNCTAD/ALDC/AFRICA/2012
Auteurs : Charles Gore et Norbert Lebale (chefs d’équipe), Patrick Osakwe, Bineswaree Bolaky, Marco Sakai.
2013 Commerce intra-Africain : libérer le dynamisme du secteur privé − UNCTAD/ ALDC/AFRICA/2013
Auteurs : Patrick Osakwe (chef d’équipe), Janvier Nkurunziza, Bineswaree Bolaky.
2014 Catalyser l’investissement pour une croissance transformatrice en Afrique −
UNCTAD/ALDC/AFRICA/2014
Auteurs : Patrick Osakwe (chef d’équipe), Rashmi Banga, Bineswaree Bolaky.
2015 Libérer le potentiel du commerce des services en Afrique pour la croissance et
le développement − UNCTAD/ALDC/AFRICA/2015
Auteurs : Junior Roy Davis (chef d’équipe), Laura Paez et Bineswaree Bolaky.
Auteurs : Junior Roy Davis (chef d’équipe), Laura Paez et Bineswaree Bolaky.
On peut se procurer les rapports de la série Le développement économique en Afrique auprès de la Division de l’Afrique, des pays les moins avancés et des programmes spéciaux, CNUCED, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10, Suisse (courriel : africadev@unctad.org). Les rapports peuvent aussi être consultés sur le site Web de la CNUCED : www.unctad.org/africa/series.